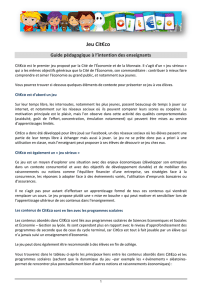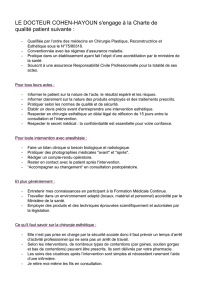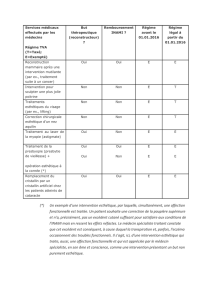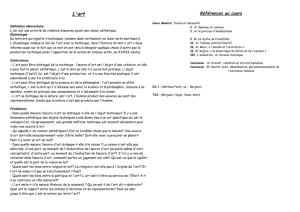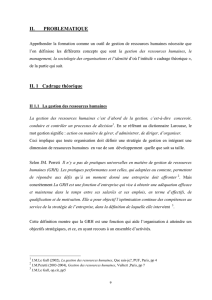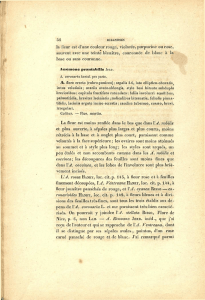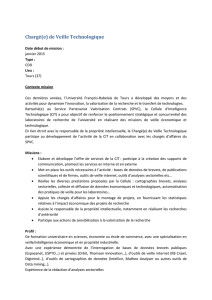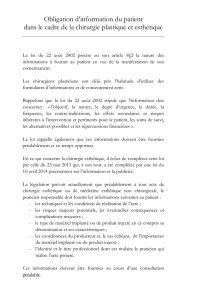faire (et) voir - Prolégomènes à toute œuvre future

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
UFR 04 • MARC JIMENEZ
M2 ESTHÉTIQUE
FRÉDÉRIC GUZDA-RIVIÈRE
2011-2012
!
!
!
!
faire!(et)!voir!

!
"!
1.!Une!œuvre,!deux!objets!
!
#$%! &'%! ()'*+$)'%! &+,-'%! .'! &/+-0)1.230+1-! 4! &/125)6,'! 72/+&! 31-%63)'! 4! &6!
(89-1*9-1&1,+'!.'!&/':(9)+'-3'!'%0890+72';!<+='&!#2>)'--'!'%0+*'!-93'%%6+)'!.'!
>6+)'! &6! *+%'! 62! (1+-0! %2+56-0'!?! @!A/':(9)+'-3'! '%0890+72'! 72'! -12%! 512&1-%!
.93)+)'!BCD!'%0!3'&&'!.2!%('3060'2);!4!&/':3&2%+1-!.'!&/6)0+%0'!&2+E*F*'!GH!I&!6J120'!?!
@!K')0'%;! +&! L! 6! 2-'! ':(9)+'-3'! '%0890+72'! .'! &/6)0+%0'!M! '0! &/':6*'-! .2! >6+)'!
6)0+%0+72'! '%0! %125'-0! &6! 51+'! )1L6&'! .'! &/'%0890+72'!GNH! O-'! 0'&&'! ()93620+1-!
&+*+-6+)'!(')*'0!62!(8+&1%1(8'!./65')0+)!&'!&'30'2)!.2!%2J'0!72/+&!'-0'-.!0)6+0');!'-!
.+%%+(6-0! .$%! &/6P1).! 2-'! (1%%+P&'! 6*P+,2Q09!?! &/':(9)+'-3'! '%0890+72'! 72/+&! %')6!
72'%0+1-! ./902.+')! -/'%0! (6%! 3'&&'! .'! &/6)0+%0';! *6+%! 3'&&'! .2! %('3060'2)H! K'! 72'!
3'00'! ()93620+1-! (12)06-0! %2((1%';! '0! 0+'-0! 5)6+%'*P&6P&'*'-0! (12)! 6372+%'!
(2+%72/'&&'! -'! %/L! 6))F0'! (6%;! 3/'%0! 72'! &/':(9)+'-3'! .'! &/6)0+%0'! )'31-.2+0!
-93'%%6+)'*'-0!62!@!>6+)'!6)0+%0+72'!G;!3'!.1-0;!4!()'*+$)'!52';!+&!'%0!-602)'&!.'!
31-5'-+);!*6+%!%2)0120!72'!3'00'!':(9)+'-3'!%'*P&'!-'!(6%!.'51+)!+-3&2)';!12!62!
*1+-%! (1251+)! -9,&+,')! &/':(9)+'-3'! .2! %('3060'2);! 31**'! %+! 3'00'! .')-+$)'! -'!
31-3')-6+0!(6%!&/6)0+%0';!31**'!%+!&/6)0+%0'!-/906+0!(6%;!&2+!62%%+;!%('3060'2)!.'!%'%!
()1()'%!R25)'%;!12!72'!3'00'!':(9)+'-3'E&4!-'!.'56+0!(6%!F0)'!+-0'))1,9';!12!-'!
*9)+06+0!(6%!.'!&/F0)'H!
!
S+!&6!72'%0+1-!-'!%'!(1%'!(6%;!3/'%0!()1P6P&'*'-0!(6)3'!72/'&&'!'%0!1332&09'!(6)!
&'%! 0')*'%! '0! &/'-J'2! ./2-'! 31-0)15')%'! 72+! -'! &2+! '-! .1--'! (6%! &/1336%+1-H!
A672'&&'!T! A/'-0)'()+%'! .'! #2>)'--'! %/+-%3)+0! .6-%! &'! 386*(! 9(+%09*1&1,+72'!
./2-'!':(9)+'-3'!.2!%('3060'2)!(6)!1((1%+0+1-!4!3'&&'!.'!&/6)0+%0'!3)960'2)!(6)3'!
72/+&! 0+'-0! 4! ()'-.)'! %'%! .+%06-3'%! 65'3! &'%! @!'%0890+72'%! BCD! >1-.9'%! %2)! 2-'!
(%L381&1,+'! .'! &6! 3)960+1-!G;! 6+-%+! 72/65'3! 3'! 72/+&! 6(('&&'! &'%! @!'%0890+72'%!
U1(9)601+)'%V!G"! 72+! &'2)! 1-0! %2339.9H! W12)721+! 3'00'! *9>+6-3'!T! W6)3'! 72'! 3'%!
'%0890+72'%;! 72+! 31-%+.$)'-0! &/R25)'! '-! *'006-0! @!&/633'-0! %2)! 3'! 72/'&&'! '%0! &'!
)9%2&060!./2-!>6+)'!BCD!-/1>>)'!(6%!X(&2%Y!2-'!,6)6-0+'!6P%1&2'!31-0)'!&'!(+$,'!.2!
(%L381&1,+%*'!G! 72'! 3'&&'%! 72+! *'00'-0! &/633'-0! %2)! &6! (')3'(0+1-;! '0! 72/'-!
@!1).1--6-0! &/':(9)+'-3'! '%0890+72'! 4! 3'&&'! .'! &/6)0+%0';! '&&'%! 0'-.'-0! 4! 6332%')!
3')06+-%!0)6+0%!.'!3'00'!':(9)+'-3';!'0!(6)!':'*(&'!4!':6&0')!2-'!%1)0'!.'!51&1-09!
.'! (2+%%6-3'!GZ;! 3'&&'! .'! &/6)0+%0';! 72+! )'-.)6+0! %'31-.6+)';! 51+)'! +-20+&';! &6!
31-0'*(&60+1-!.'!&/R25)'H!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NH! <I[\A! #O]^\__\;! !"#$%&#$%'%()*+ ,*+ '-*./#0)*$1*+ *23"#3)45*6! 0H! N;! WO];! 31&&H! `(+*9089';! W6)+%;!
Naa";!(H!NH!!
"H!<I[\A!#O]^\__\;!)7),8!
ZH!<I[\A!#O]^\__\;!%/8+1)386+(H!"H!

!
Z!
S+!#2>)'--';!726-0!4!3'!72/+&!-1**'!&'%!@!'%0890+72'%!U(%L381&1,+%6-0'%V!G;!>6+0!
':(&+3+0'*'-0! '0! ,&1P6&'*'-0! )9>9)'-3'! 4! b&6+-;! +&! -/6%%13+'! '-! )'56-38'! 6232-!
-1*!-+!6232-'!0891)+'!62:!@!'%0890+72'%!U1(9)601+)'%V!GH!c-!('20!%2((1%')!72'!3'%!
.')-+$)'%! 31))'%(1-.'-0! 62! .95'&1(('*'-0! .'%! )'38')38'%! (1Q90+72'%! +-+0+9'%!
(6)!W62&!d6&9)L!'0!.1-0!^'-9!W6%%')1-!>20!&/2-!.'%!%'3060'2)%!&'%!(&2%!6).'-0%H!c);!
31**'!(6)!&/'>>'0!./2-!)'>&2:!-602)'&;!&'%!(1%+0+1-%!(1Q90+72'%!%'!.9>+-+%%'-0!4!&'2)!
012)!(6)!1((1%+0+1-!4!&/'%0890+72'!0)6.+0+1--'&&'H!A'! 386*(! ./902.'! .9&+*+09! (6)!
&'%!(8+&1%1(8+'%!.'!&6!3)960+1-;!&'2)!1PJ'0;!@!3'!-/'%0!(6%!&/'-%'*P&'!.'%!'>>'0%!.'!
&/R25)'!(')e2';!3'!-/'%0!(6%!-1-!(&2%!&/R25)'!>6+0';!-+!&/R25)'!4!>6+)';!3/'%0!&/R25)'!
'-!0)6+-!.'!%'!>6+)'!GNH!#6-%!3'%!3+)31-%06-3'%;!&/R25)'!./6)0!@!()'-.!(&63'!'-0)'!&'!
fοιεῖν! '0! &/αἴσθησις;! '-0)'! &/6)0+%0'! 72+! &6! ()1(1%'! '0! &'! (2P&+3! 72+! &6! )'e1+0!G;! %+!
P+'-! 72'! .6-%! &/6(()138'! (1Q90+72';! @!&/1((1%+0+1-! '-0)'! &6! (')3'(0+1-! B&6!
31--6+%%6-3'D!'0!&/630+1-!B3)960)+3'D!.1+0!F0)'!*6+-0'-2'!G"H!
K1-%972'-3'!?! &'! %('3060'2)! -/':+%0'! (6%! (12)! &6! (1Q90+72';! &/6)0+%0'! -/':+%0'!
(&2%!(12)!&/'%0890+72'H!_1-!(6%!72'!&/2-'!12!&/620)'!.'%!.'2:!*9081.'%!31-0'%0'!
)'%('30+5'*'-0!&6!-93'%%+09!.'!&/6)0+%0'!12!.2!%('3060'2);!*6+%!38632-'!':3&20!&/2-!
12!&/620)'!.'!%1-!386*(!./902.'H!\:3&2%+1-!72+!%'*P&'!%/+*(1%')!31->1)*9*'-0!4!
&6!.9&+*+060+1-!.'!38632-!.'!%'%!386*(%H!<6+%!1-!('20!62%%+!%'!.'*6-.')!%+!3'00'!
*+%'! '-! 726)6-06+-'! -/'%0! (6%! ./6P1).! (12)! 38632-'! &6! 31-.+0+1-! ()96&6P&'! '0!
-93'%%6+)'!4!%6!(1%%+P+&+09!.'!%/':')3')!%6-%!)+%72'H!A'%!-26-3'%!.1-0!#2>)'--'!12!
W6%%')1-! *1.$)'-0! ()'%72'! 62%%+0g0! &'2)! ()1(1%! -'! 31-0)'.+%'-0! ./6+&&'2)%! (6%!
3'00'! %+0260+1-H! W6%%')1-!?! @!&'! .+%0+-,21! 72'! -12%! 5'-1-%! .'! .95'&1((')! '-0)'!
fοιεῖν!'0!αἴσθησις!-'!%2(()+*'!'-!)+'-!&'%!)'&60+1-%!BCD!./2-!%'30'2)!4!&/620)'H!W6)!
':'*(&';! &/6)0+%0'! >6+0! (6)0+'! .2! (2P&+3;! +&! '%0! 31-%1**60'2)! ./R25)'%;! +&! 6! &2+E
*F*'!2-!,1h0!GZH!K'0!6)0+%0'!.'5+'-0!3')0'%!%('3060'2);!*6+%!2-!%('3060'2)!31**'!
&'%! 620)'%;! '0! 3'! %('3060'2)! -/'%0! (&2%! 2-! 6)0+%0';! 51+)'! -'! &/6! J6*6+%! 909H! A'!
%('3060'2)! 72/+&! %')6+0! *$+ 39$3! 72/6)0+%0';! .1-3! >63'! 4! %'%! ()1()'%! R25)'%;! )'%0'!
>1)02+0! '0! -'! *9)+0'! 5)6+%'*P&6P&'*'-0! 6232-'! 600'-0+1-! (6)0+32&+$)'H!
A/'%0890+72'!.'5+'-0!@!&/'%0890+72'!.2!,1h0!.'%!6)0+%0'%!G;!38632-!)'%0'!4!%6!(&63'!
'0!62!>1-.!3'&6!-'!386-,'!)+'-!B%+-1-!&'!31%02*'D!?!>6+)'!'0!51+)!)'%0'-0!+-0'))1,9%!
%9(6)9*'-0H!#2>)'--'!?!@!-12%!&+*+06-0!4!&/':(9)+'-3'!.2!%('3060'2);!-12%!62)1-%!
726-.!*F*'!4!95172')!&/620'2)!M!*6+%!&/620'2)!.1-0!+&!%/6,+)6!6&1)%!'%0!3'&2+!72'!
&/R25)'!)95$&';!'0!-1-!3'&2+!72+!6!8+%01)+72'*'-0!>6+0!&/R25)'H!BCD!A/!U'%0890+72'V!
.1+0!*1P+&+%')!62%%+!P+'-!&6!5+'!'%0890+72'!.2!3)960'2)!72'!&/':(9)+'-3'!'%0890+72'!
.2! %('3060'2)H! _12%! -'! %1-,'1-%! .1-3! -2&&'*'-0! 4! .+%3)9.+0')! &/902.'! .'! &6!
()'*+$)'!M! *6+%! '&&'! -'! ('20! %'! 31->1-.)'! 65'3! &/902.'! .'! &6! %'31-.'!?! 72'&72'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NH!^\_`!WbSS\^c_;!!%50+5$*+/")'%2%/")*+,*+'9+10#93)%$;
!
j!
+-09)F0!72/+&!L!6+0!4!&'%!31->)1-0');!&'%!1PJ'0%!.'!3'%!.'2:!902.'%!%1-0!.+>>9)'-0%!GH!
A6!@!5+'!'%0890+72'!.2!3)960'2)!G;!3/'%0!(12)!#2>)'--'!&/630+5+09!3)960)+3';!.1-0!+&!
%2,,$)'!72'&72'%!&+,-'%!(&2%!P6%!72/'&&'!'%0!P+'-!(&20g0!.'!-602)'!4!1)+'-0')!@!2-'!
)9>&':+1-!%2)!&/6)0;!%1+0!31**'!>6+0!%13+1&1,+72';!%1+0!31**'!>6+0!6-08)1(1&1,+72';!
%1+0!*F*'!31**'!3609,1)+'!.'!&/'%()+0!.6-%!2-'!(')%('30+5'!89,9&+'--'!GNH!#1-3!
.'! -/F0)'! (6%! )'72+%'! 31**'! 1PJ'0! (1%%+P&'! ./2-'! '%0890+72'! 72+! +-0'))1,'!
&/':(9)+'-3'!.2!%('3060'2)H!K/'%0!./6+&&'2)%!0'38-+72'*'-0!()9>9)6P&'!M!36)!.6-%!&'!
36%!31-0)6+)';!@!&/620'2)!72'!&/R25)'!)95$&'!G!'0!@!3'&2+!72+!6!8+%01)+72'*'-0!>6+0!
&/R25)'!G! -'! >')6+'-0! (&2%! 72/2-;! 3'! 72+! )'-.)6+0! &6! %+0260+1-! (12)! &'! *1+-%!
(6)6.1:6&'!.$%!&'!.9(6)0H!K/'%0!(12)06-0;!-12%!%'*P&'E0E+&;!3'!72/'&&'!'%0!./'*P&9';!
'0!3/'%0!6+-%+!72/'&&'!%'!(1%';!31**'!-12%!0m38')1-%!.'!&'!%2,,9)')H!
!
K6)! (1%')! &6! 72'%0+1-! .'! &/6)0+%0'! 31**'! %('3060'2)! -/'%0! (6%! >1)39*'-0!
@!1).1--')!&/':(9)+'-3'!'%0890+72'!4!3'&&'!.'!&/6)0+%0'!G;!3/'%0E4E.+)'!31-0)6+-.)'!&6!
()'*+$)'!4!3'!72+;!31**'!()1J'0;!+-0'-0+1-!12!51&1-09;!(12))6+0!.9>+-+)!&6!%'31-.'H!
W1%')!&6!72'%0+1-!.'!&/6)0+%0'!1%&&*!%('3060'2);!+*6,+-')!72/'&&'!(2+%%'!%'!(1%');!
3/'%0! ./6P1).! -'! (6%! 0'-+)! (12)! 6372+%! 72'! &/':(9)+'-3'! .'! &/6)0+%0'! .1+5'! F0)'!
)'31-.2+0';! ':3&2%+5'*'-0! -+! ()+1)+06+)'*'-0;! 4! 3'&&'! ./2-'! 630+5+09! ()1.230)+3'!
0120!'-0+$)'!%2P1).1--9'!4!&/':()'%%+1-!.'!%6!()1()'!@!51&1-09!.'!(2+%%6-3'!G!B+3+!
#2>)'--'!>6+0!&+009)6&'*'-0"!)9>9)'-3'!4!_+'0n%38'!'0!4!&/+*(9)60+>;!(12)!3'!.')-+');!
.'! 31-%+.9)')! &/R25)'! ./6)0! .2! (1+-0! .'! 52'! .'! &/6)0+%0'DH!K6)! %+! &/1-! 6331).'! 4!
#2>)'--'!@!X72/Y+&!>620!P+'-!.9>+-+)!&/':(9)+'-3'!'%0890+72'!(6)!&/1PJ'0!.1-0!'&&'!>6+0!
&/':(9)+'-3'!'0!72'!-12%!6(('&&')1-%!1PJ'0!'%0890+72'!G!'0!72'!3'0!1PJ'0!@!-'!('20!
F0)'!.9>+-+!&2+E*F*'!72'!31**'!31))9&60!.'!&/':(9)+'-3'!'%0890+72'!G;!(12)721+!
>620E+&! )'-1-3');! %'&1-! &2+;! 4! @!+-5172')! &/R25)'! ./6)0! '-! 06-0! 72/'&&'! '%0!
+.'-0+>+6P&'! (6)! &/630+5+09! .'! &/6)0+%0'Z!G!T! o120! %+*(&'*'-0! (6)3'! 72'! &/1PJ'0!
'%0890+72'!'0!&/':(9)+'-3'!72+!&2+!31))'%(1-.!%1-0!./'*P&9'!':3&2%!.'!&/':')3+3'!.'!
3'00'!630+5+09H!K/'%0!62!*F*'!()9%2((1%9!72'!>6+0!31->+6-3'!^'-9!W6%%')1-;!(12)!
&'72'&! &/':(9)+'-3'! '%0890+72'! .'! &/6)0+%0'! -/'%0! 72'! &/1336%+1-! .'! )6(('&')! 72/+&!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NH!<I[\A! #O]^\__\;!!"#$%&#$%'%()*+ ,*+'-*./#0)*$1*+ *23"#3)45*6+%/8+1)386+((H! ZEjH!_12%!)'5+'-.)1-%!
%2)!3'!.')-+')!(1+-0!4!&6!>+-!.2!()9%'-0!.1%%+')H!
"H!<6+%!+*(&+3+0'*'-0!M!31-0)'!0120'!600'-0';!_+'0n%38'!'%0!6P%'-0!.'!&/)$,*.+$%&)$5&!.'!&/125)6,'H!
:;8!(6)!':'*(&'!p'+.',,')!%2)!3'!(1+-0!?!@!A/+-09)+'2)!.'!&/6)0;!3/'%0!&/630+5+09!()1.230)+3'!.'!&/6)0+%0'!
72+! 31-%0+02'! )9'&&'*'-0!&6!3)960+1-H!#1-3!3/'%0!'-!6*1)e6-0!&6!72'%0+1-!4!(6)0+)! .'!&/630+5+09!.'!
&/6)0+%0'!72'!&/1-!633$.'!&'!(&2%!%h)'*'-0!4!&6!3)960+1-!62!%'-%!6P%1&2!'0!(6)06-0;!4!&6!d1&1-09!.'!
(2+%%6-3'H! K'00'! %'31-.'! ()1(1%+0+1-! '%0! 2-'! 31-%972'-3'! .'! &6! 08$%'! >1-.6*'-06&'! .'! &/6)0! '-!
06-0!72'!%0)2302)'!.'!&6!d1&1-09!.'!(2+%%6-3'H!G!<b^oI_!p\I#\qq\^;!<)*3=21"*+>;!B/903)*+>8+?9+@%'%$3#+
,*+/5)229$1*+*$+39$3+45-903A;!q6&&+*6).;!31&&H!r+P&+108$72'!.'!(8+&1%1(8+';!NalN;!(H!NZiH!
ZH! <I[\A! #O]^\__\;! %/8+ 1)386! (H! j8+ A/630+5+09! .'! &/6)0+%0'! %2>>+0E'&&';! ./6+&&'2)%;! 4! +.'-0+>+')! &/R25)'!
./6)0!T!K1**'-0!&'!('20E'&&'!T!\0!31**'-0!'%0E'&&';!.'!>6+0;!'&&'E*F*'!+.'-0+>+9';!%+!1-!&6!31*(6)'!4!
0120!620)'!0L('!./630+5+09!T!K'00'!+.'-0+>+360+1-;!'->+-;!%')6+0E'&&'!&'!>)2+0!.'!&/630+5+09!'&&'E*F*';!%6!
31-%972'-3'!&1,+72'!'0!'>>'30+5'!T!

!
k!
5+%+0';! &2+! 62%%+;! .'%! ':(1%+0+1-%;! '-! 12P&+6-0! .'! %'! .'*6-.')! 31**'-0! 3'00'!
':(9)+'-3'! ('20! F0)'! '-,6,9'! (6)! '0! .6-%! 3'00'! >6*'2%'! 630+5+09! 3)960)+3';! 12!
./':(&+72')!(12)721+!'&&'!.1+0!'-!F0)'!':3&2'H!
!
S+! 6-0+0890+72'%! 72'! (2+%%'-0! (6)6s0)'! &'%! (1%+0+1-%! )'%('30+5'%! .'! <+='&!
#2>)'--'!'0!.'!^'-9!W6%%')1-;!'&&'%!%/6331).'-0!-96-*1+-%!38632-'!&/2-'!&/620)'!
%2)!3'!72/'&&'%!%1-0;!-106**'-0!(6)!1((1%+0+1-!4!3'!72/'&&'%!-'!%1-0!(6%;!'0!J12'-0;!
./2-'!3')06+-'!*6-+$)';!&6!*F*'!(6)0+'!65'3!&'%!*F*'%!)$,&'%H!\-!120)';!*F*'!%+!
&'%!0'))+01+)'%!)'%('30+>%!1332(9%!(6)!&6!(1Q90+72'!'0!&/'%0890+72'!%'*P&'-0!9+/0)%0)!
6-06,1-+%0'%;!+&%!(6)06,'-0!-96-*1+-%!2-'!>)1-0+$)'!31**2-'!?!&/R25)'H!]620E+&!'-!
31-3&2)'! 72'! 0120'! R25)'! .1--'! %L%09*60+72'*'-0! &+'2! 4! .'2:! 1PJ'0%;! &/2-!
(1Q90+72';! &/620)'! '%0890+72';! 31->1)*9*'-0! 62:72'&%! 38672'! .+%3+(&+-'! %'!
31-%0+02'! '0! '-,6,'! %1-! ':6*'-!T! K/'%0! ()1P6P&'H! _12%! 512.)+1-%! (12)06-0!
31->)1-0')! &'%! .'2:! (1+-0%! .'! 52';! '0! >6+)'! &/8L(108$%'! 72/2-'! .90')*+-60+1-!
31**2-'!(12))6+0!&'%!()939.')!&/2-!31**'!&/620)';!'-!&/1332))'-3'!&6!51360+1-!'0!
&6!-93'%%+09;!(12)!&/R25)';!4!%/':(1%')H!W12)721+!%/6))F0')!+3+!4!2-'!0'&&'!95+.'-3'!T!
#+)'!72'!&/R25)'!%/':(1%';!)+'-!-/'%0!(&2%!P6-6&;!51+)'!(&2%!+-20+&'!?!3'!72+!.'5)6+0!
(&20g0! )'0'-+)! 12! *9)+0')! &/600'-0+1-! '%0! &6! *6-+$)'! .1-0! 38672'! ':(1%+0+1-!
+->&2'-3'!&/':(9)+'-3'!'%0890+72';!&6!>6e1-! .1-0! @!&6!%39-1,)6(8+';!&/6)38+0'302)';!
&'%! 31**'-06+)'%;! &'%! 0':0'%! .'! *9.+60+1-! 1)+'-0'-0! '0! )91)+'-0'-0! BCD! &'!
J2,'*'-0! %2)! &'%! R25)'%! '0! -10)'! 31*()98'-%+1-! .'! &/6)0!GN;! (12)! 31*()'-.)'!
31**'-0!0120'%!&'%!':(1%+0+1-%!@!-'! %1-0!J6*6+%!72'!.'%!633)1386,'%!%2PJ'30+>%!
%12*+%!)9,2&+$)'*'-0!4!)9956&260+1-%!'0!*1.+>+360+1-%!'-!0120!,'-)'!G"H!<6+%!2-!
0'&!()1J'0!6.*'0!.9J4!&'!()9%2((1%9!72'!-12%!%1286+0')+1-%!()93+%9*'-0!*'00)'!
'-!72'%0+1-;!4!%651+)!72'!&'%!R25)'%!%1-0!.'%!1PJ'0%!-'20)'%!'0!.+%(1-+P&'%;!()F0%!
4! F0)'! *+%! '-! %3$-'! ./2-'! >6e1-! 12! ./2-'! 620)';! %'&1-! 0'&! 12! 0'&! (6)0+! ()+%!
*2%91,)6(8+72';! +-31-%3+'-0! 12! )'5'-.+729H! I&! -'! %/6,+0! (6%;! (12)! -12%;! '-!
()'-6-0!630'!72'!&/':(1%+0+1-!%'!.93&+-'!012J12)%!'-!5$*!':(1%+0+1-!(6)0+32&+$)';!
.'! )6*'-')! 6+-%+! '*2! ':(1%+0+1-%! 4! 2-'! 8+%01+)'! B'%0890+72';! %13+1&1,+72';! '03HD;!
*6+%! 4! &/+-5')%'! .'! %2,,9)')! 72'! &/':(1%+0+1-! '&&'E*F*';! &'! >6+0! ./F0)'! *1-0)9;!
':(1%9!12!(&20g0!./651+)!4!&/F0)';!.90')*+-'!./'*P&9'!&/R25)'!31**'!0'&&';!656-0!
0120'!620)'!3+)31-%06-3'H!I&!%/6,+0;!'-!./620)'%!0')*'%;!./'-5+%6,')!72'!@!X&/R25)'Y!
-/6((6)6s0!(6%!(6)3'!72/X'&&'Y!'%0;!*6+%!(6)3'!72/X'&&'Y!%/':(1%'!GZ;!6>+-!.'!(1251+)!
B%'D! .'*6-.')! 3'! 72/'&&'! ':(1%';! 12!*F*'! %+! '&&'! %/':(1%';! 62! %('3060'2)! 62%%+!
P+'-!72/4!&/6)0+%0';!'0!31**'-0H!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NH!t`^u<\!qAIK\_So\I_;!?-B03+C+5$*+")23%)0*+,-*./%2)3)%$2;!WO];!31&&H!A+,-'%!./6)0;!W6)+%;!"iia;!(H!N"H!
"H!t`^u<\!qAIK\_So\I_;!%/8+1)38;!(H!aH!
ZH!t\b_EAOK!<b^Ic_;!D39$3+,%$$#6+E229)+,-5$*+/"#$%&#$%'%()*+,*+'9+,%$93)%$;!WO];!31&&H!`(+*9089';!
Naal;!(H!liH!_12%!651-%!%2P%0+029!F5G0*!62!*10!397'*95!.'!&6!(8)6%'!1)+,+-6&'H!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
1
/
90
100%