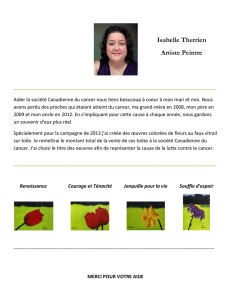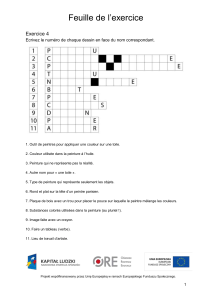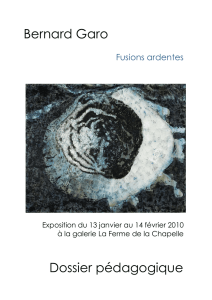"Painter" de Paul McCarthy

L’asthénie du peintre :
quête d’identité dans la vidéo Painter de Paul McCarthy
Résumé
Rassemblant stéréotypes et lieux communs de la peinture, Paul McCarthy, dans la vidéo
Painter, façonne une figure doxique de l‘artiste : le peintre s‘exprime et de chacun de ses
gestes naît une œuvre d‘art. A la recherche du for intérieur, d‘une intimité immuable qui
assure la plénitude de l‘individu sans conventions, McCarthy met en scène une quête de
l‘identité. L‘artiste perd son efficience car ―l‘expression‖ honore le geste au détriment
d‘un quelconque but. Le peintre burlesque de McCarthy laisse s‘effondrer toutes les
constructions identifiantes qui maintenaient la figure du peintre. S‘entassent alors les
constats : l‘artiste ne peut plus articuler le monde, le voilà devenu fragile et déficient. Le
peintre de McCarthy régresse hors de la culture à la recherche d‘une identité qui pallierait
au défaut de représentations. Mais ce personnage est un bouffon et la déréliction s‘impose
à l‘artiste : l‘impossibilité de s‘appuyer sur un quelconque substrat instaurateur engendre
l‘asthénie. La peinture est fatiguée et le peintre, perdant sa position de sujet structuré et
structurant la matière picturale, n‘a plus rien à faire.
Mots clés : création – expression – fatigue – for intérieur – peintre – représentation –
repos.
Abstract
Paul McCarthy, in his video Painter, brings together all the stereotypes of painting. He
shapes a conventional representation of the artist: the painter expresses himself, and from
each one of his movements a artwork is born. He looks for unmovable intimacy, which
assures the plenitude of individuality without social conventions: McCarthy displays a
quest for identity. The artist loses his efficiency, because the ―expression‖ implies a
movement free of any goal. McCarthy‘s burlesque painter lets all the groundwork of
identity, which used to hold together the character of painter, collapse. The artist is not
able to organize the world any more. He becomes weak and deficient. McCarthy‘s painter
acts as if he has found again a natural behaviour, out of any culture. This identity structure
is like a substitute for the lack of representation. But the character is a buffoon and only
dereliction remains. Painting has got no more substratum. The paint is tired and the
painter, losing his position of structured subject and subject structuring the paint, does
almost nothing, not because he wants to be more profitable, but because he has nothing to
do anymore.
Key words: creation – expression – tiredness – inside – painter – representation – quiet.
Sciences-Croisées
Numéro 2-3 : L’Identité
L’asthénie du peintre :
quête d’identité dans la vidéo
Painter
de Paul McCarthy
Marion Delecroix
Université de Provence
Département des Arts Plastiques

Marion Delecroix
L’asthénie du peintre : quête d’identité dans la vidéo Painter de Paul McCarthy
1
ne œuvre d‘art est faite par un artiste et un artiste fait des œuvres d‘art ;
tautologie duchampienne (1994) déconcertante et qui indique
l‘impuissance dans laquelle s‘est engouffré le monde de l‘art depuis la
capitulation de l‘Académiei. Le rapport pour le moins peu distinct entre
l‘œuvre et l‘artiste impose le constat suivant : le monde contemporain est
incapable de reconnaître une œuvre d‘art et inapte à identifier l‘artiste. La seule
façon de définir œuvre et artiste serait d‘accorder une intimité instinctive, naturelle
à l‘individu qui permettrait de désigner un noyau dur, un fond structurant. Et par
cette immatérielle mais tellement rassurante intimité, l‘artiste ne serait alors que
cela, un artiste, il serait né artiste, il contiendrait en lui l‘originalité qui n‘aurait
pas à être apprise, seulement à être découverte : l‘artiste aurait du génie, et serait
artiste naturellement. Dans une émission télévisée, dans son atelier, dans son
appartement, chez son marchand de tableaux, Paul McCarthy nous le prouve, en
mettant en scène, dans la vidéo Painter, un peintre, l‘artiste par excellence, qui ne
quitte jamais sa tenue de peintre. L‘habit fait le moine et le peintre dort avec sa
blouse sale et les doigts pleins de peinture.
McCarthy caricature De Kooning, grande figure de la peinture américaine qui
rassemble ici tous les stéréotypes et les lieux communs de la peinture : le peintre
s’exprime, et de chacun de ses gestes naît une œuvre d‘art. McCarthy fabrique une
figure de l‘artiste dans le respect de la doxa : marginal, socialement incontrôlable
et psychiquement fragile. Le peintre devient comme un animal lorsqu‘il défèque
dans une plante, comme un petit enfant lorsqu‘il se met en colère chez son
marchand ou quand il fait l‘avion, ou comme un fou lorsqu‘il se coupe les doigts
et lorsqu‘il tourne sur lui-même en répétant « De Kooning, De Kooning, De
Kooning ». Le peintre investit alors trois figures de la régression hors de la
« culture », dans une déambulation scatologique qui traduit la recherche du for
intérieur, de cette intimité immuable qui garantit l‘individu, sans les conventions
sociales. Le peintre est né artiste et son métier consiste justement en l‘expression
de son intimité innée.
Voici donc mis en scène une quête de l‘identité, une déambulation qui mettrait
l‘artiste en abîme : le peintre prendrait le relais du réalisateur au sein de la fiction.
Organisation narrative bien arçonnée, et (trop) utilisée au cinéma qui interroge les
places et rôles respectifs des personnages fictifs, acteurs, metteur en scène, etc…ii
Mais McCarthy en fait trop et son peintre est grotesque. Ses pitreries et sa
maladresse suscitent un rire en coin ; un rire biaisé par la débâcle, par l‘excès de
scènes scatologiques et sexuelles. Le malaise s‘installe car cette pléthore
d‘exagérations réduit l‘identité à un ramassis de conventions tacites et idéelles, à
des préjugés sans assises. McCarthy montre du doigt un mythe de l‘artiste créateur
et authentique, et le noyau dur de l‘identité disparaît. Les conventions s‘articulent
entre deux pôles : à la fois les conventions sociales dont on fait fi pour retrouver sa
véritable identité et les conventions idéologiques qui postulent l‘existence de cette
véritable identité dissimulée au fin fond de l‘individu, hors de la société. Paul
McCarthy expose toute une mythologie de l‘artiste peintre et de l‘individu
contemporain en quête d‘identité.
U

Marion Delecroix
L’asthénie du peintre : quête d’identité dans la vidéo Painter de Paul McCarthy
2
1. A la recherche d’un primat.
La figure du peintre (expressionniste en l‘occurrence) s‘accompagne d‘une
mythologie de l‘expression de soi et de la réalisation de ce qu‘est le peintre, au
fond de luiiii. Les lieux communs de la peinture que sont l‘expression et
l‘authenticité demeurent les seuls éléments stables, vestiges d‘une Académie
structurante. Or, comme s‘il prenait en charge les mythes qui structurent la figure
de l‘artiste pour démultiplier leurs conséquences, McCarthy déconstruit cette foi
en l‘expression, en l‘intériorité secrète de l‘individu. Cette mythologie qui croit
avoir déniché le noyau dur en dehors des conventions sociales se révèle n‘être
qu‘un reliquat des conventions perdues. Le peintre de McCarthy est peintre à
outrance. Grotesque parce que tout ce qu‘il fait devient de l‘art, il exacerbe le
problème relevé par Alechinsky (1997) lorsqu‘il explique l‘absurdité d‘une
certaine conception doxique de l‘art qui regrette que l‘artiste détruise certaines de
ses peintures ; le fait qu‘il soit artiste, en effet, devrait lui interdire de gommer
quoi que ce soit, puisque le moindre coup de crayon serait artistique. Absurdité
poussée à son comble lorsqu‘il souligne qu‘étant artiste, le moindre coup de
gomme aussi est artistique ! Mais, bien entendu, cette seconde assertion contredit
le grand mythe de l‘artiste fabricant d‘œuvre d‘art. L‘artiste fait œuvre sans jamais
se tromper, il n‘a jamais à faire à du repentir. L‘adage populaire explique et évalue
la valeur artistique selon un don qui supposerait justement que toute production est
immédiatement artistique ou pas. McCarthy, de ce fait, est peintre aussi dans son
lit : il est toujours peintre car il en va de son identité, sous le patronage de son for
intérieuriv.
Les « œuvres » du peintre mis en scène par McCarthy, qui ressemblent
étrangement à certaines œuvres (couleur, traces, etc.) peintes par De Kooning,
résultent d‘une lutte exacerbée entre lui et la matière picturale. Cette dernière
devient un partenaire sexuel : des pinceaux démesurément grands lui servent de
prothèse phallique, il troue un tableau avec l‘un de ces pinceaux, il rêve d‘entrer
dans des tubes de peinture (faire un avec la matière picturale), il triture ses tubes
de couleurs géants, à taille humaine, avec un pinceau puis avec la main, avec un
geste de va-et-vient pour le moins ambiguë : mélange-t-il la couleur à même le
tube ou tente-t-il de masturber le tube de peinture ? Les tubes de peinture humains
de McCarthy sont étiquetés : red, blue, black, shit. Les fluides corporels et la
nourriture sont incorporés à sa peinture à l‘aide d‘outils phalliques. Dans une
vidéo plus ancienne, Painting, wall whrip, (1974), McCarthy peint avec de la
mayonnaise, du ketchup et des excréments. Ces deux vidéos-performances de
McCarthy se construisent autour du sexe et des défections, comme restes, comme
origine instinctive de l‘individu. Mais cette origine est socialement inventée et elle
se mélange au ketchup. Certes McCarthy n‘hésite pas à critiquer l‘abondance de la
société de consommation, mais c‘est surtout les vestiges d‘un individu sans
repères qu‘il met en scène, s‘aidant souvent, dans d‘autres performances, des
grands personnages de fictions enfantine (Heidi, Pinocchio). Dans Painter,
McCarthy utilise De Kooning comme Pinocchio : comme un mythe structurant
l‘imaginaire collectif américain.
McCarthy mêle tout à dessein et perd le spectateur : psychanalyse, doxa,
marginalité, stéréotypes. Tout s‘amalgame dans la recherche du for intérieur, et
évoquer ce for intérieur même n‘a plus aucune conséquence théorique. Dans l‘une
de ses premières vidéo-performances, en 1972, McCarthy rampe sur le sol,
déversant devant lui de la peinture et créant avec son corps (sa tête en première
ligne), une trace blanche. Cette performance, de manière très simple et épurée,
sans investir de grandes figures collectives, sans non plus mettre en scène une
quasi fiction et sans autre accessoires que le la peinture blanche, caricature
l‘artiste qui s‘exprime, le rapport au corps qui simule une transe créatrice,

Marion Delecroix
L’asthénie du peintre : quête d’identité dans la vidéo Painter de Paul McCarthy
3
l‘instinct retrouvé, ou, dans les tréfonds de son individu les retrouvailles avec les
restes primitifs, purs et originels qui sont au principe de l‘individu. Pour tracer
cette ligne blanche sur le sol, McCarthy se trémousse à la manière d‘un animal.
Bien sûr, cette performance rappelle très distinctement un peintre comme Pollock
en lutte avec la matière picturale.
« Aussi paradoxale soit-elle, la performance émerge dans un contexte on ne peut
plus stérile, celui de l‘expressionnisme abstrait new-yorkais. Cette tendance, au
regard de son soubassement moderniste, repose en effet sur l‘intégrité — pour ne
pas dire le refoulement — du corps de l‘artiste, tout en s‘appuyant, plus
généralement, sur une conception autotélique de l‘œuvre d‘art qui fait de son
―originalité‖ et de sa spécificité (au sens où Lessing l‘avait théorisée au XVIIe
siècle), en l‘occurrence picturale, deux données inviolables » (Verhagen, 2003/6,
p.801).
Voilà donc posé que McCarthy a pour pères les expressionnistes et leur chef de
file Pollock de qui Harold Rosenberg, écrit : « Pour chaque peintre américain il
arriva un moment où la toile lui apparut comme une arène offerte à son action —
plutôt qu‘un espace où reproduire, recréer, analyser ou ―exprimer‖ un objet réel ou
imaginaire. Ce qui devait passer sur la toile n‘était pas une image, mais un fait,
une action » (Rosenberg, 1952). Rosenberg insiste sur l‘importance de l‘action
dans le terme de action painting, c'est-à-dire du processus ; la réalisation prime sur
le résultat. La manière de faire et de s‘engager dans sa production légitime l‘œuvre
bien plus que le résultat produit. Cette conduite des années cinquante est
largement inspirée d‘une conception de l‘artiste romantique. Il est à noter que le
contexte romantique est justement le XIXe siècle qui amorce la mise en péril de
l‘Académie (mise en péril multifactorielle du reste). La figure d‘un artiste en lutte
avec lui-même, bataillant corps et âme pour s‘exprimer par son art voilà les
reliquats de l‘expressionnisme abstraitv. Cette mythologie d‘un artiste s‘exprimant
est largement nécessaire face à la capitulation des conventions académiques car
elle postule un fondement à l‘individu, elle invente une identité solide et
immuable face à la perte des repères et modèles sociaux : elle stabilise ce qui
sinon n‘a plus aucune limite, elle donne sens, elle organise.
L‘homme de l‘époque moderne, souligne Foucault (1966), est soumis à un choix
infini de possibles de vies. A partir de la fin du XVIIIe siècle, l‘homme se
construit de plus en plus comme individu – révolutions politiques et industrielles.
Mais cette individualisation s‘accompagne d‘une compactification d‘une société
construite sur l‘anonymat et l‘indifférenciation. Ainsi, l‘homme acquiert-il une
autonomie : il est moins dépendant de normes sociales, mais, contrepartie de ce
plus de démocratie, sa vie se met à dépendre de lui seul, il n‘a plus de structure
extérieure à qui s‘en remettre pour définir ce qui le constitue comme individu.
Exact parallèle, en art, de ce que produit la fin de l‘Académie, engendrant une
perte de repères qualitatifs. En d‘autres termes, l‘homme a alors la possibilité de
choisir ce qui le constitue. Qu‘aucune norme ne soit infligée de l‘extérieur soumet
l‘individu à la difficulté suivante : comment définir ce qui détermine sa propre
identité ? Warhol nous rappelle, avec l‘habituelle ambiguïté de ses expressions,
que le seul apte à comprendre un individu serait un ordinateur fait sur mesure :
« A moins d'avoir un métier où il faut faire ce qu'un autre vous dit de faire, la
seule ―personne‖ qualifiée pour vous servir de patron serait un ordinateur pro-
grammé tout exprès pour vous, qui prendrait en considération vos finances, vos
préjugés, vos caprices, votre potentiel d'idées, vos accès de colère, vos talents,
vos conflits de personnalité, votre taux de croissance souhaité, le niveau et la nature
de la concurrence, ce qu'il faut manger au petit déjeuner le jour où vous devez
remplir un contrat, de qui vous êtes jaloux, etc. Il y a beaucoup de gens qui
pourraient m'aider dans divers secteurs de mon travail, mais seul un ordinateur me
serait totalement utile » (Warhol, 2001, pp. 84-85).

Marion Delecroix
L’asthénie du peintre : quête d’identité dans la vidéo Painter de Paul McCarthy
4
Cette autonomie croissante d‘un individu spécialiste de lui-même a pour corollaire
une auto-prise en charge. Ce double changement se remarque aussi, selon
Ehrenberg (2000), par une multiplication, au XXe siècle, des techniques de
développement de soi-même, d‘amélioration de sa personnalité etc., sous
différentes formes qui vont de la secte à la psychothérapie en passant par la
macrobiotique et le yoga. McCarthy intègre l‘expérience artistique à ces pratiques,
intégration d‘ailleurs pas tout à fait incongrue puisqu‘on peut constater la
popularisation des ateliers de pratiques artistiques prônant à la fois une maîtrise
technique (proche d‘une conception artisanale) et l‘expression de son for
intérieur : « soyez vous-même ». McCarthy fabrique un artiste qui expérimente
jusqu‘où on peut aller trop loin en suivant cet adage.
La vidéo Painter s‘articule autour de trois lieux : l‘atelier, le bureau du marchand
de tableaux et un plateau de télévision. Ces trois lieux ne se succèdent pas dans le
montage mais s‘entrecroisent ; il ne s‘agit ni d‘étapes dans la création ni de
moments bien différents les uns des autres. Le peintre est toujours vêtu de la
même blouse et ces trois lieux participent de la même construction d‘une figure de
l‘artiste. Dans le talk-show, McCarthy met en scène une récurrence de l‘individu
contemporain : il s‘expose et doit s‘exposer ; la caractéristique du sujet
contemporain est une perte d‘équilibre, analysée par Ehrenberg, entre privé et
public. L‘expression du for intérieur vient sur la scène et fait partie de notre
vocabulaire, elle sert à chacun à dire quelque chose de lui-même. L‘individu,
souligne Ehrenberg, ne doit pas être compris sous l‘angle du stéréotype qui
voudrait que l‘affirmation de soi détache l‘individu de la société. « L‘individu est
une construction instable et contradictoire de soi dans la relation à autrui »
(Ehrenberg, 2000, p. 311). Ainsi Ehrenberg succède-t-il aux intentions théoriques
d‘Elias (1998) qui déconstruit une relation bipolaire entre individu et société pour
affirmer l‘impossible compréhension de l‘un sans l‘autre.
La gloire du peintre de McCarthy satisfait à l‘intuition de Warhol : l‘émission de
télé-réalité, celle où chacun peut avoir son quart d‘heure de gloire. Invité d‘un
talk-show avec un couple qui décrit ses problèmes de couple, le peintre est comme
décontextualisé. Non seulement c‘est le couple qui passionne les foules, mais le
peintre, comme un morceau désuet, un rappel de l‘ancien monde, s‘ennuie. Sa
présence dans le talk-show le remet à sa place : à la télévision, en habit de peintre
et couvert de peinture, il se montre, comme peintre, et ce qu‘il a à dire, c‘est ce qui
« sort de lui » : le peintre s‘exprime dans son atelier comme le couple s‘expose
dans la télé-réalité. L‘exhibition, dans un talk-show, de ses problèmes (de couple),
de l‘intime dans un cadre public, selon Ehrenberg, pose le problème suivant : les
individus n‘ont plus de places précises et assignées et une telle exposition
publique leur permet de donner sens à leur existence, par la formulation explicite
et ordonnée du for intérieur. Leur existence ne s‘articule pas grâce à l‘existence
commune, grâce à une loi extérieure, une convention sociale, mais par elle-même,
grâce à une mise en scène singulière. Les reality-shows permettent à Ehrenberg de
mesurer la façon dont le handicap – c'est-à-dire la singularité – désigne le mode
d‘existence de l‘individu contemporain. « A l‘heure des médias dominants, celui
qui ne sait pas représenter, ni communiquer son histoire est un individu fantôme »
(Ehrenberg, 1999, p. 200). La télévision permet de redonner du sens, de la
cohérence :
« Si nous interprétons rarement ce qui nous arrive sous l‘angle du romanesque, le
transport d‘un événement personnel à l‘écran transforme la définition de cette
situation : ces vies remplissent les conditions pour être romanesques, tant pour le
public que pour les participants, tout simplement parce qu‘elles sont vues par un
public, et donc organisées comme un récit fourmillant de sens, au lieu de rester
dans le secret du privé, sous la forme de morceaux épars aux significations
confuses qu‘est la vie au quotidien ; parce qu‘elles ont gagné en visibilité en étant
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%