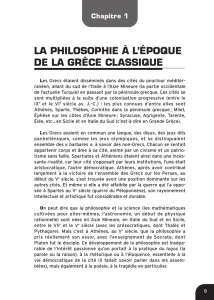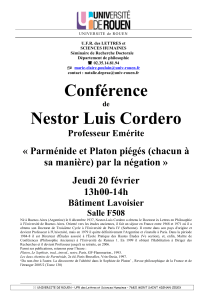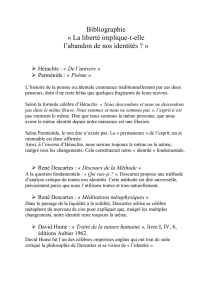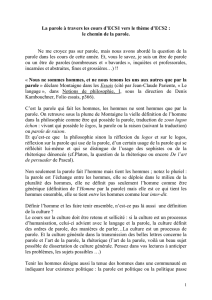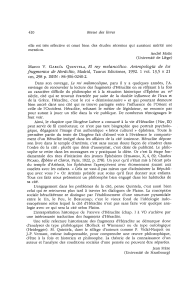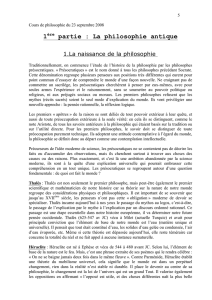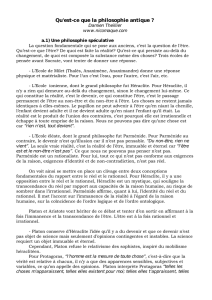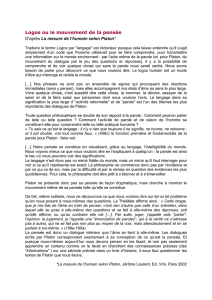TEGUEZEM Joseph

Mobilité et fixité : de l’intelligibilité métaphysique
à la possibilité d’une créativité humaine
TEGUEZEM Joseph
Université de Dschang
Résumé :
Contredisant Héraclite pour qui la mobilité est l’étoffe de toute chose,
Parménide affirme que l’être est originellement ordonné à une stabilité
ontologique et épistémologique. Platon en vient à les concilier en montrant que
la mobilité participe de la fixité ; celles-ci étant respectivement le pôle sud et le
pôle nord de la recherche. Il est cependant nécessaire de déplacer ces notions de
leur socle métaphysique vers un terrain où l’homme s’affirme comme fondement
et mesure de toute chose. C’est à cette condition que la mobilité et la fixité
deviennent humainement créatrices. L’ouverture prudente du chercheur au reste
du monde apparaît alors comme une composante essentielle de la mobilité
créatrice dont la perspective téléologique est une sorte de fixité virtuelle.
Mots-clés :
Mobilité, fixité, créativité, métaphysique, humain.
Abstract:
By opposing himself to Heraclitus, for who mobility is the substance of
everything, Parmenides affirms that being is originally ordered to an ontological
and epistemological stability. Plato comes to reconcile them by showing that
mobility participates of fixity; these notions are respectively the South Pole and
the north pole of research. Nevertheless, it is necessary to move them from their
metaphysical basis to a ground where human being affirms himself as basis and
measure of everything. It is so, that theses notions become humanly creative.
Therefore, the cautious connection of the researcher to the rest of the world
appears as the essential components of the creative mobility about what the
teleological perspective is a kind of virtual fixity.
Key words:
Mobility, fixity, creativity, metaphysics, human being.

Pour comprendre le concept de mobilité, il
est nécessaire de comprendre la situation
philosophique dans laquelle nous sommes dès
que nous abordons cette notion1.
Introduction
Le monde contemporain est le théâtre d’une mobilité sans
pareille. L’humanité aura, sans doute, compris que c’est tuant d’être
immobile, d’être toujours au même endroit à observer et à
reproduire les mêmes choses. La téléologie d’une telle mobilité est,
avant tout, de « donner au [chercheur] la capacité de briser, de
transgresser les frontières et les compartiments de plus en plus clos
entre les différents domaines du savoir2». Sous les effets conjugués
de la technoscience et des nouvelles technologies de l’information
et de la communication, il est désormais possible de se retrouver
partout dans le monde, d’effectuer facilement des déplacements,
des échanges, d’acquérir rapidement des savoirs et des biens de
consommation divers. Nous sommes, on le voit, dans un monde
où tout est en mouvement et en création. Sur le plan scientifique, la
puissance du chercheur gît dans la mobilité et la promesse de
créativité qui l’accompagne. Parce qu’il bénéficie d’une réduction
de distance entre ses pairs et lui, le chercheur peut aisément
participer aux séminaires, tables-rondes, colloques internationaux ;
organiser des conférences et des enseignements à distance dans un
univers où la déterritorialisation tous azimuts est devenue un
nouveau paradigme culturel, politique et économique. Sous
l’impulsion de cette mobilité impressionnante, le chercheur,
nonobstant l’errance vagabonde qui le guette et le risque
permanent de désagrégation auquel il est culturellement exposé,
affiche une assurance intellectuelle : il expose son savoir et rédige
les rapports d’expertise. Comme l’homme « mesure de toute
chose » de Protagoras, le chercheur est devenu la mesure de toute
mobilité culturelle. C’est, sans doute, le regain de l’héraclitéisme :
1 Bertrand Vergely, « L’homme de la mobilité », in http : //1 libertaire.free.fr /
Vergely01.html (consulté le 11/03/2014).
2 Boris Cyrulink et Edgar Morin, Dialogue sur la nature humaine, Bulgarie,
Editions de l’Aube, 2010, p.65.

tout bouge, tout coule, tout se bouscule et rien ne demeure fixe. La
créativité elle-même est soumise à la mobilité des cultures et des
savoirs, n’en déplaise à Parménide pour qui c’est paradoxalement la
stabilité qui en garantit le succès. Sur ces entrefaites, la mobilité
contraste avec la fixité, quant aux conditions de possibilité de la
créativité. Tout le problème revient à savoir s’il faut fonder la
créativité sur une mobilité de type héraclitéenne ou, plutôt, sur une
fixité de type parménidienne. Entre la mobilité et la fixité, somme
toute métaphysiques, qu’est-ce qui constitue fondamentalement
l’Être créatif ? Il est question de savoir s’il faut adosser la créativité
sur ce qui bouge sans cesse ou, au contraire, sur ce qui est
rigoureusement stable et éternel. Pour Platon, le problème ne se
pose pas tellement en termes du choix exclusif de l’un ou de l’autre
paradigme fondateur, mais en termes d’intégration des deux dans
un même processus créateur. Mais, abandonnées dans leur
structure métaphysique, la mobilité et la fixité rendent-elles possible
une créativité dont l’homme est le fondement et la mesure ? En
d’autres termes, pour que la mobilité et la fixité constituent de
véritables vecteurs de la créativité humaine, ne faudrait-il pas, au
préalable, les démétaphyser ? Par ailleurs, impliquant l’ouverture et
la connexion enrichissantes du chercheur au reste du monde, la
mobilité ne demeure-t-elle pas potentiellement symptomatique de
la désagrégation du noyau identitaire de ce dernier ?
Pour répondre à ces questions, nous montrerons, d’abord, que
la mobilité et la fixité sont, respectivement chez Héraclite et
Parménide, des réalités hétérogènes et fondamentales à partir
desquelles ils expliquent le monde ; et qu’elles sont même, pour
Platon, deux paradigmes gnoséologiques et ontologiques dont
l’opposition structurelle rend possible l’intelligibilité de la créativité
philosophique (I). Nous relèverons, ensuite, le caractère
métaphysique de ces notions, à l’effet de mettre en exergue la
dimension immuable et liberticide du monde qu’elles impliquent
(II). Nous montrerons, enfin, que pour que la mobilité soit un
mouvement créateur dont l’homme est le fondement et la mesure,
il faut, et c’est aussi le cas pour la fixité, la débarrasser de sa coque
métaphysique et considérer le repos, l’ouverture et la connexion
prudente des chercheurs, comme des éléments vitaux de la
créativité (III).

I-Mobilité et fixité comme réalités fondamentales
Le questionnement sur la réalité la plus fondamentale et
fondatrice, qui préexisterait à la diversité des êtres dans la nature, a
conduit, tour à tour, les présocratiques, généralement appelés
physiciens, à une conception toute aussi plurielle que paradoxale
de cette réalité. Nul doute que, dans leurs démarches respectives,
l’intention de chaque physicien était de saisir radicalement les
choses et l’homme avant toutes considérations métaphysiques ou
théologiques, « l’idée d’un dieu créateur de la nature ex nihilo
(comme dans la Genèse de la Bible) [étant] étrangère à l’esprit
philosophique des Grecs.3 De tous les physiciens présocratiques,
Héraclite d’Éphèse et Parménide d’Élée apparaissent, à notre avis,
comme ceux qui ont le plus tranché sur la détermination de la
substance fondamentale et unificatrice de tous les êtres. Pour le
premier, c’est le mouvement (la mobilité) ; pour le second, c’est l’Être
(la fixité). En quoi consistent alors la mobilité et la fixité ?
1.1
L’approche héraclitéenne du mouvement / de la
mobilité
Héraclite fait du mouvement /de la mobilité l’Être fondamental
qui crée et gouverne tout ce qui existe au monde ; qu’il s’agisse des
choses, des animaux ou des hommes :
Considéré comme le philosophe du
mouvement, le philosophe du panta rei : ‘‘tout
s’écoule’’ […], Héraclite, écrit Abel Jeannière, va
examiner le mouvement en lui-même,
indépendamment de telle ou telle réalisation ; il est
pénétré de l’idée que le mouvement c’est l’être,
puisqu’il explique tout. Tout est phénomène d’une
même réalité. [Et] pour retrouver l’identité des êtres
qui nous apparaissent qualitativement, il faut les voir
non fixés, les rétablir dans le courant modèle qui les
3Gilbert Hottois, De la Renaissance à la modernité. Une histoire de la philosophie
moderne et contemporaine, Coll. Le point philosophique, Bruxelles, De Boeck
Université, 1997, pp.13-14.

crée et les supporte, [c’est-à-dire dans le
mouvement/la mobilité].4
Dans cette perspective, la diversité des êtres est d’ordre qualitatif
et non substantiel / essentiel. Les êtres sont, certes, multiples du
point de vue de leurs qualités, mais ils sont un du point de vue de
leur essence. Et le mouvement est cette essence qui assure leur
unité contre leur éparpillement hétéroclite: rien n’échappe au
mouvement ; même les choses apparemment stables sont
essentiellement changeantes, puisqu’elles tirent leur origine et leur
existence du mouvement. Mais alors, en se posant comme la source
et ce qui assure la vie des choses, le mouvement héraclitéen a-t-il
lui-même un fondement qui le transcende ? Il a, en effet, des traits
ontologiques forts remarquables qui, de toute évidence, n’indiquent
rien qui lui soit supérieur. La préséance, la permanence, l’identité (la
mêmété), la vigueur, la rapidité et la créativité en sont les attributs
essentiels. La permanence consiste dans son écoulement perpétuel,
puisqu’il ne peut s’arrêter sans se perdre comme mouvement,
c’est-à-dire sans se transformer en repos. La métaphore du fleuve, à
laquelle Héraclite fait recours, est assez significative :
On ne peut pas, dit-il, descendre deux fois dans
le même fleuve, ni toucher deux fois une substance
périssable dans le même état, car, à cause de la
vigueur et de la rapidité du mouvement, elle se
disperse et se réunit, ou plutôt ni à nouveau ni après,
c’est en même temps qu’elle se constitue et qu’elle se
retire, qu’elle survient et qu’elle s’en va.5
Cette métaphore illustre, on le voit, de façon pertinente, la
continuité du mouvement tout en relevant que cette continuité est
telle que le mouvement ne saurait conduire à un être stable.
L’impossibilité dans laquelle il se trouve à déboucher sur un être
immuable s’explique par le fait que, chez Héraclite, toute évasion
hors du mouvement est purement inconcevable: tout naît du
mouvement et n’existe que par et dans le mouvement. Sa vigueur
4 Abel Jeannière, Les Présocratiques. L’aurore de la pensée grecque, Paris,
Éditions du Seuil, 1996, p.114.
5 Héraclite, fragment.4112, cité par Abel Jeannière, Les Présocratiques.
L’aurore de la pensée grecque, ouvr. cité, p.114.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
1
/
39
100%