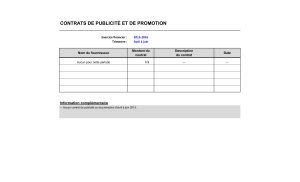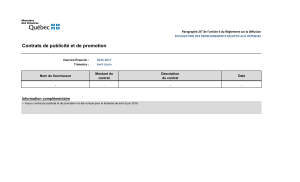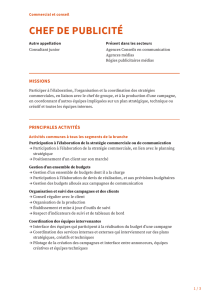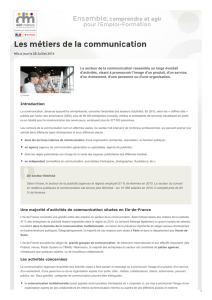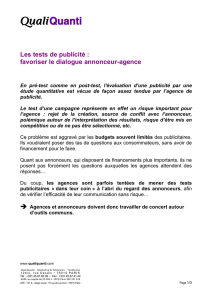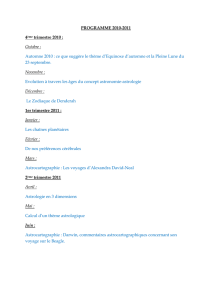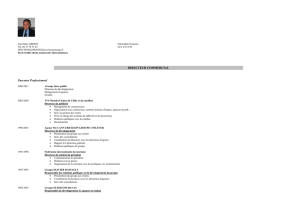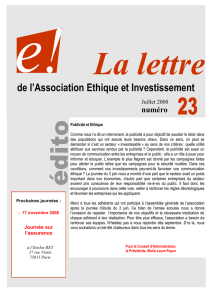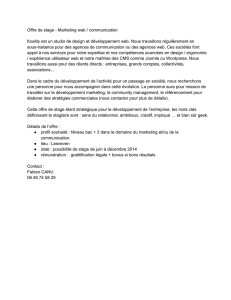Communication et industrie graphique

dossiers sectoriels 2009
Communication et
industrie graphique
en Midi-Pyrénées
En 2008, les dépenses de communication se sont élevées en
France à 32,4 milliards d’euros. Ce montant, en baisse de 1,4 %
par rapport à 2007, représente près de 2 % du PIB national.
Rapporté aux 243 milliards d’euros d’investissements engagés
par les entreprises et les administrations la même année, il
démontre l’inuence motrice du marché de la communication
dans l’économie.
Au delà de leur volume, les dépenses liées à ce marché sont
emblématiques parce qu’elles reètent, ou précèdent, les va-
riations du cycle de croissance économique. La lière commu-
nication et industrie graphique est particulièrement sensible
aux retournements conjoncturels. En l’occurrence, un dirigeant
sur deux prévoit de différer des investissements initialement
prévus en 2009. Or, près du tiers de ces dépenses concernent
le marketing et la communication.
La lière est ainsi composée en grande partie d’activités jouant
le rôle de variables d’ajustement en période de basse conjonc-
ture. Elle est de plus soumise à des phénomènes structurels,
actuellement à l’œuvre et inhérents à l’essor des nouvelles
technologies et de la convergence multimédia, qui entraînent
un véritable changement de paradigme au croisement des
télécommunications, de l’audiovisuel et de l’informatique.
Cette publication vise à connaître les spécicités et les potenti-
alités de la lière en Midi-Pyrénées, sur une activité historique-
ment concentrée en région parisienne.
> 2 000 établissements
> 10 000 salariés
> 90% d’entreprises
de moins de 10 salariés
> Évolutions sur 3 ans :
établissements + 10 %
effectifs - 2 %
Les plus gros employeurs
de la lière en Midi-Pyrénées
médias et supports
de communication, 950 salariés
médias et supports
de communication, 400 salariés
médias et supports
de communication, 350 salariés
médias et supports
de communication, 200 salariés
médias et supports
de communication, 200 salariés
conseil en communication, 200 salariés
médias et supports de communication,
200 salariés
industrie graphique,
plus de 100 salariés
industrie
graphique, 100 salariés
médias et supports
de communication, 101 salariés

La lière Communication/Industrie graphique est étudiée dans
les pages suivantes à travers 3 segments : Conseil en com-
munication, Médias et supports de communication, Industrie
graphique (la composition de chacun de ces 3 segments est
détaillée en méthodologie).
Sur l’ensemble de la lière, on compte, au 1
er
janvier 2009, 1962
établissements inscrits dans les CCI de Midi-Pyrénées. Ces éta-
blissements représentent un effectif de plus de 10 000 salariés.
Les entreprises de la lière sont très majoritairement inscrites
en société (pour 87 % d’entre elles dont la plupart des Sarl) et
possèdent moins de 10 salariés (dans 90 % des cas).
Les professions libérales sont faiblement représentées : moins
de 200 sur la région. Les « freelances », très présents dans le
milieu du graphisme, interviennent comme soutien de produc-
tion ou compétences ponctuelles. Bien que difcile à évaluer,
leur poids est loin d’être négligeable.
Dans le conseil, la communication/publicité ne pèse que 5 % des
effectifs salariés et est composée essentiellement de petites
structures. Avec près de 400 nouvelles inscriptions en 2008, la -
lière reste dynamique, même si ce dynamisme est inégalement
réparti et se concentre principalement sur la Haute-Garonne.
Parallèlement, le nombre de cessations est également en aug-
mentation, le nombre d’établissements n’a ainsi pas augmenté
en 2008. Si cette stagnation est cette fois-ci homogène territo-
rialement, on note des évolutions différentes entre les activités
de la lière. En effet, les agences de communication au sens
large ont continué à être plus nombreuses en 2008 alors que
les imprimeurs marquent nettement le pas.
La proportion des établissements intervenant dans la commu-
nication est nettement plus forte en Haute-Garonne que dans
les autres départements, le Gers et les Hautes-Pyrénées se
révélant les moins bien pourvus, alors que le Tarn et l’Aveyron
résistent bien grâce à une forte implantation des imprimeurs.
Au niveau des volumes d’affaires générés par les entreprises de
plus de 10 salariés de la lière, la tendance est à la baisse. Les
enquêtes de conjoncture des entreprises de Haute-Garonne
différencient nettement les tendances des entreprises de servi-
ces, plutôt bien orientées ces dernières années, et les tendances
des industries traditionnelles plutôt orientées à la baisse. Dans
une lière très inuencée par la conjoncture, les inquiétudes
des imprimeurs sont partagées par les agences de publicité et
de communication.
Les exportations concernent surtout la partie industrielle de la
communication. Elles ne cessent de décroitre depuis 2003 en
lien avec la montée de la concurrence internationale subie par
les imprimeurs. Cette tendance s’est encore ampliée cette
année avec la crise persistante de la presse et touche ainsi les
produits de l’édition.
L’évolution de l’emploi salarié dans la lière est assez défavo-
rable ces dernières années, surtout dans l’imprimerie. La crise
actuelle accentue cette tendance.
On peut par exemple penser que les agences de communi-
cation feront moins appel aux « freelances » comme support
de production. On note de plus que les entreprises éprouvent
des difcultés à pourvoir qualitativement certains postes spé-
ciques. Les tensions sur le marché de l’emploi devraient s’in-
tensier dans les mois à venir, car les annonceurs modieront
vraisemblablement leur comportement. Les marges des publi-
citaires pourraient alors s’éroder.
La lière
en Midi-Pyrénées
Ariège 64 157
Aveyron 139 855
Haute-Garonne 1149 6984
Gers 99 206
Lot 97 342
Hautes-Pyrénées 102 493
Tarn 186 1039
Tarn-et-Garonne 126 476
Source : OBSéco – RCS ; données au 1
er
janvier 2009
4
ème
trimestre
2005
1
er
trimestre
2006
2
ème
trimestre
2006
3
ème
trimestre
2006
4
ème
trimestre
2006
1
er
trimestre
2007
2
ème
trimestre
2007
3
ème
trimestre
2007
4
ème
trimestre
2007
1
er
trimestre
2008
2
ème
trimestre
2008
3
ème
trimestre
2008
4
ème
trimestre
2008
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
Source : OBSéco – RCS - Base 100 au 4
ème
trimestre 2005
Total Midi-Pyrénées Filière Communication
et Industrie Graphique
LOT : 14,3 ‰
AVEYRON : 12,9 ‰
TARN : 14,6 ‰
TARN-ET-GARONNE :
16,3 ‰
GERS : 13,5 ‰
HAUTE-GARONNE :
25,3 ‰
ARIÈGE : 12,8 ‰
HAUTES-
PYRÉNÉES :
11,6 ‰
Source : OBSéco – RCS ; données au 1
er
janvier 2009

En Midi-Pyrénées, cette offre est plus atomisée, composée
essentiellement de petites structures accompagnées par quel-
ques liales ou représentants de grands groupes. Aux registres
des commerces et des sociétés, on dénombre 640 établisse-
ments et 2846 salariés dans la région au 1
er
janvier 2009. Plus
des deux tiers sont situés en Haute-Garonne, particulièrement
dans l’agglomération Toulousaine.
Durant les 3 dernières années, le nombre d’établissements a
progressé de 12 % et dans le même temps, les effectifs sala-
riés ont progressé de 15 %. Cette progression est liée au dy-
namisme de petites structures qui bénécient d’une certaine
souplesse à l’entrée sur le marché. Il est néanmoins difcile
pour les nouveaux entrants de se faire une place, compte tenu
du mode de concurrence en vigueur dans le domaine, plutôt
basé sur la notoriété et l’image de marque de la société, résul-
tant de ses références.
Une partie de ces entreprises essaie de se différencier par les
prix et répondent notamment aux appels d’offres des organis-
mes institutionnels de la région. Le critère prix est de façon gé-
nérale moins prépondérant dans le régime de concurrence, les
budgets des clients se décidant le plus souvent en amont de la
recherche précise de prestations. Le dynamisme entrepreneu-
rial témoigne néanmoins de la présence d’une forte demande
locale. C’est d’ailleurs en local que se positionne l’essentiel du
marché. Seules les grosses agences spécialisées ou représen-
tantes locales de grands groupes peuvent répondre à des ap-
pels d’offre nationaux.
Le marché potentiel est très vaste. Les dépenses de communi-
cation chez les annonceurs sont évaluées à 32 milliards d’euros
au niveau national. Celles-ci ont d’ailleurs augmenté de 10%
depuis 2000. Cette hausse est largement portée par l’essor de
la communication et du marketing interactifs. On observe toute-
fois un tassement de ces dépenses en 2008 et les perspectives
pour 2009 sont encore moins réjouissantes.
Les premiers signes perçus en 2009 laissent aussi penser que
les difcultés dans l’industrie graphique et dans la presse vont
s‘accélérer. Une meilleure coopération pourrait apporter une
réponse adéquate à la crise.
Il s’agit des agences de publicité et agences de communica-
tion chargées de concevoir et de réaliser le message du client.
Ces entreprises peuvent intervenir de façon très globale, sur la
stratégie marketing et commerciale du demandeur ou de façon
plus ciblée sur une campagne publicitaire par exemple.
Elles participent ainsi à un ou plusieurs volets de la communi-
cation de l’entreprise, qu’elle soit stratégique, de crise, ou com-
merciale. Elles assurent également les campagnes marketing,
les relations presse, la communication interactive…
Ces différents niveaux d’intervention permettent ainsi soit
l’éclosion de niches soit, plus rarement, l’existence d’offre
globale.
En matière règlementaire, les agences de publicité sont soumi-
ses au principe de protection de la création publicitaire, à la
réglementation de la publicité (récemment modiée dans le
domaine audiovisuel par l’interdiction des annonces après
20 heures sur le service public), et aux dispositions en faveur
de la protection du consommateur.
En France, le marché des agences est plutôt dominé par une
offre concentrée où les entreprises de plus de 50 salariés gé-
nèrent un tiers du chiffre d’affaires global des agences. Par
ailleurs, ces agences sont concentrées en Ile de France où près
de la moitié des établissements français et 60 % des effectifs
salariés sont implantés.
Conseil
en communication
114
112
110
108
106
104
102
100
4ème trimestre
2005
1er trimestre
2006
2ème trimestre
2006
3ème trimestre
2006
4ème trimestre
2006
1er trimestre
2007
2ème trimestre
2007
3ème trimestre
2007
4ème trimestre
2007
1er trimestre
2008
2ème trimestre
2008
3ème trimestre
2008
4ème trimestre
2008
Source : OBSéco – RCS - Base 100 au 4
ème
trimestre 2005
Conseil en communication Total Midi-Pyrénées
Filière Communication et Industrie Graphique
LOT : 2 %
HAUTES-PYRÉNÉES : 3 %
TARN-ET-GARONNE : 5 %
AVEYRON: 7 %
TARN : 10 %
HAUTE-GARONNE : 71 %
GERS : 2
ARIÈGE : 1 %
Source : OBSéco – RCS ; données au 1
er
janvier 2009

Au niveau local, les entreprises de Haute-Garonne semblent
avoir plutôt bien négocié l’année 2008. En revanche, les inquié-
tudes sont vives pour 2009, notamment pour les plus petites
structures qui manquent de visibilité. Elles risquent de subir ra-
pidement les effets de la crise économique, le budget commu-
nication étant souvent une variable d’ajustement budgétaire.
Les entreprises peuvent compter sur l’évolution du comporte-
ment des annonceurs qui misent aujourd’hui sur une stratégie
de communication à long terme.
Globalement, on discerne trois groupes stratégiques pour les
agences de conseil en communication :
• les entreprises ayant un positionnement axé sur une stratégie
de différenciation (savoir faire, notoriété, offre globale…) s’arti-
culant autour d’investissement en compétences
• Celles qui adoptent plutôt une stratégie de focalisation pou-
vant favoriser le développement d’une expertise et la prise
d’une niche commerciale.
• Enn les entreprises qui opèrent un mix de ces deux stratégies.
Un quatrième groupe plus marginal existe, il s’agit de « passa-
gers clandestins » qui opèrent une stratégie agressive de domi-
nation par les coûts, peu efcace sur le long terme.
Ce groupe désorganise un marché dans lequel les agences de
communications n’appliquent pas toujours les principes qu’elles
préconisent à leurs clients. Elles sont en effet généralement
assez peu agressives commercialement et peu attentives à
l’évolution de leur concurrence.
Dotée de la deuxième industrie graphique européenne, la Fran-
ce présente un chiffre d’affaires annuel d’environ 9 milliards
d’euros, en baisse toutefois quasi continue depuis les années
2000. Confrontées à une baisse structurelle de la demande sur
certains marchés de l’imprimé liée à l’essor des nouvelles tech-
nologies et de la dématérialisation, ces activités sont directe-
ment touchées par les dégradations conjoncturelles subies par
les annonceurs.
Centré sur l’imprimerie, qui regroupe en Midi-Pyrénées 54%
des établissements et les trois quarts des effectifs salariés, le
segment réunit également les activités de pré-presse (com-
position) et de nition (reliure, brochage, pliage…). Avec près
de 3 000 salariés répartis dans plus de 500 établissements, la
région se positionne au 7
ème
rang national.
Si la Haute-Garonne concentre la moitié des activités, les dé-
partements du Tarn et de l’Aveyron se partagent près de 30%
des effectifs salariés.
L’industrie graphique est le segment technologique de la lière
(rotatives, photogravure…). Elle est impactée par les évolutions
des techniques d’impression, des solutions logicielles et par les
normes environnementales. En amont, elle est également très
dépendante du cours des matières premières, papier en tête
(mais aussi aluminium, minerais…).
Les coûts d’investissements sont très importants, et le taux de
marge brute est deux fois inférieur à la moyenne de l’industrie
manufacturière. Le segment présente une forte intensité en
travail et en capital qui favorise la concentration des établis-
sements, déjà renforcée sur l’ensemble du territoire national
du fait des mouvements de restructuration du secteur et de
la vive concurrence étrangère. Soumise à une inversion de la
pyramide des âges, les entreprises semblent de plus souffrir
d’une relative inadéquation entre les formations traditionnelles
et les postes proposés. Elles ont ainsi des difcultés à attirer
des jeunes, et certaines tentent alors de prospecter au sein des
métiers périphériques.
L’offre de l’industrie graphique en Midi-Pyrénées se caractérise
par la présence d’entreprises de toutes tailles (de la petite im-
primerie traditionnelle au grand groupe généraliste en passant
par la PMI) spécialisées ou non sur des marchés ou des formats
en fonction de leur capacité productive. On dénombre plus
d’une vingtaine de marchés selon les catégories d’imprimés,
dont les plus importants concernent les imprimés administra-
tifs et commerciaux, les listings informatiques (imprimerie en
continu) et les imprimés et afches publicitaires. Les entrepri-
ses proposent ainsi des prestations plus ou moins riches à partir
d’un contenu fourni, selon les procédés et les services complé-
mentaires qu’elles maîtrisent (produits publicitaires complexes,
imprimerie numérique, travaux de composition…). Leur offre
devient alors globalisée et leur valeur ajoutée augmente, ce
qui facilite la délisation de la clientèle, gage de pérennité
pour les entreprises.
La concurrence par les prix, assez forte, est une option essen-
tiellement retenue par les entreprises non spécialistes, ou ne
proposant pas d’offre globalisée ou de bouquets de prestations.
Elles constituent la majorité des entreprises du secteur, et cette
stratégie s’intensie en période de basse conjoncture, avec une
pression importante sur les salaires et les investissements. Cer-
tains dirigeants préfèrent se différencier par une offre complè-
te, ou encore focaliser leurs activités sur un type de formats ou
de produits (concurrence hors prix). Les entreprises régionales
subissent de manière croissante la concurrence spécique des
industriels espagnols et italiens, et, bien sûr, celle de la Chine
sur les tirages à gros volume.
Industrie graphique
Source : Obséco - RCS
Autre imprimerie
(labeur) : 65 % Activités
de pré-presse : 23 %
Reliure et
activités connexes : 2 %
Imprimerie
de journaux : 10 %

Ce segment regroupe les entreprises chargées principalement
de diffuser, directement ou indirectement, le message conçu
et réalisé par les autres acteurs de la lière. Globalement, elles
se répartissent entre, d’un côté, les activités liées aux médias
(presse, télévision, radio, Internet, afchage et annuaires) et,
d’un autre côté, le hors-média (marketing direct, organisation
de foires et salons, promotion et sponsoring). Une large pro-
portion d’entreprises ont notamment pour fonction de mettre à
disposition des espaces de communication, prestation pouvant
intégrer, dans certaines régies, une partie conseil.
Au niveau national, les régies médias ont enregistré en 2008
près de 11,5 milliards d’euros de recettes publicitaires, soit une
baisse de 2,2% sur un an. Si la presse et la télévision enregis-
trent 70% de ce montant, la publicité sur Internet afche sur
les derniers exercices de très forts taux de croissance. En Midi-
Pyrénées, ces activités représentent au 1
er
janvier 2009 plus de
800 établissements et près de 5 000 salariés, dont respective-
ment 59% et 72% localisés en Haute-Garonne.
L’édition (presse, télévision, radio…) et les régies publicitaires
concentrent près des 2/3 des établissements et plus des 3/4 de
l’emploi salarié. 18 % des établissements se consacrent par
ailleurs à l’organisation de foires, salons professionnels et congrès,
avec un effet d’entraînement majeur pour l’économie du terri-
toire (prestataires de services locaux, tourisme d’affaires…).
L’évolution du nombre d’établissements est positive sur
les 4 dernières années (supérieure à 10 %), à la différence de
l’emploi salarié. Ce dernier souffre des difcultés rencontrées
dans l’édition de journaux et leurs régies publicitaires.
De par les différences fondamentales entre les métiers qui la
composent, l’offre est très hétérogène, le mode et l’intensité
de la concurrence variant selon le moyen de communication.
Historiquement spécialisées par média, les entreprises tendent
à se diversier avec l’essor des stratégies cross médias mise
en place par les annonceurs. Seules les entreprises adossées à
des médias de faible inuence et les petites sociétés spéciali-
sées sur le hors-média, qui sont toutefois les plus nombreuses,
adoptent une concurrence par les prix.
Leur stratégie est alors uniquement liée au prix des espaces,
lui-même dépendant du succès du support de communication.
Certains complètent avantageusement cette option par une po-
litique de différenciation articulée sur une prestation de conseil
marketing (notamment autour du ciblage et de la stratégie
média).
La stratégie de la lière
Chaque segment est théoriquement susceptible d’être sollicité
directement par le demandeur. Néanmoins, les entreprises de
chaque segment sont souvent étroitement liées dans le but de
satisfaire la demande du « communiquant ».
Au centre des besoins de ce dernier, la conception et la réali-
sation du message est assurée par les entreprises de conseil.
Celles-ci ont alors la possibilité de recourir aux professionnels
de l’industrie graphique (et donc à leurs fournisseurs et par-
tenaires) soit en tant que sous-traitant opérationnel, soit en
tant que soutien à la réalisation. Une fois le message construit,
l’agence s’adresse à un ou plusieurs organes de diffusion du
message (généralement une régie) directement ou par l’inter-
médiaire de sociétés spécialistes (agences médias). C’est par-
ticulièrement le cas dans le cadre du marché publicitaire, dont
les bornes et les rouages sont clairement identiés à l’intérieur
de la lière.
Ce mode de fonctionnement très classique tend aujourd’hui à
évoluer du fait de la volonté des acteurs de répondre à des
marchés plus importants ou plus complexes, et des stratégies
qu’ils mettent en place à cet effet. Ainsi, les rapprochements
ou les relations de partenariats entre les entreprises se sont
multipliés ces dernières années. Il s’agit pour l’entreprise d’at-
teindre une taille critique, ou de proposer une offre globalisée
de prestations complémentaires.
Pour répondre aux appels d’offres, des coopérations s’installent
entre acteurs. Une mise en commun des compétences peut par
exemple être adoptée entre deux ou plusieurs entreprises
de conseil en communication. Midi-Pyrénées a été le théâtre
de plusieurs opérations de ce type ces derniers mois : fusions
d’agence de communication et d’agence web, absorption
d’agence de relations presses par des agences globales,
adossement d’agences régionales à de grands groupes inter-
nationaux…
Mais ce type de rapprochement peut également concerner des
entreprises de segments différents, à l’instar des premières
Médias et supports
de communication
Édition (presse, TV, radio...) 327 41 % 2 332 48 %
Production de lms 78 10 % 215 4 %
Portails internet 28 3 % 33 1 %
Activités des agences 18 2 % 123 3 %
de presse
Autres services 25 3 % 352 7 %
d’information
Régie publicitaire 183 23 % 1 480 30 %
de médias
Organisation de foires 147 18 % 347 7 %
et salons
Source : OBSéco – RCS
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%