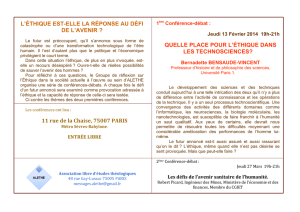Forros (curvas) - Instituto de Investigaciones Jurídicas

SERVICE PUBLIC «A LA FRANCAISE» A LA RECHERCHE
D’UNE ETHIQUE PERDUE
Jacqueline MORAND-DEVILLER1
SUMARIO: I. Un mythe fondateur: la politique
solidariste. II. Un mythe hypertrophie: l’ethique trahie.
III. Un mythe mobilisateur: l’ethique retrouvee.
1. Le concept du service public est le thème qui a le plus
inspiré la doctrine et la jurisprudence, ce qui s’explique par
la séduisante dimension conceptuelle et éthique qui le
caractérise.
Le service public «à la française»2 est en crise et ce n’est
pas la première fois.3 La crise actuelle est cependant plus
grave que les remises en cause du passé car elle touche à
ses fondements c'est-à-dire à ce qui faisait sa force et qui est
devenu de plus en plus vulnérable: son éthique.
Cette crise a pour origine l’ignorance par l’Union
européenne du concept français de service public, concept
trop abstrait pour une communauté fondée sur le
libéralisme économique qui lui préfère la notion plus réaliste
mais tellement plus étroite de «service d’intérêt économique
général».
Toute crise est salutaire, pour l’homme, les systèmes et
les sociétés car elle incite à réfléchir sur les causes, à faire
une auto-critique, à engager d’utiles réformes La réflexion
sur la crise du service public et sur l’éthique qui le
caractérisait pourrait s’ordonner autour de l’idée selon
laquelle le service public est un mythe, une fiction
juridique dont la caractéristique est à la fois son artificialité
1 Doyen honoraire Professeur agrégé de droit public à l’Université Paris-I
Panthéon-Sorbonne.
2 L’expression, parfois discutée mais passée dans le langage courant, est
retenue dans le rapport présenté par M. Denoix de Saint Marc, vice
président du Conseil d’Etat sur «Le service public», La documentation
française, 1996.
3 « Service public, services publics. Déclin ou renouveau ? telle était
l’interrogation posée par une étude que le Conseil d’Etat consacrait au
service public dans son Rapport de 1994.La bible annuelle de la Haute
juridiction a plusieurs fois par la suite abordé ce thème 3, ce qui témoigne
de l’actualité du sujet et de l’intérêt qu’il suscite.
www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx
DR © 2007. Asociación Internacional de Derecho Administrativo

JACQUELINE MORAND-DEVILLER
204
et sa nécessité. Le service public est un mythe fondateur qui
lie éthique et politique (I); c’est un mythe hypertrophié qui
trahit l’éthique (II); c’est un mythe mobilisateur susceptible
d’engendrer une éthique retrouvée (III):
I. UN MYTHE FONDATEUR: LA POLITIQUE
SOLIDARISTE
La conception française du service public est avant tout
d’ordre politique.. Elle s’inscrit dans une aspiration
républicaine solidariste et se manifeste dans une politique
jurisprudentielle qui en fait la «clé de voûte» du droit
administratif.
2. Solidarisme , fraternité, socialisme
3. Dès l’ouverture de la Révolution de 1789, un thème
tient le haut du pavé dans le débat politique, celui de la
fraternité qui prend place aux côtés de la liberté et de
l’égalité dans les grands principes fondateurs, ce que
consacre la célèbre trilogie, rayonnant aux frontons de la
République. Puis la notion s’étiole, mis à part le sursaut de
1848, et n’a que peu d’échos en droit positif, négligée par les
textes et la doctrine, indifférence due sans doute à
l’imprécision de son contenu, plus moral que juridique.
La fraternité est remplacée une notion voisine, sa version
laïcisée et rationalisée, celle de solidarité, qui s’exprimera
fortement sous la IIIème République, lorsque l’intervention
de l’Etat dans la vie sociale se développe. La solidarité
justifie les interventions de plus en plus fréquentes des
personnes publiques en matière économique et sociale, elle
donne lieu à des théories politiques, la plus connue étant
celle du «solidarisme» de Léon Bourgeois. Et elle se
transforme en instrument de pouvoir politique lorsque se
développe le socialisme. La fraternité devrait retrouver une
nouvelle vigueur: souci de «l’autre» en réaction contre
l’individualisme, sens du devoir en complément de la
revendication de droits.4
Le service public est la traduction juridique de ces
concepts. La notion apparaît à la fin du XIXème siècle,
lorsque l’on assiste à une redistribution du rôle de l’Etat et
4 Voir la thèse de M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public
français, LGDJ 1993.
www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx
DR © 2007. Asociación Internacional de Derecho Administrativo

SERVICE PUBLIC «A LA FRANCAISE»
205
que l’on considère que des charges, autrefois individuelles,
sont devenues publiques, ce qui rend possible leur
promotion au rang de «service public».
4. La consécration juridique n’est possible que parce la
notion épouse de fortes aspirations sociales et politiques. Le
service public sert de trait d’union entre les droits abstraits
et les droits réels qui ont besoin d’un certain formalisme
pour occuper le devant de la scène. Jurisprudence et
doctrine se retrouvent sur un terrain particulièrement riche
et l’Ecole du service public fait la gloire de la Faculté de
droit de Bordeaux et de son doyen Léon Duguit. Le rôle de
l’Etat se magnifie, il devient un Etat-providence, fournisseur
de prestations dont bénéficie égalitairement chaque citoyen
et il accède à une légitimité qui l’emporte sur celle de l’Etat
gendarme celui qui réglemente et contraint.
Si l’autre pilier du droit administratif : le critère de la
puissance publique (critère des moyens) conserve toute son
importance, il est relayé par le critère du service public
(critère des fins), plus généreux et unificateur. Alpha et
omega du droit administratif, le service public apporte à la
gestion publique un fondement éthique propre à lui donner
une meilleure cohérence et efficacité.
La force du service public à la française a donc son
origine dans cette dimension politique et éthique qui, parce
qu’elle ne souffre aucune discussion (qui oserait- s’opposer
à cette fraternelle solidarité?) et parce qu’elle ne se prête à
aucune définition juridique précise est aisément
envahissante. Et sa promotion juridique a une cause, plus
précise, l’usage qu’en fit le Conseil d’Etat pour affermir son
autonomie de juge.
2. Service public, droit administratif, juge administratif
5. Le concept de service public «à la française» a son
origine dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. A partir de
constructions intellectuelles d’une grande finesse et
subtilité, il sert à: conforter la place encore fragile de la
Haute juridiction en tant que juge autonome . En faisant du
service public l’un des critères d’identification du droit
administratif il permet l’élargissement de son champ
d’application et du domaine de compétence du juge
www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx
DR © 2007. Asociación Internacional de Derecho Administrativo

JACQUELINE MORAND-DEVILLER
206
administratif.5 La finalité d’intérêt général ouvre de larges
perspectives et la jurisprudence se sert de cette plasticité
pour donner au concept un rôle fonctionnel et opérationnel
déterminant.
Il convient de rappeler la situation du juge administratif
et du droit administratif à la fin du XIXème siècle. En droit,
le Conseil d’Etat n’est que le conseiller du gouvernement,
charge qui lui a été confiée par la Constitution
napoléonienne de l’an VIII, suivant la volonté du prince de
s’entourer d’un corps de techniciens du droit de haut
niveau, dans la tradition des Légistes de l’Ancien régime .Il
lui faudra un siècle pour conquérir son autonomie de juge
qu’il obtiendra du législateur en 1872.6 Si la justice lui était
« déléguée en fait », elle restait « retenue en droit » et le
ministre pouvait avoir le dernier mot. Il lui faudra encore un
siècle pour que sa qualité de haute juridiction
administrative soit constitutionnalisée ( décisions du Conseil
constitutionnel de 1980 et 1987).
Cette survivance du Conseil d’Etat en dépit de la fragilité
de son statut de juge7 est significative de la place occupée
par cette haute Juridiction, en même temps conseiller du
gouvernement , qui est aussi une spécificité française.
6. Juge à part entière, encore fallait-il que soit précisée sa
compétence, c'est-à-dire que soit défini le champ
d’application du droit administratif. Et le service public vint.
Son apparition se constate un an à peine après la
consécration de l’autonomie juridictionnelle du Conseil
d’Etat, c’est le célèbre arrêt «Blanco»8 qui, pour décider que
la responsabilité de l’administration a ses règles spéciales et
son juge particulier, fonde cette spécialité sur la mission de
service public exercée.
Puis, et très rapidement, les «grands arrêts» se succèdent
, venant du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits qui
5 Voir «Le Conseil d’Etat et la fondation de la justice administrative au
XIXème siècle», Textes réunis et présentés par Bernard Pacteau , PUF
Léviathan 2003.
6 Loi du 24 mai 1872, article 9 : «Le Conseil d’Etat statue souverainement
sur les recours en matière contentieuse administrative ».
7 Une loi aurait pu le supprimer en tant que juridiction alors que son
statut de conseiller du gouvernement était, dès l’origine,
constitutionnalisé.
8 Tribunal des conflits 8 février 1973: «La responsabilité qui peut incomber
à l’Etat …par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public…a
des règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité
de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ».
www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx
DR © 2007. Asociación Internacional de Derecho Administrativo

SERVICE PUBLIC «A LA FRANCAISE»
207
imposent le service public comme critère de reconnaissance
de la compétence du juge administratif en matière de
responsabilité de l’Etat et des collectivités locales, ainsi
qu’en matière de contrats administratifs.9 .Les conclusions
des commissaires du gouvernement de l’époque sont sans
équivoque: «Tout ce qui concerne l’organisation et le
fonctionnement des services publics généraux ou locaux …
constitue une opération administrative qui est, par sa nature,
du domaine de la juridiction administrative».10 On ne saurait
être plus péremptoire, à défaut d’être précis, car comment
identifier la présence d’un service public ou d’une «opération
administrative»? Les précisions viendront plus tard et
resteront vagues.
Mais le succès appelle l’excès, le service public
s’hypertrophie et son image se brouille de plus en plus
d’autant que se pratique un amalgame entre la finalité et les
structures. On parle davantage des services publics,
lesquels se multiplient , épousant la mutation d’un Etat de
plus en plus engagé dans des actions sociales, économiques
et culturelles, bientôt rejoint par les collectivités locales et
les établissements publics... Le service public entre en crise.
II. UN MYTHE HYPERTROPHIE: L’ETHIQUE TRAHIE
Le service public à la française, «activité d’intérêt général»
présente un caractère abstrait, ne se prêtant à aucun
définition précise : et un caractère global: c’est à la fois une
finalité, un domaine d’intervention et une structure
administrative, amalgame qui conduit nécessairement à la
confusion: L’éthique elle-même se trouve atteinte car. cette
croissance, mal maîtrisée, conduit à des situation
artificielles parfois paradoxales, le bloc monolithique, unifié
en apparence, camoufle une extraordinaire diversité et
l’ordonnancement rigoureux autour d’un concept devenu
fiction juridique couvre un grand désordre et fragilité: le
colosse a des pieds d’argile et l’éthique est instrumentalisée.
1°) Colosse…
9 Tribunal des conflits 29 février 1908 «Feutry», Conseil d’Etat, 6 février
1903, «Terrier» et 4 mars 1910 «Thérond» Grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Sirey 2005,15 ed. n° 12 et 21.
10 Conclusion Jean Romieu sur l’arrêt «Terrier» précité.
www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx
DR © 2007. Asociación Internacional de Derecho Administrativo
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%