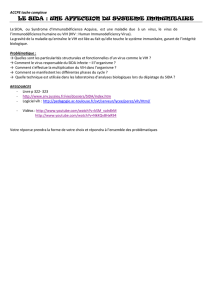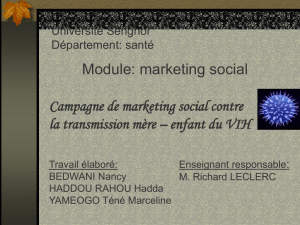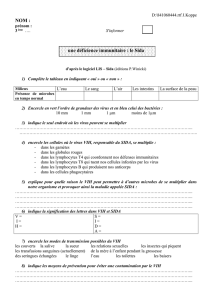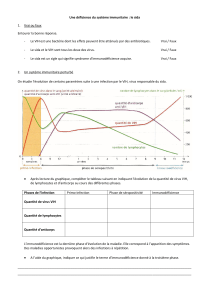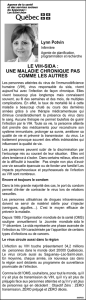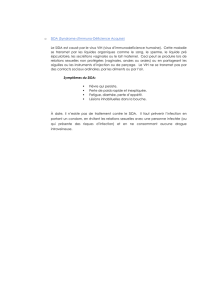sida - Anthony BEAUCHET

VIH
si d a
Infections
Qu’est-ce que c’est ?
Définition
VIH : Le Virus de l’Immunodécience Humaine (HIV en
anglais) est un virus infectant l’homme et aaiblissant
son système immunitaire an de le rendre plus vulnérable
à d’autres infections et maladies. Une personne ayant
contracté le VIH est considérée comme séropositive : elle
peut à son tour transmettre le virus.
SIDA : Le Syndrome de l’ImmunoDécience Acquise
(AIDS en anglais) est le dernier stade de l’infection par le
VIH rendant le corps plus vulnérable à d’autres infections
aggravantes (appelées infections opportunistes), parfois
mortelles.
Quelques chiffres en 2008 (source : INVS / ONUSIDA)
Le VIH/Sida est un problème de santé publique à l’échelle
mondiale. Le 1er décembre s’inscrit comme la journée
mondiale de lutte contre le VIH/Sida et a pour symbole le
ruban rouge.
Dans le monde :
• 33,4 millions de séropositifs.
• 2,7 millions de nouvelles infections.
• 28 millions de morts depuis 1981.
En France :
• 6500 nouvelles infections.
• La majorité des personnes infectées l’ont été
par relations hétérosexuelles et 4/10 l’ont été par
relations homosexuelles.
• 1/3 des personnes découvrant leur
séropositivité sont déjà à un stade avancé de
l’infection.
Dépistage, traitement, vaccin
Le dépistage
Le test de dépistage du VIH peut se faire dans un
centre d’information et de dépistage anonyme
et gratuit (CIDAG). Il peut également se faire
dans un laboratoire d’analyses médicales : sur
prescription d’un médecin, le test en laboratoire
est pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
Les traitements
Les trithérapies : les personnes séropositives
au VIH sont soignées avec des médicaments
ayant pour objectif de ralentir la progression de
l’infection dans l’organisme et de renforcer les
défenses de l’organisme contre d’autres maladies
et infections.
Le traitement post-exposition (TPE) : en cas
de prise de risque, tu peux te rendre dans les
48h à l’hôpital pour bénécier d’un TPE après
diagnostic d’un médecin (il n’est pas donné
systématiquement). Le TPE réduit le risque de
contamination mais n’est pas ecace à 100%.
Un vaccin ?
Le VIH est un virus en constante mutation, avec des
variantes génétiques rapides, ce qui rend dicile son
étude. Il n’existe encore aucun vaccin à ce jour.
CIDAG de Haute-Savoie
Annemasse : 04.50.87.40.27
Annecy : 04.50.63.63.71
Sallanches : 04.50.47.30.49
Thonon-les-Bains : 04.50.83.21.19
Association OPPELIA
8 bis avenue de Cran - 74000 ANNECY
Tél. 04 50 67 97 84 - Fax : 04 50 67 97 83
E-mail : [email protected]
le thianty

La petite histoire
La première épidémie de Sida est observée
le 5 juin 1981 aux Etats-Unis (Los Angeles,
New-York et San Francisco) en lien avec une
hausse des deux maladies suivantes : la
pneumonie et le sarcome de Kaposi (cancer
de la peau). Ces patients présentent un taux de
lymphocytes T4 (cellules jouant un rôle dans le
système immunitaire) particulièrement bas. Les
premiers malades ont tous la particularité d’être
homosexuels : on parle alors de « cancer gay ».
Le poppers (produit utilisé chez les homosexuels
pour faciliter les relations anales) est considéré
alors comme la cause de cette épidémie.
Dans les mois qui suivent, cette théorie est
abandonnée avec la découverte d’autres
populations infectées : des toxicomanes par
injection, des hémophiles et des Haïtiens. Les
scientiques s’accordent à dire qu’il s’agit alors
d’une infection. Après de multiples recherches,
trois dénominations de virus vont faire leur
apparition : le 20 mai 1983, l’équipe de Luc
Montagnier identie le LAV (Lymphadenopathy
Associated Virus) ; le 4 mai 1984, l’équipe de
Robert Gallo publie un article sur le HTLV-3 ; le 24
août 1984, l’équipe du Pr Jay. A. Levy découvre
l’ARV (AIDS-related virus). Ce n’est qu’en 1986
que les trois dénominations sont recoupées pour
qualier un même virus : le VIH.
Le 26 octobre 1987, les Nations Unies votent
une résolution invitant tous les États à coopérer
pour lutter contre cette pandémie (épidémie
mondiale). La lutte contre le VIH/Sida devient une
priorité à travers le programme ONUsida et les
programmes de santé publique développés par
les gouvernements. La communauté scientique
s’active en vue de mettre au point un vaccin,
faisant du VIH le virus le plus étudié à ce jour.
Réduire les risques
Les préservatifs réduisent de 85% les risques
d’infections. Vérie leur date de péremption et
range-les dans un endroit frais et sec à l’abri de
la lumière directe du soleil. Le port du préservatif
est également conseillé dans les rapports sexuels
entre deux personnes séropositives (surinfection
possible).
Préfère le gel à base d’eau car les corps gras (va-
seline, pommade, crème, beurre) fragilisent les
préservatifs en latex.
Certaines drogues (cannabis, ecstasy notam-
ment) ont une action nocive sur le système immu-
nitaire selon la nature de la substance, sa concen-
tration et sa fréquence de consommation.
Ne partage pas ton matériel pour snier
(paille), t’injecter (seringue, eau, cuillère, co-
ton, ltre, tampon, eau) ou fumer (pipe à crack,
bang…) : l’usage personnel et unique est vive-
ment conseillé. En cas de partage, désinfecte les
objets à l’eau de javel.
Chez la femme enceinte séropositive au VIH/
Sida, la prescription de médicaments, la césa-
rienne et l’allaitement articiel réduisent les
risques de contamination chez le nouveau-né :
demande conseil à ton médecin.
Sentiment d’avoir pris un risque ? Pense au
dépistage : plus il se fait tôt, plus les traitements
sont ecaces en cas d’infection.
Les modes de transmission
Il ne peut y avoir transmission du VIH sans qu’une
personne soit séropositive. Il faut qu’au moins deux
liquides biologiques soient en contact direct :
Le liquide séminal et sperme (homme), la cyprine
(femme)
• Rapportssexuelsnon protégés (vaginal, anal,
buccal),
• Utilisationd’unmême préservatif ou sextoys
avec des partenaires diérents.
• Relations sexuelles pendant les règles,
présence d’autres infections (herpès génitale…)
Le sang
• Partage de matériels chez les usagers de
drogues (pailles, matériel d’injection, pipes à
crack…),
• Partage ou piqûres accidentelles avec un
objet contaminé (rasoir, coupe-ongles, brosse à
dents…),
• Manque d’hygiène chez certains praticiens
(tatouages, piercings…).
• Grossesse (dernières mois) et accouchement
chez la femme enceinte.
Le lait maternel
1
/
2
100%