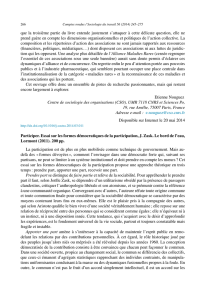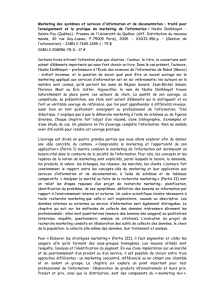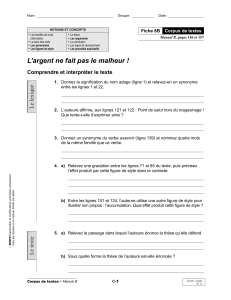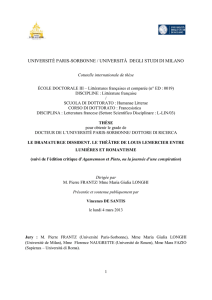À l`école du salariat. Les étudiants et leurs « petits boulots », V. Pinto

Comptes
rendus
/
Sociologie
du
travail
57
(2015)
126–149
147
À
l’école
du
salariat.
Les
étudiants
et
leurs
«
petits
boulots
»,
V.
Pinto.
PUF,
Paris
(2014).
350
p.
Les
«
petits
boulots
»
étudiants
ont-ils
tous
une
valeur
formatrice
?
Les
«
étudiants
salariés
»,
devenus
pour
la
puissance
publique
sujets
d’attention
et
d’action,
peuvent-ils
être
traités
comme
une
catégorie
homogène
?
Ces
questions
qui
ouvrent
livre
de
Vanessa
Pinto
sont
incontestable-
ment
d’une
grande
actualité
pour
l’ensemble
de
la
société
franc¸aise.
L’auteure
nous
propose
une
sociologie
de
l’emploi
étudiant
qui
articule
le
rapport
individuel
aux
études,
au
travail
et
à
l’avenir
avec
les
trajectoires
scolaires
et
sociales
de
ses
enquêtés.
La
première
partie
de
l’ouvrage
dresse
le
portrait-robot
de
l’emploi
étudiant
en
France
:
quelles
ont
été
ses
définitions
sociales
à
travers
les
âges
?
Quelle
est
la
morphologie
de
la
main
d’œuvre
étudiante
?
Mais
c’est
dans
les
deuxième
et
troisième
parties
qu’on
trouvera
le
cœur
du
matériau
empirique
et
de
l’argumentation.
À
travers
une
enquête
ethnographique
qui
couple
observation
participante
et
entretiens
semi-directifs
sur
trois
terrains
contrastés
(un
restaurant
McDonald’s,
un
centre
de
loisirs
et
un
centre
d’appel
prestataire
d’un
opérateur
téléphonique),
l’auteure
s’efforce
de
caractériser
les
différents
marchés
du
travail
étudiant,
avant
de
dévoiler
les
usages
sociaux
de
l’emploi
étudiant.
La
reprise
complète
de
données
historiques
et
statistiques
présentée
en
première
partie
est
riche
d’enseignements.
Elle
nous
apprend
d’abord
que
l’emploi
étudiant
a
longtemps
été
considéré
comme
nuisible
à
la
réussite
dans
les
études
supérieures.
Avec
la
dégradation
de
la
conjoncture
économique
des
années
1970,
l’idée
d’une
nécessaire
professionnalisation
des
études
va
peu
à
peu
se
banaliser
avant
de
devenir
une
priorité
politique
pour
les
réformateurs
de
l’enseignement
supérieur
dans
les
années
2000.
C’est,
selon
V.
Pinto,
dans
ce
mouvement
d’«
injonction
à
la
professionnalisation
»
que
doivent
se
comprendre
les
dispositifs
de
reconnaissance
des
jobs
et
stages
étudiants
dans
les
cursus
du
supérieur
préconisés
par
les
réformes
récentes.
Par
ailleurs,
les
chiffres
révèlent
que
le
profil
social
des
étudiants
salariés
a
peu
évolué
depuis
le
temps
des
Héritiers
de
Bourdieu
et
Passeron,
les
enfants
d’ouvriers
y
ayant
davantage
recours
que
les
enfants
de
cadres
;
aujourd’hui,
les
premiers
occupent
majoritairement
des
activités
non
liées
aux
études,
les
seconds
accédant
à
des
emplois
davantage
en
lien
avec
leurs
forma-
tions,
plus
qualifiés
mais
aussi
plus
occasionnels.
À
cette
différenciation
sociale
vient
s’ajouter
une
segmentation
par
filières:
tandis
que
le
plus
fort
taux
d’inactivité
concerne
les
étudiants
des
classes
préparatoires
aux
grandes
écoles
et
du
secteur
santé,
c’est
en
lettres
et
sciences
humaines
que
la
proportion
d’étudiants
occupant
un
travail
non
lié
à
leurs
études
est
la
plus
importante.
Toutefois,
la
caractérisation
statistique
conduit
à
une
relative
indifférenciation
des
emplois
étudiants
et
à
suspendre
leur
classement
social.
Pour
y
remédier,
l’auteure
établit
à
partir
de
ses
terrains
une
typologie
des
marchés
du
travail
étudiant.
Elle
oppose
ainsi
un
«
pôle
commer-
cial
»
—
inscrit
dans
le
monde
marchand,
adossé
au
capital
économique
auquel
s’attachent
les
activités
récentes
de
la
téléphonie
et
de
la
restauration
rapide
—
à
un
«
pôle
culturel
»
qui
présente
des
caractéristiques
symétriquement
opposées
:
secteur
non
lucratif
souvent
public,
adossé
à
des
valeurs
culturelles
et
dans
lequel
s’inscrivent
des
activités
héritées
d’une
histoire
plus
ancienne
telles
que
l’animation.
Cette
bipartition
pose
question,
nous
y
reviendrons
plus
loin.
L’apport
essentiel
de
l’ouvrage
réside
certainement
dans
les
récits
de
vie
qui
permettent
à
V.
Pinto
de
décrire
minutieusement
les
emplois
en
les
inscrivant
dans
leur
dimension
tem-
porelle.
Elle
met
ainsi
en
évidence
trois
rapports
au
travail
—
la
dissociation,
l’ajustement
et
la
substitution
—
correspondant
à
trois
rapports
au
temps
—
le
provisoire,
l’anticipation
et

148
Comptes
rendus
/
Sociologie
du
travail
57
(2015)
126–149
l’éternisation.
On
découvre
ici
combien
l’engagement
dans
les
études
suivies
est
déterminant
pour
saisir
le
sens
que
revêt
l’emploi
pour
les
individus.
Pour
Clément,
élève
d’une
école
de
commerce,
le
job
d’été
de
gardien
d’immeuble
est
strictement
alimentaire
et
provisoire.
La
valeur
faible
qu’il
accorde
à
ce
travail
salarié
est
intimement
liée
au
capital
économique
de
sa
famille.
A
contrario,
pour
Khadija,
d’origine
sénégalaise
vivant
dans
une
cité
populaire
de
région
parisienne,
c’est
l’éternisation
dans
l’emploi
précaire
qui
guette.
Étudiante
en
adminis-
tration
économique
et
sociale
et
employée
performante
dans
un
centre
d’appel,
elle
a
l’ambition
de
mener
ses
études
jusqu’au
bac+5,
mais
se
retrouve
peu
à
peu
prisonnière
du
prestige
et
de
la
socialisation
qu’elle
trouve
au
travail
et
qui
lui
font
défaut
à
l’université.
Le
cas
de
Khadija
invite
ainsi
à
reconsidérer
la
causalité
du
lien
entre
travail
étudiant
et
décrochage
universi-
taire
:
là
où
la
plupart
des
analyses
incriminent
la
durée
excessive
du
travail
comme
cause
d’abandon,
c’est
finalement
peut-être
l’échec
scolaire
et
l’inscription
par
défaut
dans
les
filières
les
moins
considérées
de
l’enseignement
supérieur
qui
conduit
à
leur
substituer
une
situation
salariée.
On
ne
peut
qu’être
convaincu
par
la
thèse
principale
de
l’auteure
qui
met
à
profit
la
sociologie
bourdieusienne
pour
montrer
qu’un
même
job
étudiant
n’autorise
pas
les
mêmes
perspectives
d’avenir,
celles-ci
étant
largement
déterminées
par
les
ressources
scolaires
et
sociales
:
quand
les
uns
débouchent
sur
une
pré-socialisation,
les
autres
sont
une
première
étape
vers
la
précarité.
D’un
point
de
vue
plus
macroscopique,
les
analyses
de
V.
Pinto
soulignent
combien
la
valo-
risation
sociale
de
l’emploi
étudiant
est
en
passe
de
reconfigurer
la
sphère
du
travail
comme
celle
de
l’enseignement
supérieur.
Les
employeurs,
aussi
bien
dans
les
pôles
«
commercial
»
que
«
culturel
»,
trouvent
auprès
des
étudiants
une
main
d’œuvre
non
seulement
peu
coûteuse
mais
surtout
qualifiée,
qui
tend
à
déstabiliser
les
salariés
plus
«
stables
»,
tant
par
les
ressources
qu’ils
sont
aptes
à
mobiliser
dans
le
travail
quotidien
que
par
leur
volatilité
qui
limite
de
facto
l’action
collective.
La
valorisation
du
travail
étudiant
est
aussi
un
défi
lancé
aux
universitaires,
qui
doivent
remplir
de
nouvelles
missions
éloignées
de
leur
ethos
académique,
et
sont
en
outre
appelés
implicitement
à
se
porter
garants
du
meilleur
ajustement
possible
entre
travail
et
études.
Pourtant,
la
critique
radicale
que
V.
Pinto
adresse
à
l’injonction
de
la
professionnalisation
peut
sembler
excessive
à
plusieurs
égards.
Son
parti
pris
est
sans
nuance
:
la
professionnalisation
serait
selon
ses
mots
«
illusoire,
contre-productive,
inégalitaire
»,
et
elle
va
jusqu’à
invoquer
une
«
moralisation
des
catégories
populaires
»
(p.
45).
En
outre,
son
analyse
prend
parfois
de
la
distance
avec
les
témoignages
de
ses
enquêtés
:
alors
que
ceux-ci
soulignent
à
maintes
reprises
les
aspects
ludiques
de
leur
travail,
leurs
marges
d’autonomie,
mais
aussi
la
découverte
désillusionnée
de
métiers
concrets
qui
les
conduisent
à
ajuster
leurs
aspirations
professionnelles,
l’auteure
ne
retient
de
la
professionnalisation
qu’un
vecteur
d’«
inculcation
des
normes
et
des
valeurs
économiques
dominantes
»
(p.
299).
Par
ailleurs,
la
partition
des
mondes
salariaux
des
étudiants
en
deux
pôles
(commercial
et
culturel)
n’est
pas
entièrement
convaincante.
L’auteure
ne
parvient
pas
à
se
départir
d’une
vision
normative
liée
à
ses
propres
«
dispositions
»
:
là
où
le
pôle
culturel
est
décrit
par
la
vocation,
les
valeurs,
l’humanité,
le
pôle
commercial
serait
animé
par
les
normes
de
l’argent,
de
l’arnaque,
et
marqué
par
la
domination
des
employeurs.
À
nouveau,
V.
Pinto
ne
rend
pas
tout
à
fait
justice
à
son
matériau
empirique
qui
dépeint
une
réalité
plus
complexe.
Enfin
et
surtout,
on
s’interroge
sur
le
positionnement
de
la
restauration
rapide
dans
le
pôle
commercial
qu’on
serait
plutôt
tenté
de
rap-
procher
d’un
pôle
industriel
—
l’auteure
elle-même
faisant
des
analogies
avec
le
travail
ouvrier
—,
caractérisé
par
un
travail
non
qualifié
en
juste-à-temps,
des
tâches
taylorisées
et
dépréciées.
Mais
ces
glissements
normatifs
n’entachent
en
rien
les
grandes
qualités
de
l’étude
de
V.
Pinto,
dont
la
lecture
est
éminemment
profitable.

Comptes
rendus
/
Sociologie
du
travail
57
(2015)
126–149
149
Stéphanie
Mignot-Gérard
Institut
de
Recherche
en
Gestion
(IRG),
Université
Paris-Est
Créteil
Val
de
Marne,
Faculté
de
sciences
économiques
et
de
gestion,
Place
de
la
Porte
des
Champs,
4,
Route
de
Choisy,
94000
Créteil,
France
Disponible
sur
Internet
le
19
janvier
2015
Adresse
e-mail
:
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2014.12.012
1
/
3
100%