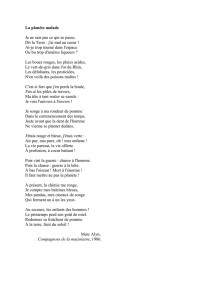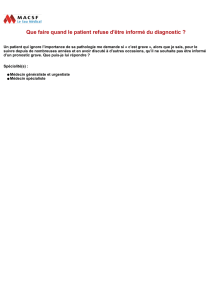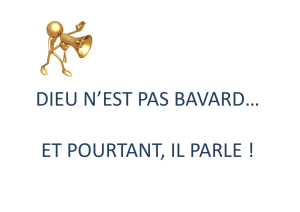Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS IV - PARIS SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE I : MONDES ANCIENS ET MÉDIÉVAUX
UNITÉ DE RECHERCHE : ROME ET SES RENAISSANCES (ED 4081)
Doctorat de 3
ème
cycle
Études latines
Nicolas LÉVI
ARCANA IN IPSO CONSUMMATI OPERIS FASTIGIO :
LA RÉVÉLATION FINALE DANS LA LITTÉRATURE
LATINE (CICÉRON, OVIDE ET APULÉE)
Thèse dirigée par M. Carlos LÉVY
Soutenue le 10 décembre 2011
Membres du Jury :
Mme Mireille ARMISEN-MARCHETTI, Professeur à l’Université de Toulouse
II
Mme Béatrice BAKHOUCHE, Professeur à l’Université de Montpellier III
M. Alain BILLAULT, Professeur à l’Université de Paris IV
Mme. Sylvie FRANCHET D’ESPÈREY, Professeur à l’Université de Paris IV
M. Carlos LÉVY, Professeur à l’Université de Paris IV
M. John SCHEID, Professeur au Collège de France
M. Aldo SETAIOLI, Professeur à l’Université de Pérouse

POSITION DE THÈSE
Au sixième et dernier livre du De republica, dans le fameux « Songe de Scipion » qui a nous
a été conservé grâce à Macrobe auquel nous empruntons justement la formule arcana in ipso
consummati operis fastigio (« des secrets [placés] au point culminant de l’œuvre achevée »)
1
,
Cicéron met en scène Scipion Émilien racontant, à ses amis et interlocuteurs du dialogue
philosophique qui a précédé, un songe au cours duquel il aurait vu ses glorieux ancêtres
Scipion l’Africain et Paul-Émile lui apparaître pour lui révéler son avenir et lui faire
contempler les secrets de l’univers, en particulier l’immortalité céleste de l’âme promise aux
grands hommes. Au quinzième et dernier livre des Métamorphoses d’Ovide, au moment où le
poème, achevant son cycle, a quitté les temps du mythe pour rejoindre ceux de l’histoire
romaine, la parole du poète est longuement déléguée au célèbre philosophe et thaumaturge
grec Pythagore, qui, dans un discours inspiré par Apollon, révèle les secrets de la nature,
notamment la métempsycose qui fonde l’impératif végétarien. Enfin, au onzième et dernier
livre des Métamorphoses d’Apulée, le héros Lucius, après maints revers de fortune et
tribulations essuyés à la suite de sa transformation en âne, voit lui apparaître en songe la
déesse Isis, qui se révèle à lui comme la divinité suprême et providentielle, et lui offre un salut
à condition qu’il s’engage désormais à son service et se fasse initier à ses mystères. Ainsi,
trois œuvres majeures de la littérature latine, malgré leurs différences génériques - un
dialogue philosophique, un poème narratif, un roman enfin - présentent le point commun
remarquable de mettre en scène, en leur livre final, une révélation, c'est-à-dire un phénomène
par lequel des vérités cachées sont mises au jour d'une manière surnaturelle.
Cette thèse vise à expliquer comment et pourquoi s’opère dans chacun des cas ce détour - ou
ce secours - ultime par la révélation en déterminant les modes de représentation et la
signification de ce motif qui unit un certain type d’inuentio - des conceptions religieuses et
philosophiques moulées dans un dispositif fictionnel de révélation - et un certain type de
dispositio - une configuration particulière de la fin. Pour mener à bien cette étude, nous
établissons dans un chapitre préliminaire un cadre herméneutique permettant d’appréhender la
notion générale de révélation, puis, plus spécifiquement, celle du motif de la révélation
finale : nous essayons en effet dans un premier temps de définir la structure de l’expérience de
1
Macr., In Somn., I, 1, 8 : Postquam in omni rei publicae otio ac negotio palmam iustitiae disputando dedit,
sacras immortalium animarum sedes et caelestium arcana regionum in ipso consummati operis fastigio locauit.

la révélation au moyen d’une typologie d’« apocalyptèmes », de déterminations formelles de
cadre, de contenu, et d’effet qui peuvent être actualisées et combinées de manière variable et,
dans un second temps, nous mettons en place quatre grandes catégories (confirmation -
infirmation - résolution - transfiguration) de nature à décrire le dialogue, au sein d’une œuvre
littéraire, qu’une révélation placée à la fin de celle-ci peut entretenir avec la structure qui
précède, indépendamment des contraintes génériques propres à cette œuvre. Nous appliquons
dans les deux cas les concepts mis en place à un certain nombre d’exemples puisés
principalement dans la littérature grecque classique, ce qui nous permet à la fois d’anticiper le
moins possible sur le corps même de la recherche et d’envisager les antécédents voire les
modèles grecs de nos trois textes latins. Cela nous conduit en particulier à consacrer des
développements aux deux types d’exemples qui ressortissent à notre sens au genre de la
révélation finale en Grèce, d’une part, les fins de tragédies avec deus ex machina, qui se
rencontrent chez Euripide et chez Sophocle dans une moindre mesure ; d'autre part, les fins de
dialogues philosophiques avec mythe eschatologique chez Platon, dans le Gorgias, dans le
Phédon, et au livre X de la République avec le mythe d'Er - ce dernier texte étant d'autant plus
important pour notre propos qu'il constitue l'un des modèles philosophiques et littéraires
principaux de Cicéron dans le « Songe de Scipion ».
Bien que l’étude du motif de la révélation finale dans nos œuvres latines soit accomplie
ensuite, pour des raisons de cohérence, dans le cadre de trois monographies successives, cette
thèse aborde quatre grands problèmes transversaux : celui des mouvements de pensée dans
lesquels s’inscrivent ces révélations ; celui de leur place dans l’économie des œuvres et des
interrogations de leurs auteurs respectifs ; celui de leur mise en scène littéraire et de leur
actualisation des thèmes philosophiques et religieux qui leur servent de support ; enfin, celui
de leur rapport au reste de l’œuvre qu’elles viennent clore en tant que révélations finales.
Le « Songe de Scipion », le discours de Pythagore et le livre d’Isis s’enracinent dans des
courants de pensée qui se sont diffusés à Rome à un moment donné de l’histoire. Dans le
premier cas, il s’agit du renouveau du pythagorisme et du platonisme pythagorisant à la fin de
l’époque hellénistique, qui, d’Ennius aux Pythagoriciens romains de la fin de la République
(Alexandre Polyhistor, Nigidius Figulus, Varron) en passant par des penseurs aussi divers que
Posidonius, Antiochus, les auteurs des pseudopythagorica ou celui du dialogue pseudo-
platonicien de l’Axiochos, conduit à la réaffirmation fondamentale de la doctrine de
l’immortalité de l’âme malmenée par les philosophies hellénistiques, et parallèlement à la

suggestion de modèles variés d’accès révélé aux secrets de l’univers (les songes d’Ennius, le
mythe eschatologique final de l’Axiochos, les doctrines de la divination par les songes de
Posidonius, d’Alexandre Polyhistor et de Nigidius, le paradigme initiatique chez Varron).
Dans le cas du discours de Pythagore chez Ovide, il s’agit, dans la continuité du mouvement
précédent, de la persistance à l’époque augustéenne d’individus et de cercles dont le nom est
lié au pythagorisme (Anaxilaos de Larissa, Hygin, les Sextii, Sotion, le seul philosophe de
l’époque à Rome dont nous puissions être certains qu’il ait reprit à son compte la doctrine de
la métempsycose, les « fidèles » de la Basilique de la Porte Majeure, monument capital dans
la perspective de l’allégorèse pythagoricienne de la mythologie), ainsi que de l’omniprésence
de l’imaginaire pythagoricien chez les poètes de l’époque, de Virgile et Horace à Tibulle et
Properce, qui prolonge la tradition des liens entre poésie latine et révélation pythagoricienne
instaurés par Ennius. Enfin, dans le cas du roman d’Apulée, il s’agit du triomphe dans
l’Empire romain de la religion d’Isis, déesse unique, toute-puissante, secourable et aux
mystères parégoriques, qui se traduit aussi, sur le plan littéraire et philosophique, par la
récurrence du thème du salut isiaque dans la poésie et la fiction impériales, ainsi que par le
développement d’exégèses du mythe et du culte isiaques, dont la plus célèbre reste celle du
De Iside de Plutarque, ouvrage fondamental pour l’arrimage de la religion d’Isis aux cadres
du platonisme.
Pour ce qui est de la place de nos trois révélations dans l’économie des œuvres de leurs
auteurs respectifs, nous montrons que, loin de constituer des corps étrangers à leurs
interrogations générales, elles sont en prise directe avec celles-ci : l’œuvre de Cicéron est
traversée par le problème de l’immortalité de l’âme, en particulier de celle du grand homme,
tandis que le thème de la valeur divinatoire des songes réapparaît dans le De diuinatione ;
l’œuvre d’Ovide pose elle aussi de manière récurrente le problème de la survie, sous le double
regard de l’immortalité de l’âme et de l’immortalité poétique, et semble à maintes reprises
familière de certains thèmes pythagoriciens, en même temps qu’elle ne cesse de déployer une
pensée de la révélation à travers la figure du uates, du poète-prophète ; quant à l’œuvre
d’Apulée, elle peut s’unifier autour de quelques thèmes fondamentaux, comme ceux du Dieu
suprême et de la communication avec la divinité, de la hiérarchie des biens, ou encore des
liens entre le platonisme et la sagesse de l’Égypte. La relation entre nos trois révélations et le
reste de l’œuvre de Cicéron, d’Ovide et d’Apulée est cependant loin d’être parfaitement lisse :
chez Cicéron, l’immortalité de l’âme, présentée dans le « Songe de Scipion » comme une
vérité révélée, l’est souvent ailleurs comme l’une des deux hypothèses de l’alternative

socratique, tandis que le livre II du De diuinatione s’emploie à récuser la valeur divinatoire
des songes ; chez Ovide, l’immortalité de l’âme hautement proclamée par Pythagore semble
dans ses autres œuvres avoir beaucoup moins de réalité et d’efficace consolatrice que
l’immortalité toute symbolique offerte au poète ; chez Apulée enfin, il demeure un hiatus
entre le Dieu suprême des opuscules philosophiques et de l’Apologie, dieu médioplatonicien
absent au monde dans son ineffable grandeur, et l’Isis et l’Osiris du livre XI des
Métamorphoses, présentés comme des dieux à la fois suprêmes et acceptant de se mêler aux
affaires humaines. Cependant, dans chacun des cas, un examen plus poussé nous permet de
relativiser la portée de ces contradictions, et d’invalider les lectures qui présentent ces
révélations comme de simples rêveries philosophiques (Cicéron) ou de simples jeux littéraires
plus ou moins enclins à la parodie (Ovide et Apulée) : chez Cicéron, l’influence du
scepticisme de la Nouvelle Académie n’est jamais telle qu’elle parvienne à détruire les
privilèges de l’auctoritas sur la ratio, à saper la croyance en la parole des sages du passé ou
aux mystères d’Éleusis qui proclament l’immortalité de l’âme, de même que la critique
rationaliste du livre II du De diuinatione ne rejaillit que partiellement sur le Somnium
Scipionis et ne peut de toute façon pas être tenue pour représentative à elle seule de la pensée
cicéronienne sur la question du songe ; chez Ovide, l’immortalité de l’âme, pour incertaine
qu’elle soit, reste une forme possible du uiuam, de même que l’inspiration de Pythagore
procède de la même source que celle du uates dans lequel le poète de Sulmone n’a jamais
cessé de se présenter ; quant à Apulée, nous tentons de dépasser les contradictions entre le
livre XI des Métamorphoses et le reste de ses œuvres moyennant l’hypothèse hermétique qui
permet d’unifier le Dieu transcendant des opuscules philosophiques, le dieu roi de l’Apologie,
le culte d’Esculape, et les figures d’Isis et d’Osiris.
En ce qui concerne l’écriture de la révélation et ses enjeux philosophiques et religieux dans
l’espace du livre final de chacune de nos trois œuvres, nous examinons tout d’abord quelles
expériences sont mises en scène pour transmettre l’apocalypse : chez Cicéron, le songe, lieu
d’une rencontre avec des défunts divinisés, et théâtre d’une révélation à la fois visuelle,
produit de l’anabase de l’âme du rêveur, et auditive, émanant du discours de type
mystagogique de ses ancêtres ; chez Ovide, la parole de ce philosophe inspiré qu’est
Pythagore, individu à qui sa nature exceptionnelle vaut d’être le bénéficiaire des révélations
des dieux, transmises ensuite à ses disciples ; chez Apulée, en un triple processus
apocalyptique, le songe, cadre d’une épiphanie divine, suivi d’un discours sacerdotal
prononcé sous l’effet d’une inspiration divine et d’initiations successives aux mystères. Nous
 6
6
 7
7
1
/
7
100%
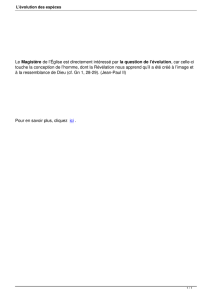
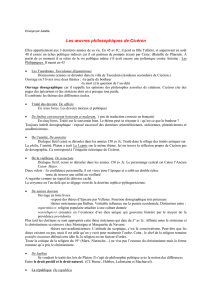
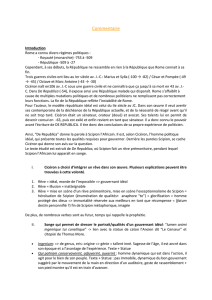
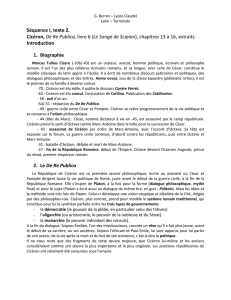
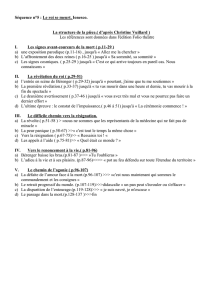
![Inscription de la séquence dans les programmes[1] de l](http://s1.studylibfr.com/store/data/007119161_1-080fc5b72510279fdade3b1afa55e3c0-300x300.png)