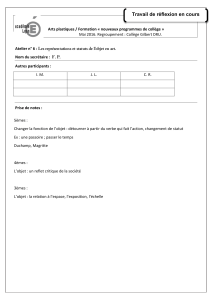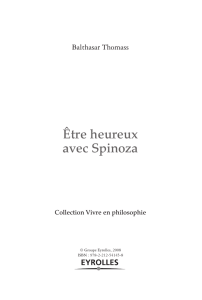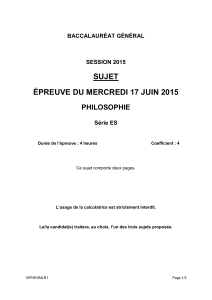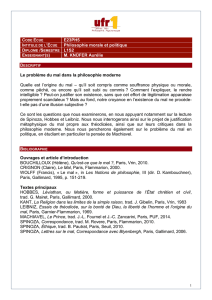studia universitatis babeş

PHI LOSOPHI A
1/2016

STUDIA
UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI
PHILOSOPHIA
1/2016
April

https://studiaphilosophia.wordpress.com/
http://studia.ubbcluj.ro/serii/philosophia/index_en.html
Contact: [email protected]
EDITORIAL BOARD STUDIA UBB PHILOSOPHIA
CHIEF EDITOR: Ion COPOERU (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
EDITORIAL BOARD:
Jeffrey Andrew BARASH (Université Amiens)
Monique CASTILLO (Université Paris XII Val-de-Marne)
Chan Fai CHEUNG (Chinese University of Hong Kong)
Virgil CIOMOŞ (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Aurel CODOBAN (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Peter EGYED (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Eliane ESCUBAS (Université Paris XII Val-de-Marne)
Mircea FLONTA (University of Bucharest)
Gyorgy GEREBY (CEU Budapest)
Jad HATEM (USJ Beyrouth)
Lester EMBREE (Florida Atlantic University)
Marta PETREU-VARTIC (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Eveline PINTO (Université Paris I)
Anca VASILIU (CNRS Paris)
Károly VERESS (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Alexander BAUMGARTEN (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Dan-Eugen RAŢIU (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Lasse SCHERFFIG (Academy of Media Arts, Cologne)
EDITORIAL COMMITTEE:
Tomas KACERAUSKAS (Technical University Vilnius)
Dietmar KOCH (Eberhard-Karls Universität Tübingen)
Alina NOVEANU (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca / Eberhard-Karls Universität
Tübingen)
Attila SZIGETI (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)
Tincuta HEINZEL (Academy of Media Arts, Cologne)
Emilian CIOC (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)

YEAR Volume 61 (LXI) 2016
MONTH APRIL
ISSUE 1
S T U D I A
UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI
PHILOSOPHIA
1
STUDIA UBB EDITORIAL OFFICE: B.P. Hasdeu no. 51, 400371 Cluj-Napoca, Romania,
Phone + 40 264 405352
CONTENT – SOMMAIRE – INHALT – CUPRINS
ON READYMADES, MUSIC AND FILM
Articles presented in the Conference Aesthetics and Theory of Arts (coordinator: Dan-Eugen Rațiu)
DALIA JUDOVITZ, Duchamp’s Ready-mades. Beyond the Dialectics of Art and
Anti-art ..................................................................................................................... 5
VALENTINA SANDU DEDIU, Rhetorical Mentalities in Classical Music. In the
Margins of Books by Leonard Ratner and Mark Evan Bonds ............................. 21
ALEXANDRA NOEMINA CÂMPEAN, Ingmar Bergman et L’heure du loup – le
passage du « lumen opacatum » au cri expressionniste / Ingmar Bergman and
the Hour of the Wolf – Shifting from “lumen opacatum” to the Expressionist
Scream .................................................................................................................... 35
JEAN-JACQUES SARFATI, La justice comme limitéité / Justice and Its Limitedness ... 51
PAUL MERCIER, La lettre spinozienne de l’éternité / The Spinozian Letter about
Eternity ................................................................................................................... 71
BAUVARIE MOUNGA, La déconstruction de l’eurocentrisme philosophique par
les philosophes africains / Deconstruction of the Philosophical Eurocentrism by
African Philosophers .............................................................................................. 95

MARCEL BODEA, Theological and Scientific Metaphors. A Philosophical Critique:
the Difficulties of a Dialogue Based on Metaphors .......................................... 111
BOOK REVIEW
Conflicting Values of Inquiry. Ideologies of Epistemology in Early Modern
Europe (ed. Tamás Demeter, Kathryn Murphy and Claus Zittel). Brill, 2015.
(ROBERT R.A. ARNĂUTU) ...................................................................................... 129
Issue Coordinator: Dan-Eugen RAȚIU
Publishing Date: April 2016
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
1
/
132
100%