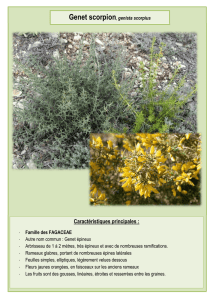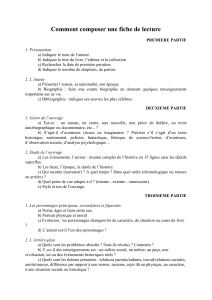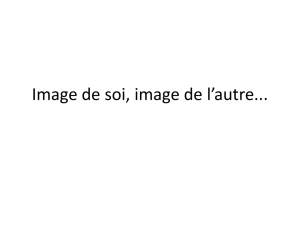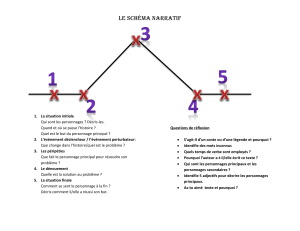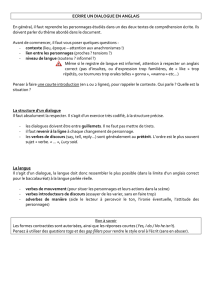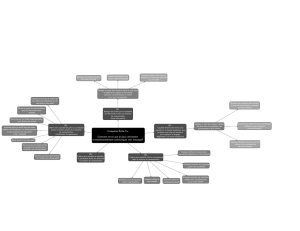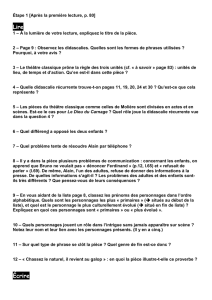Folie et théâtre dans les pièces de théâtre de Jean Genet

1
Folie et théâtre dans les pièces de
théâtre de Jean Genet
Mémoire de maîtrise soutenu en septembre 1996 à l’Université de Paris La Sorbonne
Par Melle Céline Guillemet
directeur : M. Autrand (La Sorbonne)

2
LISTE DES ABREVIATIONS
Bs ................................. Les Bonnes
B .................................. Le Balcon
N .................................. Les Nègres
P .................................. Les Paravents
O.C.IV ............................. Oeuvres Complètes, tome IV
O.C.V .............................. Oeuvres Complètes, tome V

3
Introduction
Compte tenu des significations vastes qu’englobent d’une part la
folie, de l’autre le théâtre, il est nécessaire, avant toute réflexion
sur les textes des pièces de Jean Genet, de préciser le sens de ces
notions, au moins dans l’acceptation que nous allons en faire.
Le plus large concept est certainement la folie, qui finit par perdre
de sa valeur dans son étendue. Mais la toile de fond en est toujours un
rapport inverse à la raison. Est fou ce qui échappe au contrôle de la
raison. Dans cette définition, on peut comprendre l’inverse de la folie,
le rationnel, comme ce qui relève d’une explication, d’un fondement,
d’une justification. Mais aussi, comme la faculté de la pensée, opposée à
l’instinct, l’intuition , le sentiment. En opposition à cette netteté,
cette méthode, droiture et maîtrise des choses par l’esprit, la folie
relève plutôt du flou, de l’extravagance et de l’outrance, de l’illogisme
et de l’incohérence, de la liberté. Elle se place donc sous le signe d’un
débordement incontrôlable. Ce point nous mène dans la voie du délire:
couramment, la manifestation d’un « enthousiasme exubérant, qui passe la
mesure »1, donc incontrôlable, et maître de toutes ses libertés. Le
délire semble être un certain type de folie, composer une sous-catégorie
de la folie, terme plus générique. Il se situe dans la même démesure,
mais nous dirige vers une acceptation plus psychologique de la notion.
Car son premier sens est celui de trouble mental (que l’on retrouve dans
la folie, mais qu’on avait laissé de côté jusqu’ici). Plus précisément,
1 in « délire », in Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paul Robert, Société du nouveau Littré,
1973, p. 433.

4
il exprime une « croyance pathologique à des faits irréels ou conceptions
imaginatives dépourvues de bases »2. Cette définition introduit donc dans
la notion de folie la faculté d’imagination, et le détachement d’avec le
réel. Le fou construit un autre monde en parallèle avec la réalité. Et
par cette conception de l’esprit, il se retrouve lui-même en parallèle
avec les enjeux réels; il est à part, aliéné, au sens propre. Hors du
monde, mais aussi de lui-même, de sa propre réalité, de son identité.
D’aliéné, on passe à la notion de démence: étymologiquement « de-
mentis », hors de son esprit. Cette exclusion est un thème présent dans
presque toute définition d’un type de folie: le délire signifie aussi
étymologiquement « hors du sillon », du droit chemin; et c’est ce
qu’explique Michel Foucault, en s’inspirant de la situation réelle du fou
au Moyen-Age, « au long d’une géographie mi-réelle, mi-imaginaire,
situation liminaire du fou [...,] enfermé aux portes de la ville: son
exclusion doit l’enclore; s’il ne peut et ne doit avoir d’autre prison
que le seuil lui-même, on le retient sur le lieu de passage »3. La folie
est donc un concept insaisissable par définition, puisque incontrôlable,
démesurée, et liminaire, c’est-à-dire, entre deux choses, donc dépendante
des celles-ci: relative. En effet on ne l’a jusqu’ici définie que par
rapport à une autre notion: son opposé ou son proche. Puisqu’elle est
hors de la réalité, elle dépend aussi de ce qu’on entend par réalité.
Inévitablement, elle est liée à une base qui sert de référence à son
appartenance à l’Autre, de norme à son anormalité. Aussi seule sa
relativité peut-elle contenir la notion de folie. Sa relativité: son
double lien à l’imaginaire et au réel.
C’est dans ce même lien que s’inscrit le théâtre. Son principe est
l’illusion: illusion du vrai alors que tout est faux. Il fait croire au
spectateurs qu’un passage d’une vie se déroule spontanément devant leurs
yeux, alors que ce n’est que composition artistique, et jeu. Il rejoint
aussi la folie dans la place à part qu’il a dans l’art. Il appartient en
effet à la fois à l’art littéraire, avec la base de son texte, et à l’art
visuel, puisqu’il est fait pour être joué et vu par un public.
Jean Genet joue avec ces deux notions de folie et théâtre, et de
leurs points de liaison. La folie semble être à l’origine de presque
chacune de ses grandes pièces. Le sujet des Bs est tiré d’un fait divers:
dans les années trente, deux sœurs servant depuis longtemps et sans
problème dans une maison bourgeoise, assassinèrent leur maîtresse, sans
qu’au procès on en comprenne la raison; c’est d’ailleurs sur cet étrange
comportement que s’est penché Jacques Lacan dans sa thèse. N serait
inspiré des cérémonies de la secte musulmane des Houkas qui
« accomplissent une danse annuelle de possession. Groupés autour d’une
case,[...] les Noirs se laissent posséder par leurs « dieux »: le dieu du
gouverneur général, le dieu du conducteur de locomotives...[...] Tout
l’univers des Blancs sauvagement mimé, parodié, au milieu des ordres et
des insultes qui constituent le langage habituel -- entendu depuis le
monde noir -- des maîtres. »4. Enfin B et P rappellent respectivement les
fantasmes cachés des maisons closes, et les débordements d’une guerre
sauvage dont on a toujours pas fini de parler, la guerre d’Algérie. Genet
semble donc intéressé par ces mouvements de folie qui secouent la société
2 in « délire », in Vocabulaire de la psychologie, de Henri Pieron, Presses Universitaires de France, 1963, p. 100.
3 in La Folie à l’âge classique, de Michel Foucault, collection « Tel », Edition Gallimard, 1972, p. 119.
4 in Histoire du nouveau théâtre, de Geneviève Serreau, collection « Idées », Edition Gallimard, 1966, p.126.

5
moderne, et qui forment comme des tâches d’ombre dans le monde dit
« civilisé ». A ces actes fous, il donne une raison d’être par le
théâtre. Non seulement il les mets sur scène, les affiche au monde; mais
il en montre les mécanismes, leur donne une sorte d’explication par
l’emploi du théâtre dans le théâtre. De fait, les moments de folie des
personnages coïncident avec les jeux des personnages (jeux ou cérémonie)
qui interprètent des personnages à l’allure de Figures mythiques, ou de
Types comme on en trouve dans le théâtre classique. Ces deux notions de
folie et théâtre sont donc interactives dans le théâtre de Jean Genet. Il
nous faudra préciser leurs relations, et ce qu’elles peuvent nous révéler
des particularités de ce théâtre, tant dans ses aspects textuels et
scéniques, que dans ses ambitions plus conceptuelles.
L’étude que nous ferons des liens entre ces deux notions dans l’œuvre
dramaturgique de Jean Genet suivra le chemin d’une mise en lumière
progressive, partant des points les plus directement accessibles, pour
évoluer vers l’interprétation des strates plus obscures. Nous chercherons
donc d’abord à souligner la place de la folie dans ce théâtre et à en
préciser la nature, à travers l’étude des personnages des différentes
pièces. Puis nous nous tournerons vers les intrigues, qui révèlent les
personnages dans leur désir de folie et présentent les moyens qu’ils
emploient pour y accéder (moyens qui apparaîtront en rapport direct avec
le théâtre). Nous étudierons alors ces passages de délire extatiques,
instants de révélation tragique pour les personnages, dans leur nature et
leur expression scénique et littéraire. Enfin nous nous pencherons sur
les conséquences d’un tel théâtre dans la salle, et sur ce qu’il cherche
à éveiller dans le public.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
1
/
79
100%