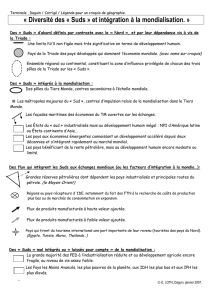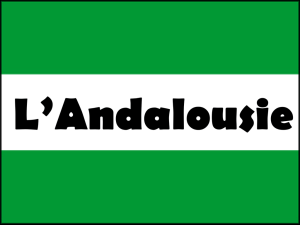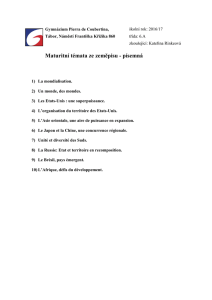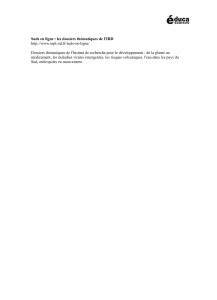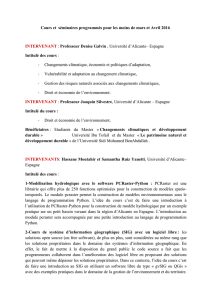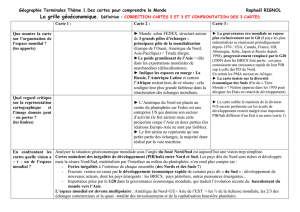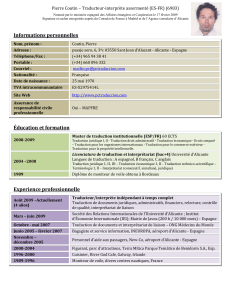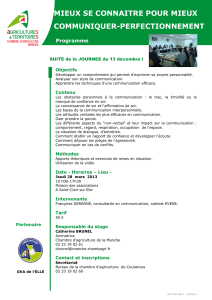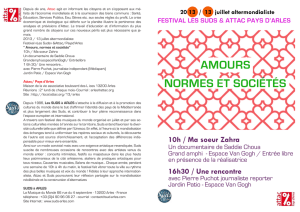ARETHUSE 1989 LA DYNAMIQUE DES SUDS Resumen realizado

ARETHUSE 1989
LA DYNAMIQUE DES SUDS
Resumen realizado por Alain BERGER
Les Vèmes Rencontres ARETHUSE ont été organisées, en septembre 1989, à
Montpellier par le CRPEE laboratoire CNRS de l’Université de Montpellier I, sous la
responsabilité d’Alain Berger.
Conformément aux objectifs fixés à l’origine de ces Rencontres, leur première
finalité est de réunir, de mettre en contact et, au-delà, de favoriser les collaborations et
les échanges entre les équipes universitaires qui s’interrogent sur l’économie et la
société des régions méridionales européennes.
Connaître les recherches, ou même les projets de recherche, permet en effet une
ouverture et éventuellement une meilleure collaboration entre chercheurs et universités
représentées lors de ces Rencontres. Cependant, si la liberté des thèmes présentés a
toujours été maintenue, pour accroître l’efficacité de ces Rencontres il fut convenu de
mettre l’accent sur une thématique particulière.
Depuis quelques années, des chercheurs du CRPEE, en particulier, Alain Berger,
Jacques Rouzier et José Fornairon, travaillaient sur le thème des dynamiques des
régions méridionales de l’Europe du Sud, c’est donc ce thème qu’ils ont proposé
comme thème fédérateur pour les Vèmes Rencontres Arethuse à Montpellier. Le sujet a
paru répondre à une attente parmi les différents membres d’Arethuse, puisque 21
communications sur un total de 25 s’y sont référées.
L’organisation des Rencontres a été assumée par les membres du CRPEE et, en
particulier sur le plan administratif, par Mme Houlez et par Christiane Lagarde. Vingt
ans plus tard, c’est Christiane Lagarde qui gérera avec une grande efficacité,
l’organisation des XXIVèmes Rencontres Arethuse à Montpellier. Sur le plan financier,
c’était encore l’époque faste où les Collectivités locales prenaient largement en charge
l’organisation de ce type de manifestation, la Région Languedoc Roussillon
subventionnant à elle seule l’ensemble des besoins financiers liés au colloque, la Mairie
de Montpellier fournissant les locaux et le Département assurant une reception.
Les séances de travail ont été organisées suivant cinq sessions :
1 – La dynamique des SUDS
2 – L’industrie et de Sud
3 – La place de l’Agriculture dans les économies du Sud de l’Europe
4 – Le rôle du secteur tertiaire
5 – Les thèmes divers.
1 – LA DYNAMIQUE DES SUDS
La première contribution, présentée par Pierre Delfaud, pose la question de
base à propos de la thématique de la Rencontre. Quelles est la situation des régions du
Sud de l’Europe par rapport à leur moyenne nationale ? Existe-t’il, ou non, des
similitudes entre les positions relatives des régions du Sud européen vis à vis de leur
propre espace national ?
Pour répondre à ce questionnement, treize régions méridionales sont retenues
dans les cinq pays du Sud de l’Europe, l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce et le
Portugal, les îles de ces différents pays étant écartées de cet ensemble. Par souci de
simplicité et pour garder une certaine homogénéité statistique, les diverses données
retenues sont toutes issues de l’Annuaire Eurostat de 1988 (données 1985).

Pierre Delfaud traite alors successivement, les variables démographiques, les
caractéristiques de l’emploi et du chômage, le produit national, le niveau de vie des
populations, les structures de l’appareil productif et le montant des aides
communautaires.
De la confrontation de ces différentes statistiques, l’auteur conclut que
l’homogénéité des Suds européens, par rapport à leur position vis à vis de leur espace
national, n’est pas manifeste et qu’une gradation peut être établie entre les différents
Suds en fonction des stades historiques de développement. Le Sud français parait avoir
comblé son retard et apparaît comme une région plus dynamique que la moyenne
nationale. Les régions du Sud de l’Espagne devraient connaître bientôt une évolution
similaire au cas français. Pour l’Italie, malgré une amélioration des comportements
démographiques, le retard paraît encore important par rapport aux données nationales.
Les Suds du Portugal et de la Grèce, à l’exception d’une partie de l’Algarve, restent
encore des régions en déclin.
Dans son travail, intitulé La renaissance des Suds, Jacques Rouzier privilégie, à
propos de l’évolution des différentes régions du Sud européen, les comportements
démographiques. Deux raisons justifient son choix, d’une part la comparabilité quasi
immédiate de ces informations au niveau européen et, d’autre part, la notion de Sud,
dans le questionnement qui est le sien, porte surtout sur des espaces qui ont connu de
longue période de déclin démographique et d’exode et qui, aujourd’hui, connaissent des
renversements de tendance. Dans une approche comparée portant sur cinq pays, RFA,
Grande Bretagne, France, Italie et Espagne, l’auteur montre le rôle essentiel que jouent
les migrations, dans la mesure où elles modifient en profondeurs les caractéristiques des
populations d’accueil, les rajeunissant et diversifiant leurs compétences et leurs
mentalités.
Michel Négre reprend le même questionnement, à savoir la durabilité de la
renaissance des Suds. En spécialiste de la comptabilité régionale, c’est avec cet outil
qu’il s’interroge sur le cas français. Le caractère éphémère que les séries statistiques de
données économiques régionales laissent apparaître, en particulier celle concernant le
PIB régional correspond t’il à la réalité ? Pour Michel Nègre, c’est la qualité contestable
des données économiques régionales qu’il faut plutôt mettre en cause
Au-delà des interrogations relatives à la réalité d’un phénomène Sud, Michel
Laget aborde l’économie des régions méridionales sous l’angle du système économique
régional. A partir de l’exemple français, il défend l’idée que les régions du Sud
n’opèrent pas un rattrapage par rapport aux autres régions mais qu’elles sont entrain de
passer à un autre stade de développement, comme au siècle dernier, les régions
industrielles se sont détachées sur le plan économique des autres régions.
Abordant le cas de l’Espagne, Ana Melero Guillo et Julian de Unamuno
Hierro posent dès le titre de leur communication l’hypothèse, avec un point
d’interrogation, que le développement socioéconomique de l’Espagne reposerait sur une
fuite vers le soleil. Leur réflexion s’appuie sur deux articles récemment publiés, l’un
intitulé La métamorphose de l’Europe (A. Lorca), l’autre Le retour de l’Espagne vers la
Méditerranée.
L’analyse de l’évolution des principaux indicateurs économiques, au
cours de la période 1977 à 1985, à l’échelle des provinces, montre que celles qui sont
situées au bord de la Méditerranée font preuve d’un plus grand dynamisme que les
provinces industrielles du Nord, historiquement les plus riches, mais affectées durement
par la crise économique.
Les phénomènes démographiques montrent, par leur concordance d’un pays à
l’autre, l’émergence du processus Sud dans les principaux pays européen. Dans le cas

de l’Espagne et de la région andalouse plus particulièrement, Alain Berger et Antonio
Narvaez Bueno montrent que ce sont les renversements des courants migratoires
nationaux qui s’avèrent être à l’origine du renouveau démographique. Deux années
témoins sont retenues, 1975 et 1985. En 1975, l’Andalousie est encore une terre
d’émigration. Les soldes migratoires sont négatifs au profit principal de la Catalogne
(22 000 émigrants andalous), de Madrid (6 000), de Valencia (6 200) et du Pays Basque
(1800). En 1885, les flux de population entre l’Andalousie et le reste de l’Espagne se
sont légèrement réduits (140 000 personnes contre 175 000 en 1975), mais les soldes
migratoires sont devenus positifs au bénéfice de l’Andalousie. La Catalogne qui, dix ans
auparavant, gagnait 22 000 personnes au détriment de l’Andalousie en perd à présent 8
200. Il en est de même pour Madrid (moins 3 000) et pour le Pays Basque (moins 1
300). L’Andalousie présente en 1985 un solde migratoire interne positif vis à vis de
toutes les régions espagnoles sauf trois (Murcie, Valence et les Canaries). L’analyse de
l’emploi fait apparaître que cette région, malgré un volume encore important d’emplois
agricoles masquant pour une grande part le sous emploi, c’est l’emploi tertiaire qui
occupe la place principale avec 55% de l’ensemble des emplois et assurant 62% de la
création de richesse.
Les mutations affectant les régions du Sud masquent souvent des disparités de
situations intra régionales, rendant nécessaire des politiques de rééquilibrage. Rafael
Esteve Secall aborde ce problème dans le cas de l’Andalousie. En effet, il attire
l’attention sur l’opposition grandissante entre la densité de population résidant le long
du littoral andalou par rapport à l’intérieur, la province de Grenade faisant exception.
Au cours du siècle, le poids démographique de la bande côtière s’est accru de manière
considérable par rapport à la population totale des différentes provinces andalouses. En
fait, on est en présence du phénomène général de littoralisation. Les indicateurs
économiques montrent qu’il y a deux Andalousie, l’Andalousie en croissance du littoral
et l’Andalousie stagnante de l’intérieur. C’est une politique d’équipement privilégiant
les liaisons Nord Sud de la région qui peut atténuer. ce déséquilibre intra-régional.
La région Castille la Manche fait partie des régions déprimées d’Espagne. Le
groupe d’universitaires1[1] qui présente ce papier aborde une réflexion sur les facteurs
moteurs permettant un développement à moyen et long terme de l’économie de cette
région. Elle n’a pas bénéficié de la croissance nationale des années 60 et 70.
Représentant près de 16% de la superficie du pays, elle ne participe que pour 4% du PIB
national. Avec une population en déclin depuis les années cinquante, un taux élevé de
chômage, les solutions envisagées paraissent relativement classiques, infrastructures
routières à développer, modernisation de l’agriculture. Plus pertinentes les propositions
comme envisager la nécessité d’investir en capital humain, afin d’améliorer
l’adéquation entre l’offre et la demande de travail sur le marché régional, ainsi que
favoriser le développement des PME, suivant le modèle réussi de l’économie italienne.
II – L’INDUSTRIE ET LE SUD
Le service aux industries constitue un marché dont la croissance doit aller de
pair avec le développement économique régional. C’est ce thème que Francesco Testa
de l’Université de Naples aborde dans une communication intitulée Le développement
industriel et la demande de service dans le Mezzogiorno italien. Comme il le fait
remarquer, à partir des résultats d’une enquête, encore faut-il que la nature des services
corresponde aux besoins des industries présentes dans le Mezzogiorno. Or le réseau de
1[1] Alfredo Iglesias, Sebastian Maso Presas, Antonio Olaya Iniesta, Mercedes Sanz Gomez, Javier
Arenillas Vela, Isidoro Picazo Valera, Emilio Fernandez Adan, et Enrique Migoya Garnica.

service paraît inadapté aussi bien dans sa répartition spatiale que dans le rapport
qualité/prix des services proposés.
Toujours sur le thème de l’industrialisation des régions du Sud de l’Europe, José
J. Benitez Rochel pose la question de l’opportunité d’une stratégie industrielle pour
l’Andalousie. Partant du constat de la sous industrialisation de la région andalouse, en
termes de valeur ajoutée comme d’emploi, excepté pour le secteur agroalimentaire,
l’auteur montre que les perspectives de développement industriel reposent surtout sur le
secteur agroalimentaire. Les pouvoirs publics ont alors pour rôle d’assurer le
développement des moyens de transport et de communication et de diffuser un climat
favorable aux investissements dans les domaines des services techniques et sociaux.
Toujours sur le thème de l’industrialisation de l’Andalousie, A.J. Marchante Mera, F.
Gonzales Fajardo et L Gonzales Garcia analysent les créations de nouvelles
entreprises industrielles dans la région andalouse au cours de la période 1973-1986. Ils
constatent que les nouvelles entreprises industrielles qui sont créées au cours de la
période retenue jouent un rôle important dans la diversification de l’économie régionale.
Leurs localisations sont cependant concentrées sur une quinzaine de comarcas, en
particulier celles de Séville et de Malaga. Les emplois créés représentent pour la période
1973-1986 plus de 17 000 unités dont près de 5 000 dans les villes de Séville, Malaga et
Grenade, sans qu’il y ait une apparente spécialisation dans certaines parties de
l’Andalousie.
Les années quatre-vingt vont connaître en matière d’aménagement du territoire
la mode des Parcs Technologiques. Aussi, nous ne sommes pas étonnés de voir traité ce
sujet dans le cadre de bordures méditerranéennes de l’Espagne par R. Domenech, J.
Miguel Giner et J. A. Ybarra. Les auteurs restent cependant dans une approche
presque exclusivement théorique sans aborder de manière concrète les premiers
enseignements que l’on pourrait tirer de l’expérimentation espagnole.
Une dernière communication, très brève, termine cette partie consacrée à
l’industrie dans les régions Sud de l’Europe. Il s’agit de la présentation par Paolo De
Vita de la Banca Dali sull’Industria Manifatturiera del Mezzogiorno. . C’est une
expérience conçue et portée par un groupe d’universitaires méridionaux avec le soutien
financier de l’IASM (Instituto per l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno.
III – LA PLACE DE L’AGRICULTURE
L’agriculture tient encore une place importante dans l’économie, mais aussi dans
la société des Suds européens. Elle connaît des difficultés d’adaptation liées souvent à
des structures et des modes de production traditionnels qui la pénalisent par rapport à
des concurrences aussi bien nationales qu’internationales. Cependant, elle possède des
atouts qui peuvent lui permettre de se maintenir et même de jouer un rôle non
négligeable dans la dynamique des Suds.
Casimir Herruzo s’interroge sur les impacts sur l’agriculture méridionale liés
au recours aux nouvelles technologies, associé à la libéralisation des échanges. Les
importants progrès dans le domaine de la biotechnologie et dans ses applications (avec
l’augmentation des rendements qui en découlent), la révolution dans les technologies de
la communication et la libéralisation des échanges, vont affecter grandement les
économies de l’Europe méridionale, dans la mesure où l’agriculture y tient encore une
place importante. Cependant les caractéristiques propres à ces agricultures du sud ne les
rendent pas des plus aptes à intégrer rapidement ces nouvelles possibilités de
modernisation. Seules certains types d’exploitations et certaines productions paraissent
à ce jour aptes dans le Sud à intégrer la révolution technologique en œuvre.

En effet, au niveau sectoriel des productions jusqu’alors en position dominante
sur les marchés nationaux et européens sont fragilisés par la mondialisation des
échanges. Il en est ainsi de la production des amandes sur le pourtour méditerranéen
espagnol, analysée par Vicente Conejero Martinez. Ce secteur connaît actuellement
une crise avec des difficultés pour écouler la récolte, une baisse des prix consécutive à
la situation du marché et une faible productivité à l’hectare. Pour cette production, la
Communauté valencienne est largement en tête des régions espagnoles, avec la province
d’Alicante, première des provinces du pays. Les prix compensent de plus en plus
difficilement des coûts de production en hausse constante. Près de la moitié de la
production nationale est exportée, mais rencontre des difficultés d’écoulement
grandissantes. L’amande californienne, de moins bonne qualité mais d’un prix inférieur
concurrence de plus en plus son homologue espagnol, même pour la fabrication du
touron…
La situation paraît différente pour la production des agrumes, depuis l’entrée de
l’Espagne dans la Communauté européenne. La communication de Ricardo Franco
Rojas et de Javier Aroca Alonso fait état du secteur des agrumes, de l’organisation de
la production, de la réglementation qualitative et des aides à la transformation des
produits, avant l’entrée de l’Espagne dans la C.E.E, ainsi que des modifications
consécutives à cette intégration. Les points les plus favorables étant la mise en place
d’une politique de retrait et la protection vis-à-vis des pays producteurs extra
communautaires.
Autre secteur, typique de l’agriculture méridionale, celui de la production
d’olive et plus particulièrement de l’olive de table en Italie. L’olive de table est en effet
un produit spécifique, demandant au niveau de la production, comme de la
transformation, des pratiques différentes de l’olive destinée à la production d’huile.
Christiana Cusani présente les différentes étapes de cette production, avec les variétés
adaptées aux différents produits élaborés pour la consommation. Cette multiplicité de
produits conduit à une fragmentation du marché selon la destination. Avec une surface
sensiblement identique, l’Italie produit en 1987 trois fois moins d’olives que l’Espagne,
avec un marché largement dominé par la demande intérieure, qui absorbe les deux tiers
de la production.
Abordant le domaine de l’aquaculture, alors en phase de balbutiement, A. M.
Cano Capurro, E. J. Luque Dominguez etF. M. Garcia Lopera présentent un modèle
de simulation pour l’entreprise aquacole implantée dans les régions méditerranéennes.
Ce modèle repose sur la description du fonctionnement de l’entreprise aquacole
expérimentale et sur les circonstances signalées dans le cadre de cette expérimentation.
Cela a permis d’évaluer les incidences tant biologiques qu’économiques et de les
intégrer progressivement. Il sera possible d’intégrer d’autres paramètres bio-
économiques au fur et à mesure que de nouvelles connaissances empiriques seront
révélées.
IV – LE ROLE DES SERVICES
A l’écart des grandes mutations engendrées par la révolution industrielle du 19°
siècle, les économies des Suds européens sont, à quelques exceptions près, caractérisées
par la présence d’une multitude de petites entreprises, aussi bien dans le domaine de
l’artisanat et de l’industrie que dans celui des services.
José D. Fornairon pense que la petite entreprise est une prédilection pour les
Suds et qu’elle joue un rôle fondamental dans la dynamique qui les anime actuellement.
A partir des différentes sources d’information disponibles actuellement, il analyse les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%