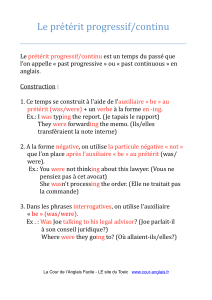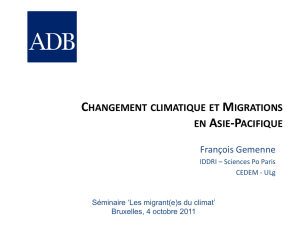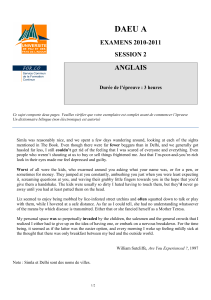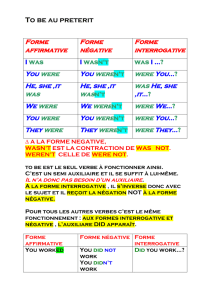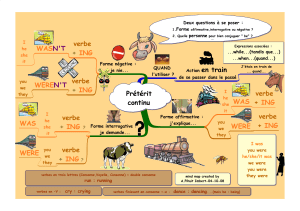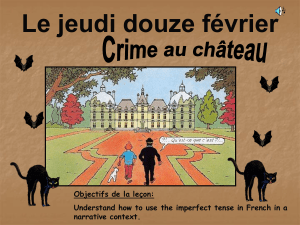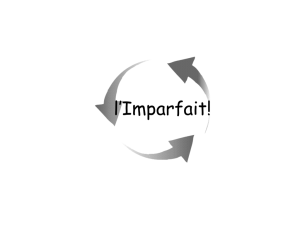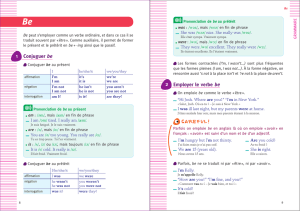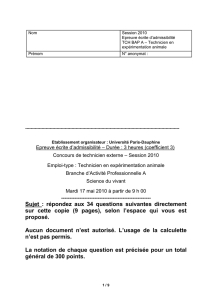VOL 5- N° 3 - Secteur des sciences de la santé

NOSO INFO
Association Belge pour l’Hygiène Hospitalière
Belgische Vereniging voor Ziekenhuishygiëne
Les isolements et leur
histoire
Isolement septique : un terme
désuet pour une notion péri-
mée ?
Infections à Serratia marces-
cens et aérosolthérapie
Recommandations du Conseil
Supérieur d’Hygiène
Sites WEB
Le thermomètre, source d’in-
fection ! Ceci ne devrait plus
arriver !
Abstracts
Agenda scientifique
Instructions aux auteurs
Comité de Rédaction
Abonnements
Groupement pour le Dépistage, l’Etude et la Prévention des
Infections Hospitalières
Groep ter Opsporing, Studie en Preventie van de Infecties in
Ziekenhuizen
La notion d’ « Isolement » suscite en 2001 de nombreuses
controverses. Controverses fondées ou question de sémantique ?
Madame M. Zumofen nous retrace l’histoire de ce concept dont
l’évolution au fil des années a été guidée par la connaissance de
plus en plus précise des microorganismes et de leurs voies de trans-
mission.
Le Professeur P. Demol et son équipe avec un titre un peu…. pro-
vocateur, nous font part de leurs interrogations vis-à-vis de cette
notion aux connotations parfois difficiles à intégrer dans les ser-
vices de soins.
Comme le Professeur Y. Glupczynski nous le rappelait dans la fiche
microbiologique du premier numéro de cette année, Serratia mar-
cescens est un bacille Gram – dont la niche écologique est indiscu-
tablement l’eau. Un de nos collègues a eu l’occasion d’en faire
l’expérience. Il nous rapporte une épidémie de prélèvements posi-
tifs à Serratia dont l’investigation a permis de détecter des erreurs
de procédure dans la préparation des…. Je ne vous en dirai pas
plus, lisez l’article ! Cette expérience est riche d’enseignement
pour nous tous.
C’est arrivé près de chez nous (Pays-Bas), cela se passe sans doute
aussi chez nous ! Des thermomètres incriminés dans la transmis-
sion de germes multi-résistants ! Hygiène des mains, procédures de
désinfection ? Deux pistes possibles.
A vos agendas ! De nombreux congrès, journées, réunions dont les
thèmes variés sont susceptibles d’intéresser un grand nombre
d’entre vous.
A. Simon
SOMMAIRE EDITORIAL
8
2
4
6
13
21
Trimestriel :
VOL. V n° 3
3ème trimestre 2001
Bureau de dépôt :
1200 - BRUXELLES
Editeur Responsable :
Dr. Y. Glupczynski
UCL - 5490 - MBLG
Av. Hippocrate, 54
B - 1200 - BRUXELLES
Avec le soutien du Ministère des
Affaires Sociales, de la Santé
Publique et de l’Environnement,
Cité Administrative,
Bd Pacheco 19/5
1010 BRUXELLES
12
23
24
14

NOSO-info-vol.V, n°3, 2001
2
Les isolements et leur histoire
M. Zumofen
Si l’Histoire (histoire ancienne, histoire de la médecine,
observations des faits, mesures empiriques prises vis-à-
vis des malades contagieux) nous a comblés dans le
domaine des isolements, les études scientifiques et les
recommandations dûment validées dans ce domaine
sont relativement récentes.
Il aura fallu attendre les travaux de Pasteur (1875): "mise
en évidence des microorganismes, agents causals des
maladies infectieuses" et ceux de Williams et coll.
(1960) "importance de la voie de transmission"
Williams R.E.O., Blowers R., Garrod L.P. and Shooter R.A.
Hospital Infection - Causes and prevention
Lloyd - Luke Ltd - London - pp 386 - 1960)
pour trouver en 1970, dans la littérature médicale, les
premières recommandations complètes, structurées et
précises en matière d’isolement des maladies infec-
tieuses. Il s’agit du guide du CDC intitulé:
Isolation techniques for use in hospitals. US Govern-
ment Printing Office. Public Health Service Publication
N˚ 2054 (1970)
Ce document sera révisé en 1975.
Voici les caractéristiques décrites dans ce document :
- l’isolement standard est abandonné au profit de 4 types
d’isolement par catégories de maladies (isolement
absolu, respiratoire, entérique, cutané) ;
- la prise en compte de la voie de transmission par
groupe de maladies;
- la rigueur de ces 4 types d’isolement est atténuée,
quand le niveau de risque le permet, par des schémas
de précautions : entériques, cutanées et sanguines;
- les maladies contagieuses et les infections sont inven-
toriées et présentées sous forme de liste alphabétique.
Le type d’isolement recommandé ou les précautions à
prendre sont indiqués pour chaque infection ;
- l’introduction d’un système de cartes de couleurs
appliquées à l’entrée de la chambre d’isolement à la
fois pour l’identifier et rappeler les règles à suivre à la
personne qui pénètre dans l’isolement.
Ce système présentait l’avantage d’être aisé à apprendre,
mais l’inconvénient de tendre à "sur-isoler", et partant, à
être parfois inutilement coûteux en matériel et en temps.
Treize années plus tard, tirant les leçons de l’application
de ces techniques, reconnaissant que ces "schémas" sté-
réotypés imposaient nécessairement l’adoption de pré-
cautions parfois exagérées et coûteuses, tirant parti de
l’amélioration des connaissances des voies de transmis-
sion des germes et de l’épidémiologie hospitalière, les
CDCs recommandent des isolements spécifiques par
maladie dans le document publié en supplément spécial
de la revue "Infection Control".
Garner J.S. and Simmons B.P.
CDC Guidelines for Isolation Precautions in Hospitals
Infection Control : 4, n˚4 (suppl.) , 291-325; 1983 and
Amer.J. Infect.Control. 12, 103 – 163 ; 1984
Rendons à César..., vingt ans plus tôt, un type d’isole-
ment analogue avait été proposé en Grande Bretagne!
Shooter R.A., O’Grady and Williams R.E.O.
Isolation of patients in hospital – British Medical Journal, 2,
924; 1963
Voici les caractéristiques mentionnées dans ce nouveau
document des CDCs:
- l’isolement est spécifique par maladie et non plus par
catégories de maladies; il est donc beaucoup plus
sélectif;
- chaque maladie infectieuse est considérée individuel-
lement, ainsi, seules les précautions nécessaires pour
interrompre la transmission d’une infection précise
sont recommandées, sans perte de qualité en matière
de prévention.
Cette méthode présente l’avantage de n’appliquer et de
ne consommer que ce qui est nécessaire (économie de
temps et de personnel) tout en allégeant les contraintes
imposées au personnel et au malade.
La difficulté consiste à l’établissement d’un diagnostic
précoce et précis ainsi que l’obligation d’établir des
fiches de travail précises pour le personnel.
C’est à cette même époque que sont préconisés les iso-
lements en cohortes ("Cohort Isolation") en cas d’épidé-
mies causées par un même microorganisme (p.ex. : rota-
virus).
En 1985, l’émergence du virus HIV pousse les CDCs à
mettre en place des "Précautions universelles" (Universal
Precautions), destinées plus particulièrement à protéger
le personnel hospitalier, comblant ainsi une lacune des
recommandations élaborées jusqu’ici.
Sur base de ces recommandations édictées en 1987,
celles-ci s’étendent à tous les liquides biologiques et se
précisent; il s’agit de "Précautions vis-à-vis du sang et
des liquides biologiques" (B.S.I. : body substance isola-
tion). Ces précautions universelles complétées par les
B.S.I. peuvent être résumées comme suit:
- les précautions concernent tout patient à travers toute
l’activité en ce qui concerne les liquides biologiques:
sang, sperme, sécrétions vaginales, LCR, liquide
ARTICLE ORIGINAL

NOSO-info-vol.V, n°3, 2001
3
amniotique, péricardique, pleural…
- elles consistent en lavage des mains (avec ou sans
port de gants), protection de la peau lésée, politique
vis-à-vis des objets coupants et tranchants, vêtements
de protection (gants-tablier-lunettes) si nécessaire, éli-
mination immédiate des souillures, incinération des
déchets biologiques.
Dans un autre domaine, la recrudescence de la tubercu-
lose et l’apparition de résistances du Bacille de Koch
aux antibiotiques conduisent à préciser les recomman-
dations relatives aux isolements des patients souffrant de
tuberculose. Il s’agit de publications de 1990 - 1993
avec les recommandations qui se résument comme
suit :
- chambre avec ventilation en pression négative ;
- renouvellement de l’air : dilution ;
- port de masques spéciaux par le personnel (masque
avec valve expiratoire assurant une filtration de 95 %
pour des particules de 0,3 microns).
Enfin, en 1996, les CDCs proposent une globalisation de
toutes les directives antérieures (1983: "spécifiques par
maladie"; 1985-87 : "Précautions universelles" et "BSI";
1990-93 : tuberculose) pour aboutir à des "Standard Pre-
cautions" complétées par des "Transmission-based Pre-
cautions", modulées selon la voie de transmission dans
trois domaines : contact, air et gouttelettes (droplet).
Guidelines for hospital precautions in hospitals - J.s. Garner
Inf. Control and Hosp. Epidemiol., 17 (n˚ 1) :53-80(1996)
Voir: http://www.cdc.gov/ncidod/hip/ISOLAT/Isolat.htm
Nous n’entrerons pas ici dans les tribulations des CDCs
au cours de ces 15 dernières années... de quoi s’y perdre
en particulier pour la formation du personnel. S’il est
bien clair que les recommandations spécifiques par
maladies comportent une lacune pour la protection du
personnel, il nous faut raison garder pour tenter de don-
ner des indications précises, claires et les plus simples
possible au personnel hospitalier.
Retenant comme base les "Précautions universelles"
pour la protection du personnel auxquelles s’ajoutent
les "isolements spécifiques par maladies" actualisés,
avec des aspects particuliers pour certains germes :
MRSA, VRE, Clostridium difficile, tuberculose.., un
guide de recommandations a été élaboré par l’Associa-
tion Belge pour l’Hygiène Hospitalière. Celui-ci a été
publié dans un des derniers numéros du Bulletin d’Infor-
mation en Hygiène Hospitalière ( B.I.H.H., 18, 29 - 52;
1996).
Voir aussi:http://www.md.ucl.ac.be/didac/hosp/cours/isol.htm
En 1998, sur les mêmes bases, avec un même souci de
standardisation et de simplification du travail sur le ter-
rain, le Comité Technique National des Infections Noso-
comiales (France) en collaboration avec la Société Fran-
çaise d’Hygiène Hospitalière publie " L’isolement sep-
tique – Recommandations pour les établissements de
soins " (Ministère de l’emploi et du travail – Direction de
la santé).
Accès : http://nosobase.univ-lyon1.fr/recommandations/Rmi-
nistere.htm
http://nosobase.univ-lyon1.fr/recommandations/Ministere/iso-
lement.pdf
En octobre 2000, les mesures fondamentales de précau-
tions, recommandations lors de toute activité de soins,
sont redéfinies en introduction au document "Recom-
mandations pour la préventions des infections nosoco-
miales" sous l’intitulé "Précautions générales”. Ce docu-
ment est élaboré par le Conseil Supérieur d’Hygiène du
Ministère des Affaires sociales, de la Santé Publique et
de l’Environnement (Belgique) et a été publié dans
Noso-info, vol. 5 - N° 1 (2001). Il conclut en ces termes:
un patient atteint d’une affection contagieuse, qui pré-
sente un risque de contamination du personnel, des
autres patients ou de l’entourage et, qui, par ailleurs, a
un comportement hygiénique inadéquat, est soumis à
des précautions particulières d’isolement.
Voir aussi : http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Francais/
Brochures/nosocomiale%20infectiesfr.htm
L’année 2001 jette le trouble dans les esprits. A l’occa-
sion du XIIIème Congrès national d’hygiène hospitalière
organisé par la Société Française d’Hygiène Hospitalière
qui s’est tenu à Lille au début du mois de juin, un exposé
intitulé " L’isolement septique : sa place dans l’hôpital "
met en présence deux avis contradictoires : Pour : J.C.
Lucet (Paris) – Contre : G. Beaucaire (Tourcoing).
Notons qu’il s’agissait uniquement de l’intérêt des isole-
ments pour des germes multi-résistants et principale-
ment dans les services de réanimation. Des deux expo-
sés défendus, il ressort du " Pour " la mise en place des
précautions décrites dans toutes les directives citées ci-
dessus ; du " Contre ", le rejet du terme d’isolement, mais
l’accord du respect de certaines précautions dont l’hy-
giène des mains (lavage et/ou désinfection), port de
gants, de masque ainsi que l’organisation de cohortes, le
placement de malades en chambre individuelle en cas
de tuberculose pulmonaire ouverte, le recours à la fer-
meture de service en cas d’épidémie…, mais le maintien
du principe du rejet de l’isolement !
S’agit-il d’une guerre de terminologie, de sémantique,
ou d’une remise en question d’une méthode de travail ?
La proposition de l’équipe liégeoise dans l’article qui
suit, que certains membres du comité de rédaction
considèrent comme susceptible d’introduire la confu-
sion, rejoint-elle cette remise en question ? Le lecteur
pourra se forger sa propre opinion
…

NOSO-info-vol.V, n°3, 2001
4
Patrick De Mol, Jacques Mutsers, Geneviève Christiaens, Unité d’Hygiène Hospitalière, CHU de Liège
Le concept d’isolement
La notion d’isolement désigne traditionnellement une
situation de séparation (de «isola » : île) ou plus parti-
culièrement la position d’un détenu, d’un aliéné ou
d’un malade contagieux que l’on isole (Le Petit Robert).
Dans ces derniers cas, il s’agit donc d’écarter un indi-
vidu présentant un danger, quel qu’il soit, de la société
des hommes pour protéger celle-ci de celui-là.
Cette notion-là d’isolement est très distante du souci
qui prévaut aujourd’hui de rendre l’hospitalisation du
patient la plus rassurante possible. Elle ne tient pas
davantage compte de l’évolution des précautions
jugées nécessaires et suffisantes pour éviter la diffusion
des infections transmissibles (exit aussi le terme de
«contagieuse »). Elle reste cependant bien ancrée dans
les esprits attachés aux rituels de la médecine.
L’évolution actuelle tend à traduire le concept d’isole-
ment par l’association d’une série de mesures qui font
barrière à la dissémination des agents infectieux trans-
missibles. Dans le cadre du contrôle des infections,
l’isolement n’est plus un enfermement. Il est le résultat
de l ’addition de mesures de précautions. L’objectif est
d’interrompre la transmission d ’agents infectieux à par-
tir d’un réservoir humain ou environnemental. L’assimi-
lation en particulier de la notion d’isolement à la mise
en chambre individuelle n’est plus automatique. L’iso-
lement n’en est donc plus un. Pourquoi donc encore
l’évoquer ?
Il reste à déterminer quelles sont ces associations de
précautions, en particulier dans un contexte de coûts
acceptables.
Quelles précautions, pour quelles situations ?
Plusieurs études, françaises par exemple [10, 11], ont
comparé des périodes pendant lesquelles aucune
mesure de prévention n’était prise, à d’autres pendant
lesquelles des associations de précautions étaient
adoptées. Elles ont montré une diminution de préva-
lence d’infections à MRSA (Staphylococcus aureus
résistant à la méthicilline) quand étaient associés
chambre seule, port de gants, de masque et blouse,
pour «isoler » les patients. Cependant, la diminution
observée de prévalence peut être attribuée aussi bien à
des fluctuations naturelles de fréquence dans le temps,
à la sensibilisation du personnel qui accompagne les
études, aux modifications de la politique d’antibiothé-
rapie, aux variations de durée d’hospitalisation ainsi
qu’à la fréquence variable de prélèvements pour la
recherche de MRSA, qu’aux mesures elles-mêmes. Par
ailleurs, l’impact des mesures prises une à une n’est pas
envisagé.
Dans certaines situations, l’efficacité de mesures
d’«isolement» est incontestable. Par exemple, en 1995,
lors de l’épidémie de fièvre d’Ebola qui s’est dévelop-
pée dans la ville de Kikwit au Congo, des mesures
strictes de quarantaine ont été instaurées (enfermement
des patients et de l’équipe médicale dans un pavillon,
vêtements protecteurs pour le personnel de santé, inci-
nération de tout matériel contaminé et des corps des
patients décédés) ; elles ont permis le contrôle rapide
de la dissémination de cette fièvre hémorragique [8].
Pour ce qui concerne un contexte proche du nôtre, au
sein d’un secteur néo-natal de soins intensifs (Virginie,
USA), le bénéfice de mesures de précautions pour
empêcher la dissémination de MRSA a été clairement
démontré [6] : il s’agissait de mettre un masque si l’on
s’approchait de l’enfant porteur de moins d’1 m 50 et
d’ajouter blouse et gants si on le touchait. Le taux de
transmission observé en l’absence de mesures de pré-
cautions était dix fois plus important qu’en présence de
celles-ci.
Cependant, le bénéfice des mesures de précautions est
variable selon l’agent infectieux en cause : Bernards et
ses co-auteurs rapportent l’admission dans 3 hôpitaux
différents des Pays-Bas de 3 patients hospitalisés aupa-
ravant dans des pays du bord de la Méditerranée [1].
Ces patients étaient porteurs d’ Acinetobacter baumanii
multirésistants et de MRSA. Un isolement strict leur a
été appliqué dès l’hospitalisation aux Pays-Bas.
Aucune transmission secondaire de MRSA n’a été
observée, tandis que, dans deux cas sur trois, les Acine-
tobacter ont franchi les barrières mises en place et se
sont disséminés dans l’institution concernée. L’impres-
sion qui prévaut est que les précautions concernant les
contacts ont été efficaces pour empêcher la diffusion de
MRSA et que les Acinetobacter ont pris d’autres che-
mins comme la voie aérienne en profitant de leur
remarquable résistance au dessèchement.
Une épidémie de Pseudomonas aeruginosa multirésis-
tants a été rapportée dans une unité de soins intensifs
neurochirurgicaux [2]. A partir d’un cas index se sont
développés 36 cas d’infections et de colonisations en
16 mois ; des mesures d’« isolement » ont été appli-
quées et elles ont été associées à un accroissement du
nombre de cas. Comme classiquement rapporté, la
Isolement septique : un terme désuet pour une notion périmée ?
ARTICLE ORIGINAL

NOSO-info-vol.V, n°3, 2001
5
souche résistante a été isolée dans l’eau du robinet,
dans les éviers et dans des solutions entérales. Les
auteurs ont dès lors appliqué des mesures de désinfec-
tion de la plomberie, ont changé certains éléments de
celle-ci et ont modifié la procédure de préparation des
solutions entérales. L’application de l’ensemble des
mesures a été suivie de l’extinction de l’épidémie. A
nouveau, l’isolement en soi n’avait pas de sens mais ce
sont les mesures adaptées de contrôle qui ont permis
l’interruption de la transmission.
Au sein d’un hôpital de l’Arkansas, Malone et Larson
[7] ont tenté d’identifier les facteurs associés à une
réduction de taux d’infections nosocomiales. Avant
1993, le taux de ces infections se situait constamment
autour de 3,9 %. En 1993, les précautions universelles
ont été introduites, associées à l’usage d’une mousse
protectrice contre l’allergie au latex. La quantité de
gants employés dans l’institution a doublé pendant que
le taux d’infection chutait à 2,6 %.
Dans une perspective voisine, Pittet et ses collabora-
teurs [9] ont récemment rapporté leur expérience de
promotion de l’hygiène des mains dans un hôpital uni-
versitaire de Genève. D’une part, les campagnes de
sensibilisation ont amélioré le respect par le personnel
de l’hygiène des mains, d’autre part l’usage de solution
hydro-alcoolique a joué un rôle important dans cette
amélioration. Par ailleurs, pendant la période où la
campagne de promotion a été menée, la prévalence
d’infections nosocomiales a diminué de même que le
taux de transmission des MRSA. Enfin, il existe une
relation directe entre la fréquence des infections intra-
hospitalières et le rapport entre le nombre de malades
et le nombre d’infirmiers qui en ont la charge [4]. C’est
sans doute évoquer une évidence que de vouloir
démontrer que l’essentiel des transmissions nosoco-
miales survient quand le personnel est réduit (jours
fériés, nuits).
Conclusions
En guise d’épilogue, le souci de vouloir bannir le terme
d’isolement peut apparaître comme une futile préoccu-
pation de sémantique puisqu’il s’agit de le remplacer
par la notion de prévention de la transmission.
Cependant il faut reconnaître que la notion d’isolement
comporte des connotations indésirables qui génèrent
une distanciation du malade qui n’est pas souhaitable,
qui donnent au personnel soignant une fausse impres-
sion de sécurité contre la dissémination des agents
infectieux et enfin, qui occasionnent des dépenses qui
ne sont pas nécessaires.
En pratique, dans les services de soins, le concept qui
doit prévaloir est celui de l’application systématique
des précautions pour tous les patients hospitalisés ;
celles-ci sont indépendantes du diagnostic ou de la
situation d’infection et concernent tous les profession-
nels de la santé. L’adhésion à ces précautions générales
(en particulier, lavage des mains, utilisation d’une solu-
tion de désinfection manuelle hydro-alcoolique, port
de gants) constitue la stratégie de base pour le contrôle
de la transmission des agents infectieux à l’hôpital
[3,5].
Des précautions additionnelles sont recommandées
pour les soins de patients spécifiques. Le fondement de
ces précautions complémentaires, c’est l’interruption
de transmission ; elles ne concernent que les sujets
infectés ou colonisés ou suspects de l ‘être par des
micro-organismes pathogènes dont les modes de trans-
mission sont bien caractérisés : microgouttelettes aéro-
portées (exemple : bacilles tuberculeux), gouttelettes de
sécrétions pharyngées (exemple : méningocoques) ou
encore par contact avec la peau sèche ou des surfaces
contaminées. (exemple : Acinetobacter spp, staphylo-
coques).
Enfin, il s’agit tout autant de valoriser systématiquement
l’adéquation des gestes de tous les acteurs médicaux
que de veiller à ce que l’effectif de ceux-ci soient en
rapport avec la pratique des précautions qui leur sont
imposées.
Bibliographie
1. Bernards A, Frenay H, Lim B, Hendriks W, Dijkshoorn L, van
Boven C. Methicillin resistant Staphylococcus aureus and Acineto-
bacter baumanii: an unexpected difference in epidemiological beha-
viour. Am J Infect Control 1998; 26:544-551.
2. Bert F, Maubec E, Bruneau B, Berry P, Lambert-Zechovsky N. Mul-
tiresistant Pseudomonas aeruginosa outbreak in a neurosurgery
intensive care unit. J Hosp Infect 1998; 39:53-62.
3. Bouvert E et Brucker G. L’isolement en pratique hospitalière. Med
Mal Infect 1998 ; 28 Special :485-491.
4. Fridkin et coll. Inf Control Hosp Epidemiol 1996; 17:150
5. Guidelines for isolation precautions in hospitals. PART II. Recom-
mendations for isolation precautions in hospitals. AJIC 1996 ; 24 :
24-52.
6. Jernigan J., Titus M, Gröschel D, Getchell-White S, Farr B. Effecti-
veness of contact isolation during a hospital outbreak of methicillin-
resistant Staphylococcus aureus. Am J Epidemiol 1996; 143:496-504.
7. Malone N, Larson E. Factors associated with a significant reduc-
tion in hospital-wide infection rate. Am J infect control 1996; 24:180-
185.
8. Muyembe-Tamfum JJ, Kipasa M, Kiyungu C, Colenbunders R.
Ebola outbreak in Kikwit, Democratic Republic of the Congo: disco-
very and control measures. J Infect Dis 1999; 179 (suppl 1):S259-
262.
9. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V, Touve-
neau S, Perneger T. Effectiveness of a hospital-wide programme to
improve compliance with hand hygiene. Lancet 2000; 356:1307-
1312.
10. Richet H, Wiesel M, Le Gallou F, André-Richet B, Espaze E.
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus control in hospitals : the
French experience. Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17:509-
511.
11. Souweine B, Traore O, Aublet-Cuvelier B., Bret L, Laveran H,
Sirot J, Deteix P. Role of infection control measures in limiting morbi-
dity associated with multiresistant organisms in critically ill patients.
J Hosp Infect 2000; 45:107-116.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%
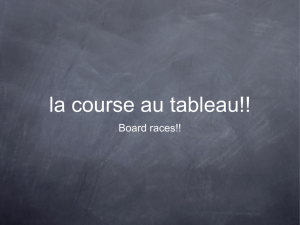

![Suggested translation[1] He learned[2] to dress tastefully. He moved](http://s1.studylibfr.com/store/data/005385129_1-269daba301ff059de68303e1bc025887-300x300.png)