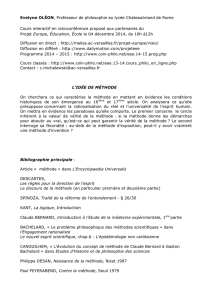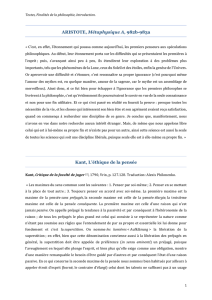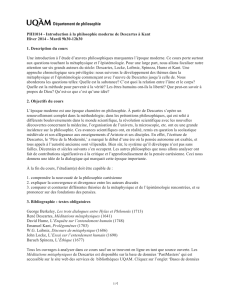L`erreur – 2 - E_Studium Thomas d`Aquin

Michel Nodé-Langlois, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de
philosophie, Professeur en Première Supérieure au lycée Pierre de Fermat à
Toulouse, nous offre une longue dissertation sur « l’erreur ». Celle-ci vient en point
d’orgue au Grand Débat passionnant du forum sur « Qu’est-ce qu’une philosophie
réaliste ? » Compte tenu de son importance, nous la publierons en trois parties.
L’erreur – 2 –
2ème Partie
Reste que cette seule possibilité ne suffit pas à expliquer l’existence de
l’erreur, soit à expliquer pourquoi l’on se trompe. S’il est vrai que la connaissance
certaine, autrement dénommée science, fait échapper à l’erreur, on peut voir dans
l’erreur la manifestation d’une ignorance, donc peu ou prou considérer celle-là
comme l’effet de celle-ci. Cette explication paraît pourtant insuffisante puisque,
comme on l’a vu, on ne saurait se tromper sur ce qu’on ignore absolument : pour
pouvoir faire erreur, juger à tort, il faut au moins un sujet ayant un sens déterminé,
c'est-à-dire désignant une réalité identifiable ; s’il était dépourvu de sens (Sinnlos) –
tel le babu de Carnap1 –, il ne permettrait pas d’énoncer le faux plutôt que le vrai.
Avant 1930, personne ne pouvait se tromper au sujet de Pluton, si ce n’est en énon-
çant quelque chose qui, se référant à du déjà connu, pouvait déjà le concerner, mais
à l’insu de tous : par exemple en énonçant qu’il n’y a que huit planètes dans notre
système solaire. L’ignorance n’est qu’une absence de connaissance, c'est-à-dire une
pure négation qui, en tant que telle, n’est rien et ne saurait causer positivement quoi
que ce soit. C'est pourquoi Spinoza écrit que « la fausseté ne peut consister dans
une privation absolue de connaissance » – car les minéraux, dont la nature ne com-
porte aucune faculté cognitive, ne peuvent « errer ni se tromper » –, « non plus que
dans une ignorance absolue »2 : ainsi, lorsque, regardant « le soleil, nous imaginons
qu’il est distant de nous d’environ deux cents pieds, (...) l’erreur ne consiste pas dans
l’action d’imaginer cela, prise en elle-même, mais en ce que, tandis que nous
l’imaginons, nous ignorons la vraie distance du soleil et la cause de cette imagination
que nous avons »3. Pour qu’il y ait erreur, il faut qu’à la négativité de l’ignorance se
conjugue la positivité d’une connaissance – ici : une impression qui, en tant qu’elle
ne peut être autre, n’est en rien fautive : « il n’y a dans les idées rien de positif à
cause de quoi elles sont dites fausses »4.
1 Carnap, Le dépassement de la métaphysique par l’analyse logique du langage.
2 Spinoza, Éthique, 2ème partie, Prop. XXXV, Dém.
3 Ibid., Scolie.
4 Ibid., Prop. XXXIII.
1

Si donc l’ignorance n’est que la condition plutôt que la cause de l’erreur, il faut
chercher celle-ci ailleurs, surtout si l’on admet avec Spinoza que « pour toute chose,
on doit assigner une cause ou raison tant de son existence que de son inexis-
tence »5. Si l’impression produite par le soleil peut être un facteur d’erreur, c’est en
fait parce qu'elle appartient au registre des représentations sensibles – ou imaginai-
res au sens large, c'est-à-dire en identifiant l’imagination et le sens commun
d’Aristote6. Ces représentations constituent ce que Spinoza dénomme
« connaissance du premier genre », et il les considère comme des « idées inadéqua-
tes, c'est-à-dire mutilées et confuses », qui par suite « enveloppent (involvunt) » la
« privation de connaissance » en quoi « la fausseté consiste »7. L’explication de
l’erreur ne fait qu’exprimer le rationalisme de Spinoza puisque ce qui fait
l’inadéquation des représentations sensibles ou imaginaires, c’est l’inconscience
qu’elles comportent des causes qui les expliquent, et dont la juste connaissance re-
vient à la raison : c’est ainsi que les calculs de l’astronome et les modélisations géo-
métriques de l’opticien feront de l’impression produite par le soleil une source de véri-
té plutôt que d’erreur. À l' « opinion ou Imagination » du premier genre, la
« Connaissance du deuxième genre », ou « Raison », substitue ainsi « des notions
communes et des idées adéquates des propriétés des choses »8, c'est-à-dire des
axiomes et des définitions. Mais cette science discursive renvoie elle-même « un
troisième (...) genre de connaissance », ou « Science intuitive », qui « procède de
l’idée adéquate de l’essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance
adéquate de l’essence des choses »9. C’est pourquoi Spinoza écrit que « toutes les
idées, considérées dans leur rapport avec Dieu, sont vraies »10 : expliquer, c’est en
effet montrer pourquoi une chose est ou se produit nécessairement comme elle est,
ce qui revient fondamentalement pour Spinoza à montrer comment elle découle né-
cessairement de la nature de l’être absolu, autrement appelé Dieu, car « tout ce qui
est, est en Dieu, et rien sans Dieu ne peut être ni être conçu »11, et « de la nécessité
de la nature divine doivent suivre en une infinité de modes une infinité de choses,
c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini »12. Ainsi toute
connaissance adéquate consiste à se représenter une chose comme explicable en
tant qu’elle découle nécessairement de l’essence éternelle de l’être absolument né-
cessaire.
Expliquer l’erreur reviendra alors à montrer non seulement comment elle est
possible, mais plutôt en quoi elle est nécessaire. On peut toutefois se demander si ce
qui est censé expliquer l’erreur n’est pas plutôt ce qui la rend inexplicable. Si en effet
l’on admet avec Spinoza que « l’Âme humaine est une partie de l’entendement infini
de Dieu »13, soit un mode de « la pensée » qui « est un attribut de Dieu »14, il faut en
conclure que l’idée inadéquate, en tant que mode de la pensée humaine15, est aussi
une modification de la pensée divine, et que, dans l’erreur, c’est Dieu qui est inadé-
quat à lui-même, bien que cette inadéquation découle de sa propre essence, en tant
que celle-ci se définit par un attribut de pensée qui est un entendement infini se
5 Op.cit., 1ère partie, Prop. XI, 2ème dém.
6 Op.cit., 2ème partie, Prop. XLI et 2ème Scolie de la précédente.
7 Ibid., Prop. XXXV.
8 Ibid., 2ème Scolie de la Prop. XL.
9 Ibid.
10 Ibid., Prop. XXXII.
11 Op.cit., 1ère partie, Prop. XV.
12 Ibid., Prop. XVI.
13 Op.cit., 2ème partie, Prop. XI, Corollaire.
14 Ibid., Prop. I.
15 Ibid., Scolie de la Prop. XLIII.
2

connaissant éternellement lui-même16. On éliminera difficilement la contradiction en
disant que l’inadéquation est entre Dieu considéré comme partie et Dieu considéré
comme tout17, car on voit mal comment, sauf à récuser le rationalisme, une connais-
sance inadéquate pourrait s’ensuivre par une nécessité rationnelle d’une connais-
sance absolument adéquate. Spinoza admet que « toutes les idées qui suivent dans
l’Âme des idées qui sont en elles adéquates sont aussi adéquates »18 : il s’agit là en
effet d’un principe présupposé à toute démonstration rationnelle, à savoir que du vrai
on ne peut déduire que le vrai, tandis que, comme l’avait établi la syllogistique aristo-
télicienne, on peut conclure de prémisses fausses aussi bien le faux que le vrai. Or si
« l’ordre et la connexion des idées sont le même que l’ordre et la connexion des cho-
ses », et que cet ordre n’est autre que la nécessité intrinsèque de l’essence divine
considérée comme pensée, il paraît contradictoire qu’une quelconque pensée inadé-
quate puisse découler de ce qui est en fait la seule « idée vraie (...) donnée »19, à
savoir celle de Dieu comme être « dont l’essence enveloppe l’existence »20. La
contradiction vient de ce que l’ « ordre géométrique de l’Éthique implique que la rela-
tion de Dieu à ses modes ne puisse être pensée que comme celle d’une essence à
ses propriétés, à l’exclusion de tout accident21. Éviter cette contradiction ne paraît
alors possible que s’il ne s’agit plus d’expliquer l’erreur en présumant sa nécessité,
mais d’en rendre compte en admettant plutôt sa contingence et son caractère acci-
dentel, ce qui revient évidemment à renoncer au monisme panthéiste et nécessita-
riste.
C’est bien là ce que Kant a entrepris, en traitant de la connaissance d’un point
de vue purement anthropologique, résolument scindé de toute entreprise de fonda-
tion rationnelle dans les termes d’une ontologie métaphysique. Cette dissociation
caractéristique de la philosophie critique lui permet d’ailleurs d’assumer l’héritage du
rationalisme classique, mais dans le but explicite d’éviter les apories auxquelles il
s’était trouvé conduit, notamment dans le spinozisme, repoussoir majeur de Kant22.
Ainsi l’idée d’une infaillibilité de l’entendement divin, en sa qualité d’intuitus origina-
rius, est conservée comme horizon nouménal de notre pouvoir de connaître, comme
l’autre pensable de notre connaissance, laquelle est l’œuvre d’un entendement qui
n’est pas intuitif – auquel il ne suffit pas de penser pour connaître, l’erreur en est la
preuve – mais doit recevoir ses objets de cet intuitus derivativus qu’est la sensibili-
té23. Or c’est cette dualité des sources de notre connaissance qui, pour Kant comme
pour le rationalisme classique, rend l’erreur possible. Si en effet l’on admet que,
comme on l’a vu, l’entendement est capable tout à la fois de révéler et de rectifier
des erreurs de jugement inspirées par les apparences sensibles, on admettra aussi
qu’en n’obéissant qu’à lui-même, l’entendement ne doit pas pouvoir se tromper :
« Dans une connaissance qui s’accorde totalement avec les lois de l’entendement, il
16 Ibid., Prop. III et IV.
17 Ibid., Prop. XI, Corollaire.
18 Ibid., Prop. XL.
19 Id., Traité de la Réforme de l’Entendement, §§ 27-28. Voir aussi : ibid., § 57 et Éthique, 2ème partie, Prop.
XLVII
20 Id., Éthique, 1ère partie, Définition 1.
21 La distinction du propre et de l’accident est faite par Aristote au ch.5 du 1er Livre des Topiques.
22 « Si l’on n’admet pas [l’]idéalité de l’espace et du temps, il ne reste plus que le spinozisme (nur allein der Spi-
nozismus übrig bleibt), dans lequel espace et temps sont des déterminations essentielles de l’être primitif (Urwe-
sens) lui-même, tandis que les choses qui dépendent de lui (nous-mêmes aussi par conséquent) ne sont pas des
substances, mais seulement des accidents (Aksidenzen) qui lui sont inhérents » (Kant, Critique de la Raison
pratique, Éclaircissement de l’Analytique, éd. Meiner, p.118 ; trad. PUF p.108).
23 Kant, Critique de la Raison pure, Esthétique transcendantale, § 8, IV.
3

n’y a pas d’erreur »24. Dès lors, « si nous n’avions aucune autre faculté de connais-
sance que l’entendement, nous ne ferions jamais d’erreur. Mais, outre l’entendement,
il y a encore en nous une autre source de connaissance dont on ne peut se passer. Il
s’agit de la sensibilité, qui fournit sa matière à notre pensée et, ce faisant, agit selon
d’autres lois que l’entendement »25. L’erreur n’en reste pas moins « difficile à conce-
voir »26 par là, car « dans une représentation des sens (puisqu’elle ne renferme pas
de jugement), il n’y a pas non plus d’erreur »27. Ce n’est donc pas « de la sensibilité
considérée en elle-même que l’erreur peut surgir »28. Reste alors que l’erreur pro-
vienne de « l’influence inaperçue (unbemerkten Einfluss) de la sensibilité sur
l’entendement, par quoi il arrive que les principes (Gründe) subjectifs du jugement »
– les impressions sensibles, en tant que telles relatives à la conscience individuelle –
« viennent se mêler avec les principes objectifs » – les a priori intellectuels, qui ont
seuls une validité universelle – « et les font dévier de leur destination »29. C’est alors
« qu’en jugeant on tient pour objectives des raisons simplement subjectives, et que
l’on confond en conséquence la simple apparence de vérité avec la vérité elle-même.
Car c’est en cela que consiste justement l’essence de l’apparence (Schein), qui de
ce fait peut être considérée comme une raison de tenir pour vraie une connaissance
fausse »30. C’est le cas lorsque « l’on va jusqu’à nier d’une chose le caractère que
l’on ne perçoit pas en elle, et que l’on juge que ce dont on n’est pas conscient dans
une chose n’existe pas »31, soit lorsque l’on prétend réduire l’être à l’apparaître.
L’erreur n’est ainsi pensable pour Kant que comme « diagonale de deux for-
ces »32, celle de l’entendement, dont la fonction propre est de juger, et celle de la
sensibilité, à qui il revient de donner des intuitions subsumables à des concepts dans
le jugement33. Or le rôle de la sensibilité apparaît de ce fait même ambigu : avant d’y
trouver la source de l’erreur, Kant y a vu plutôt le principe inamissible de toute vérité
énonçable. « Des pensées sans contenu » – lequel ne peut être fourni que par
l’intuition sensible – « sont vides »34 et ne peuvent donc constituer une connais-
sance. C’est à un tel manque que Kant attribue « l’apparence transcendan-
tale (transzendentale Schein) »35, à ses yeux caractéristique de la métaphysique
précritique. Mais ici la difficulté est redoublée, car l’analyse de cette illusion paraît
contredire la précédente interprétation de l’erreur. Celle-ci en effet n’a pas consisté à
énoncer des propositions fausses, mais à présenter comme théoriquement vraies
des propositions en fait indécidables, parce qu’impossibles à vérifier empiriquement
alors même qu’elles pourraient être logiquement conclues : telles l’existence de Dieu
ou l’immortalité de l’âme. L’appréhension de ces objets par une pure déduction ra-
tionnelle donne une impression de connaissance qui, tout comme l’illusion sensible,
« ne cesse pas, même après qu’on [en] a découvert »36 l’apparence : il n’y a pas
24 Op.cit., Dialectique transcendantale, Introduction, I.
25 Id., Logique, Introduction, VII. C’est ce que paraît signifier la deuxième partie du dicton déjà cité : « Perse-
verare diabolicum ». L’homme est jugé coupable, et damnable comme un démon, seulement s’il s’obstine dans
une erreur qui lui a été démontrée telle. C’est dire que la faillibilité qui rend ses erreurs excusables tient à ce qui
distingue sa nature de celle des anges déchus, lesquels, intelligences pures, sont dépourvus de sensibilité.
26 Ibid.
27 Id., Critique de la Raison pure, Dialectique transcendantale, Introduction, I.
28 Id., Logique, Introduction, VII.
29 Id., Critique de la Raison pure, Dialectique transcendantale, Introduction, I.
30 Id., Logique, Introduction, VII.
31 Id., Recherche sur l’évidence des principes de la théologie naturelle et de la morale, § 1.
32 Id., Critique de la Raison pure, Dialectique transcendantale, Introduction, I.
33 Op.cit., Logique transcendantale, Introduction, I, et Analytique des concepts, ch.1, 1ère section.
34 Op.cit., Logique transcendantale, Introduction, I.
35 Op.cit., Dialectique transcendantale, Introduction, I.
36 Ibid.
4

d’erreur – métaphysique – à affirmer de tels objets, car leur négation n’est pas plus
connaissable que leur affirmation, mais il y en a une – critique – à prétendre qu’elles
pourraient l’être. Or, dans la mesure même où il s’agit ici d’objets métempiriques,
purement pensables, on ne voit en quoi une telle erreur pourrait résulter de
l’influence inaperçue de la sensibilité. Si erreur il y a ici, elle semble de celles qui se
produisent « dans les pensées elles-mêmes (en autoïs toïs dianoèmasin) », et qui
faisaient dire à Platon « qu’il faut voir dans le jugement faux (to ta pseudè doxazeïn)
tout autre chose qu’un écart (parallagèn) entre la pensée et la sensation »37. Si l’on
en croit Kant, il y a des erreurs philosophiques – telle la prétention dite dogmatique à
une métaphysique théorique – qui relèvent de la pensée et n’ont aucun rapport avec
la sensibilité, laquelle n’y est pas concernée et n’y peut rien décider : car s’il est vrai
qu’il n’y a de connaissance que là où une vérification empirique est possible, et faux
de prétendre le contraire, ce n’est assurément pas une expérience sensible qui peut
l’attester.
Il semble dès lors qu’il faille faire consister l’erreur dans un jugement porté à la
fois au-delà et en dépit de ce que les sens et l’entendement donnent à connaître. La
cause de l’erreur est donc à chercher dans « notre propre penchant à juger et à dé-
cider même là où, en raison de notre caractère borné, nous n’avons pas le pouvoir
de juger ni de décider »38. Plutôt qu’à la sensibilité, c’est à l’affectivité qu’il faut attri-
buer l’influence inaperçue qui entraîne le jugement erroné : car « aux jugements de
l’entendement se lient d’autres activités de l’âme comme l’excitation, l’imagination,
etc. »39 Ainsi l’on peut dire que « l’erreur naît : 1°/ du désir de connaissance ; 2°/ du
manque de concepts de base nécessaires ; 3°/ de la négligence dans l’attention »40 :
l’erreur provient de cela même qui nous fait désirer la connaissance et ne va pas
sans un besoin de certitude, qui nous fait juger avant d’avoir vérifié. Elle consisterait
en ce sens à prendre, comme on dit, ses désirs pour des réalités. Or, en attribuant
l’erreur à un manque d’attention, la philosophie critique paraît sous cet aspect encore
fort proche des rationalismes antérieurs puisqu’elle nous ramène en fait à
l’explication cartésienne de l’erreur. Si l’erreur réside dans un acte de jugement qui
est porté en dépit de ce que l’entendement sait, il faut que cet acte relève d’une fa-
culté autre que l’entendement lui-même. Les sens et l’imagination étant hors de
cause puisqu’ils ne jugent pas, Descartes ne trouve plus que la volonté pour expli-
quer qu’il puisse y avoir un jugement faux : « D’où est-ce donc que naissent mes er-
reurs ? C’est à savoir, de cela seul que, la volonté étant beaucoup plus ample et plus
étendue que l’entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais que
je l’étends aussi aux choses que je n’entends pas »41. La solution cartésienne au
problème de l’erreur revient ainsi à faire du jugement un acte volontaire et non pas
purement intellectuel : « Car par l’entendement seul je n’assure ni ne nie aucune
chose, mais je conçois seulement les idées des choses, que je puis assurer ou
nier »42. Autrement dit, l’entendement n’est pour Descartes qu’une puissance passive
de représentation, tandis que le jugement relève de cette unique puissance active de
l’âme qu’est la volonté43. Descartes en trouve la preuve a contrario dans son
« expérience »44 : « il est en ma puissance de suspendre mon jugement »45, et donc
37 Platon, Théétète, 196c 4.
38 Kant, Logique, Introduction, VII.
39 Id., Nachlass, Réfl. 2244.
40 Ibid., Réfl. 2242.
41 Descartes, 4ème Méditation, § 10.
42 Ibid., § 9.
43 Id., Les Passions de l’âme, a. 17.
44 Id., Principes de la Philosophie, 1ère partie, a. 39.
45 Id., 1ère Méditation, § 12.
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%

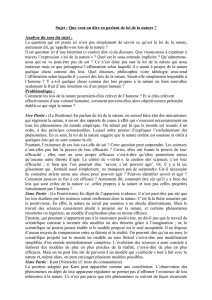

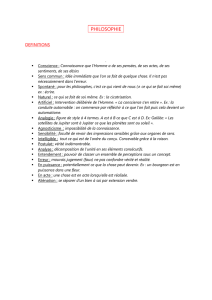

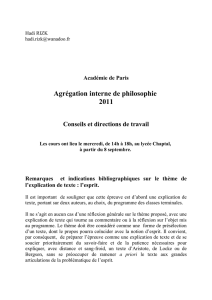
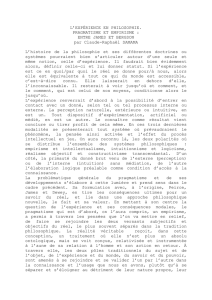
![Recherche sur KANT I] Transcendantale ? Kant tente comprendre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001600150_1-ae15d742a4e5280f0b6598fe66bb33ca-300x300.png)