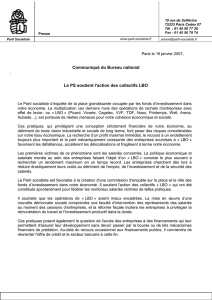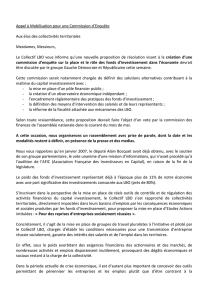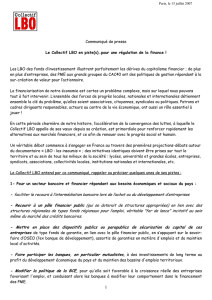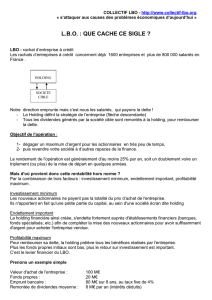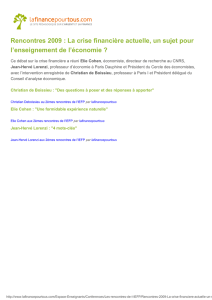LE RÔLE ÉCONOMIQUE DU PRIVATE EQUITY

LE RÔLE ÉCONOMIQUE DU PRIVATE EQUITY
19
* Professeur, université Paris Dauphine.
** Chef économiste, Scor.
LE RÔLE ÉCONOMIQUE
DU PRIVATE EQUITY
JEAN-HERVÉ LORENZI *
PHILIPPE TRAINAR **
L’année 2008 sera, sans nul doute, celle de la réorganisation la plus
importante que le capitalisme financier mondial ait connue
depuis un demi-siècle. Nul ne peut, aujourd’hui, se prononcer
clairement sur l’impact qu’elle aura sur la conjoncture mondiale. Mais
une chose est certaine, elle modifiera profondément le rôle, l’impor-
tance, le statut et le développement du capital-investissement ou private
equity, et cela sur deux points :
- ce qu’on appelle les grandes opérations de LBO (leveraged buy-out)
voient déjà leurs conditions de financement être modifiées signifi-
cativement, au point qu’on peut raisonnablement imaginer qu’elles
ne représenteront plus un patrimoine de rentabilité sur les marchés
financiers ;
- mais le ralentissement de ce type d’opération s’accompagnera proba-
blement d’un renforcement très significatif des opérations de capital-
investissement de taille plus modeste, moins fondées sur des effets
d’endettements.
En un mot, la crise des marchés financiers va entraîner globalement
un renforcement très significatif de ce type de financement de l’écono-
mie, jusqu’à lui donner un rôle majeur dans la restructuration du tissu
productif des grandes économies développées. Cette conviction, nous
jugeons qu’elle est particulièrement vérifiée dans le cadre de l’économie
française. Tout simplement parce que les milliers d’entreprises de
taille moyenne qui composent une large partie de la structure productive
LORENZI 15/10/08, 14:5019

REVUE D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE
20
de notre pays, n’ont pas aujourd’hui et auront encore moins demain,
d’autres sources de financement que celles du capital-investissement.
C’est la raison pour laquelle il s’agit d’établir ici à la fois un diagnostic
- non, le capital-investissement n’a pas de résultats exceptionnels sur le
marché financier -, une analyse - oui, le capital-investissement a une
efficacité très forte dans la relation actionnaire-management - et d’être
une force de proposition, pour permettre à cette classe d’actifs de se
développer de manière accélérée en France.
Quatre propositions nous paraissent devoir être retenues en priorité
parce que emblématiques et parce que facteurs de dynamisation de
notre économie. Ce sont à elles que nous pensons prioritairement
pour optimiser le financement de l’économie française et tout parti-
culièrement de ces petites et moyennes entreprises (PME), dont nous
n’arrêtons pas de parler dans les divers rapports et qui, en fait, ne
font que rarement l’objet d’une véritable politique économique signi-
ficative.
Pour résumer et schématiser, il nous semble d’abord qu’il faut revoir
la régulation du système bancaire et du monde des assurances de
manière à ne pas freiner, ou même pénaliser l’investissement dans le
capital-investissement. Aujourd’hui, c’est tout l’inverse qui se passe.
Ensuite, nous avons inventé de multiples formes de détaxations
fiscales pour les fonds communs de placement à risque (FCPR), fonds
communs de placement dans l’innovation (FCPI) et autres catégories
de supports financiers destinées à investir dans des PME non cotées.
Tout cela est bien, mais trop compliqué et il nous faut garantir
une simplification et neutralité fiscale totale. Notre proposition est
claire : tout investissement dans une PME doit faire l’objet d’une
incitation significative, mais uniquement à due proportion de la
partie du véhicule financier qui a cet objet. Au contribuable de faire la
preuve qu’il s’agit d’investissement dans le non-coté.
Troisième acte, nous n’arrêtons pas de parler de small business
administration. Tous les motifs juridiques sont bons pour justifier
l’absence d’action dans ce domaine. Faisons-le une fois pour toutes en
y intégrant un volet absolument nécessaire, qui est celui de la prise en
compte des business angels, si essentiel dans la création d’innovations
aux États-Unis.
Enfin, chacun connaît les débats qui ont eu lieu aux États-Unis et
au Royaume-Uni, à propos de la fiscalité des gérants de fonds du
capital-investissement. Décidons une fois pour toutes, que les avantages
fiscaux dont ils disposent sont directement liés au partage, au sein des
entreprises, des plus-values réalisées.
Ainsi, quatre principes pourraient relancer le financement des PME
et de l’innovation en France en instituant le capital-investissement
LORENZI 15/10/08, 14:5020

LE RÔLE ÉCONOMIQUE DU PRIVATE EQUITY
21
comme instrument privilégié : une régulation favorable, une neutralité
fiscale, un objectif de la politique des PME et une équité dans la
redistribution des résultats.
Mais pour que tout cela ait lieu, il faut bien comprendre le rôle central
que pourrait jouer le capital-investissement dans le renouvellement
du capitalisme français.
En effet il y a une vingtaine d’années, avant la chute du Mur de Berlin,
les économistes débattaient de la confrontation entre capitalisme et
socialisme avec la vision simplificatrice de deux systèmes en compé-
tition, homogènes l’un et l’autre. Et puis, tout cela s’est évanoui avec la
disparition du bloc soviétique, et il a été progressivement admis que
l’économie de marché s’était totalement et définitivement imposée,
créant ainsi les conditions d’émergence d’un capitalisme mondial. Les
maîtres mots étaient tous rattachés à l’idée même du marché :
dérégulation, déréglementation, financiarisation, mondialisation. Dans
la réalité, les concepts de marché et de capitalisme avaient totalement
été assimilés, à tort faisant oublier les profondes divergences entre types
de capitalismes : le capitalisme anglo-saxon, le capitalisme familial ou
le capitalisme para-étatique. Cependant, à l’intérieur même de chacune
de ces formes, il y a désormais ce qui ressort du système traditionnel
- économie de marché ou modèle anglo-saxon - et ce qui tient du capital-
investissement c’est-à-dire du non-coté.
En effet, le capital-investissement est peut-être l’élément le plus
perturbateur d’une vision simplificatrice de l’économie mondiale.
Il est donc normal que le capital-investissement suscite beaucoup
d’intérêt de la part des économistes et des décideurs, et occupe une
place prépondérante dans le débat politique. Cette attention est d’autant
plus forte que ce phénomène a connu un développement important
depuis les années quatre-vingt et a attiré des investissements toujours
croissants vers cette classe d’actifs, ou plutôt ces classes d’actifs. Il est
en effet d’usage d’en différencier au moins deux catégories : d’une part
les fonds de capital-risque ou venture capital, qui investissent dans
de jeunes entreprises technologiques et se caractérisent par leur
impact favorable sur l’innovation. L’investisseur apparaît dans ce cas
comme un intermédiaire financier actif qui endosse de nombreux
rôles, notamment celui de directeur, de conseiller ou même de
manager de l’entreprise dans laquelle il investit ; d’autre part, les fonds
de buy-out ou LBO (leveraged buy-out) sont déterminés, eux, par
l’utilisation d’un fort effet de levier pour racheter des entreprises
générant des cash flows (liquidités) importants. Les LBO s’appuient
alors sur les cash-flows que l’entreprise générera pour rembourser les
intérêts de la dette. Et ce sont ces deux types d’actifs, constitutifs
du capital-investissement, qui vont se trouver au cœur de tous les
LORENZI 15/10/08, 14:5021

REVUE D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE
22
débats et interrogations financières, et donc économiques d’aujourd’hui.
Pourquoi tout particulièrement aujourd’hui ?
Parce qu’ils sont au cœur d’une formidable contradiction. D’une
part, ils se présentent comme une véritable alternative aux modèles
traditionnels et comme la seule véritable incitation à développer
l’innovation et, d’autre part, ils sont, aujourd’hui et demain, confrontés
aux difficultés financières mondiales qui se traduisent déjà par une
difficulté à les financer. Selon le succès ou non du capital-investissement
des toutes prochaines années, on saura s’il s’agissait d’un feu de paille
ou d’une véritable réorganisation de l’économie mondiale. Plus
précisément, le capital-investissement est questionné sur sa nature réelle.
Peut-on créer de la valeur sans discontinuer ? Y a-t-il de nouveaux types
de relations entre les actionnaires et le management de l’entreprise
considérée ? Les succès du capital-investissement sont-ils essentiel-
lement liés à la nature des montages financiers, principalement de la
dette, que les fonds arrivent à lever ?
Voilà toute une série de questions qui méritent réponses sachant
que cette nouvelle forme d’investissements non cotés a simultanément
acquis une vraie importance quantitative et suscité des interrogations
légitimes sur son impact macroéconomique. Tout cela mérite donc de
la rigueur dans les définitions, de la précision dans les chiffres et une
définition stricte de ce qui est connu et de ce qui ne l’est pas. Et il
est parfaitement exact que le sujet n’est pas simple, ce qui a de lourdes
conséquences sur la clarté des débats. Les derniers mois, notamment,
ont vu toutes les interrogations prendre un tour vraiment polémique.
Steven Kaplan (1997) avait bien indiqué à quel point le capital-
investissement avait mauvaise réputation ou plus précisément, à quel
point un large public avait une attitude de grande suspicion, particu-
lièrement vis-à-vis, des grands fonds de LBO. Qu’il s’agisse de
l’information - jugée trop insuffisante -, de l’impact salarié - considéré
trop rapidement et injustement comme négatif -, des risques systé-
miques liés à l’abus du levier d’endettement ou des problèmes de
répartition des plus-values et donc d’éventuels conflits d’intérêts, tout
est jugé dans le meilleur des cas, comme sujet à doutes. Ceci s’est déjà
traduit par la sortie de nombreux rapports tout au long de l’année 2007
(Orszag, 2007, Treasury Commitee, 2007 et Gottschalg, 2007). Le plus
significatif et controversé fut celui de Sir David Walker, ancien
président de Morgan Stanley International. Il publia en juillet 2007 un
document1 préconisant plus de transparence des fonds de capital-
investissement. Dans un contexte où les fonds de LBO sont au cœur
d’une polémique sur leur fiscalité, le rapport se voulait une forme de
réponse. En effet, rappelait-il, le manque de données dont on dispose sur
ce secteur est à l’origine des soupçons et des spéculations sur la nature
LORENZI 15/10/08, 14:5022

LE RÔLE ÉCONOMIQUE DU PRIVATE EQUITY
23
exacte de son activité. Le rapport Walker demandait donc la création
d’un organe au sein duquel toutes les firmes de capital-investissement
seraient tenues de déposer des informations sur la performance des
entreprises prises en charge, ainsi que sur les caractéristiques des fonds
levés. Ne pouvant contraindre les firmes de capital-investissement à
se conformer à ces recommandations, le rapport leur proposait une
période de consultation à l’issue de laquelle elles devaient donner leur
réponse. Dans le même esprit et à peu près en même temps, en France,
la Commission bancaire2 s’est précisément interrogée sur l’exposition
des banques au risque lié au financement des LBO. Et l’Autorité des
marchés financiers (AMF) a produit en juin 2007 une étude (Pansard,
2007) dressant une cartographie des risques en matière de stabilité
financière et de production de l’épargne dans laquelle elle porte une
attention toute particulière aux opérations de LBO et aux transferts
de cette dette au travers des collateralized debt obligations (CDO). C’est
dire si le monde des institutions financières veut désormais intervenir
dans la régulation de cette industrie. Mais, la réflexion sur le plan
théorique n’est pas en reste de celle des opérationnels.
Rappelons-le, une véritable école de l’analyse du capital-investis-
sement s’est créée, sous l’autorité de M. Jensen. À partir de son article
fondateur intitulé « The Eclipse of the Public Corporation » publié en
1989 (Jensen, 1989), de nombreux économistes réputés ont étudié tous
les thèmes propres à cette organisation capitalistique : la gouvernance,
la rentabilité, la liquidité... S’il ne fallait en citer que quelques-uns, on
se doit d’évoquer Steven Kaplan, Josh Lerner, Tim Jenkinson. Tous
consi-dèrent qu’ils sont confrontés au sujet majeur de ce début de siècle.
Mais, ce qui est plus récent, c’est leurs intérêts pour des sujets très liés
à une nouvelle phase du capital-investissement : le caractère cyclique
du capital-investissement qui jouera, s’il est mis en évidence, un rôle
déterminant dans la conjoncture, troublée, à venir. Surtout, un autre
thème de réflexion souligne encore plus les bouleversements que
connaît son développement : la naissance de ce qu’on appelle le « private
equity 2.0 ». L’expression ci-dessus n’est pas sans rappeler l’évolution des
sites Internet autour des années 2000. Auparavant, les sites web étaient
statiques, reposant sur des bases de données figées. L’évolution vers le
« web 2.0 » s’est observée avec une plus grande possibilité d’interaction
des internautes avec le contenu des pages. Le web s’est adapté aux
utilisateurs. C’est Jenkinson (2007) qui est l’auteur de cette analogie,
entre l’évolution du web et celle du capital-investissement. Selon lui,
l’industrie du capital-investissement est en train de s’adapter à l’envi-
ronnement économique auquel elle est confrontée. En effet, devant les
plus grandes difficultés des fonds à effectuer les delistings, les opérations
évoluent maintenant vers de nouvelles voies :
LORENZI 15/10/08, 14:5023
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%