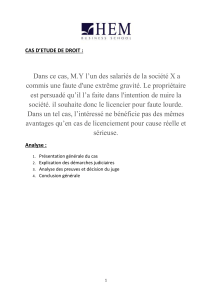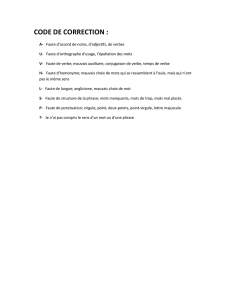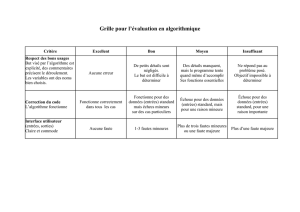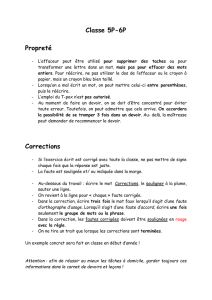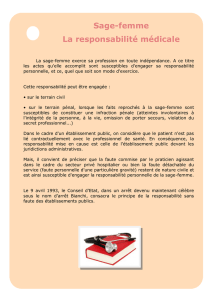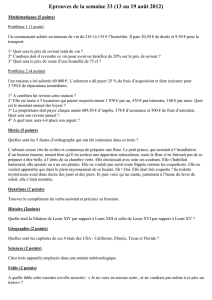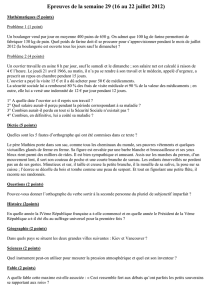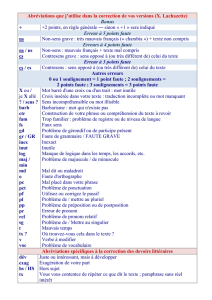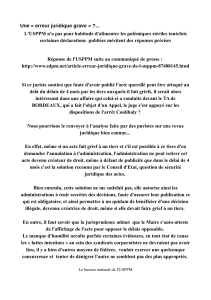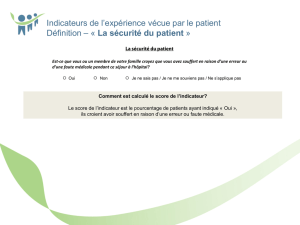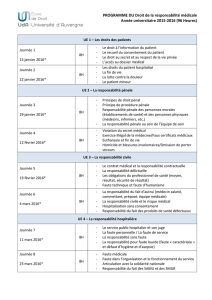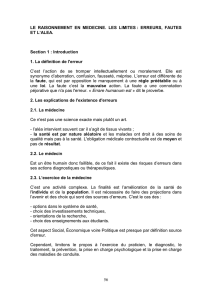Lire l`article complet

VIE PROFESSIONNELLE
RAPPEL SUR LES FONDEMENTS
DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
L’existence d’une juridiction administrative tire son origine de la
notion de séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire. C’est l’ar-
rêt BLANCO qui, en 1873, considère que la responsabilité de
l’État ne peut être régie par les principes établis par le Code civil,
et transfère à la juridiction administrative la construction de cette
organisation et la charge de cette mission.
La mise en jeu de la responsabilité du médecin exerçant dans le
secteur public relève exclusivement de la juridiction administra-
tive (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil
d’État), sauf dans le cas où cette activité médicale exercée à l’hô-
pital correspond à une activité privée, le litige éventuel relevant
alors d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
Le principe de base est que l’administration est responsable de
son agent, en cas de faute de service. Ce n’est donc pas le méde-
cin qui sera poursuivi, mais l’administration hospitalière. Cette
situation constitue en outre un rempart entre l’usager et l’agent
du service public.
La prescription est quadriennale en matière administrative,
comme pour toutes les dettes de l’État.
En outre, tout comme en droit médical en matière civile, au moins
pour la plupart des situations, la charge de la preuve appartient à
la victime.
Pour être indemnisé :
✓le préjudice doit être “certain”, les séquelles devant être per-
manentes et pouvant être constatées en expertise ;
✓le préjudice doit être “direct”, conséquence nécessaire et
immédiate des faits reprochés ;
✓le préjudice doit être “spécial”, en affectant individuellement
la personne qui l’invoque, ce préjudice pouvant être de tous
ordres, “anormal”, ne répondant pas à ce qu’on peut logique-
ment attendre des conséquences normales de l’exercice médical,
et également “appréciable en argent”, ce dernier élément étant
une exigence pour que le juge administratif puisse statuer.
SPÉCIFICITÉS DU DROIT MÉDICAL
ADMINISTRATIF
Le concept de la décision préalable
Le patient ou sa famille dépose un recours contre l’administra-
tion hospitalière et auprès d’elle en cas de contentieux sur une
activité médicale intervenue à l’hôpital. Le demandeur, par ce
recours, sollicite le versement d’une indemnité en réparation du
préjudice allégué.
La Lettre du Cardiologue - n° 372 - février 2004
41
●
M. Bernard*
Modifications récentes
de la responsabilité médicale
en matière administrative
L
a responsabilité médicale hospitalière relève de la juridiction administrative, sauf exception.
Elle est dominée par un certain degré de protection de cet agent du service public qu’est le méde-
cin hospitalier, par la notion de décision préalable, et par la notion de faute détachable du ser-
vice. Un exercice hospitalier peut voir également engager la responsabilité pénale de l’auteur
d’une faute. Des modifications importantes sont intervenues récemment, comme la disparition de
la notion de “faute lourde”, la notion de responsabilité sans faute, la notion de présomption de
faute concernant notamment les questions d’infections nosocomiales, et l’aléa thérapeutique.
* Expert près la cour d’appel de Paris, spécialisé en matière de Sécurité
sociale, 43, bd Malesherbes, 75008 Paris.
E-mail : michel.bernard30@libertysurf.fr

La Lettre du Cardiologue - n° 372 - février 2004
42
Ce n’est qu’en cas de désaccord entre le demandeur et l’admi-
nistration de l’hôpital que le juge administratif sera saisi, désac-
cord matérialisé par un refus de l’administration hospitalière d’ac-
céder à cette demande d’indemnisation. L’administré demande
au magistrat non seulement une compensation financière du pré-
judice allégué, mais également l’annulation de la décision ini-
tiale administrative hospitalière qu’il a souhaité contrer. Le juge
administratif pourra alors remplacer les décisions contestées par
ses propres décisions. Cette demande de “statuer sur un refus
préalable” constitue donc une particularité, spécifique à ce type
de procédure, et distingue fondamentalement une action admi-
nistrative d’une action civile, dans laquelle le magistrat est saisi
directement des “prétentions” du demandeur. Après indemnisa-
tion, l’administration hospitalière peut éventuellement se retour-
ner contre son agent défaillant. Ce risque justifie l’impérative
nécessité d’une assurance professionnelle en responsabilité,
contractée par le praticien.
Les rigueurs de l’obligation de moyens dans l’exercice
médical hospitalier
Le Conseil d’État est, comme la Cour de cassation, particulière-
ment attaché au maintien du critère d’obligation de moyens et
non de résultats. Mais cette situation impose des règles strictes
de fonctionnement, concernant :
✓la nécessité de sécurité pour le patient lors de son hospitalisa-
tion et notamment sa surveillance : hospitalisation en étage d’un
malade suicidaire sans sécurité spécifique, chute d’un lit, d’une
table d’examen ou d’une table de bloc opératoire, défaut de sur-
veillance particulière du fait d’un terrain particulier ou d’un âge
extrême de la vie, défaut de surveillance d’un plâtre ou d’une
zone de ponction artérielle ;
✓le risque de retard à l’organisation des soins, médicaux ou para-
médicaux, une mauvaise transmission d’information médicale,
un retard à la transmission de résultats ;
✓une mauvaise coordination entre les praticiens, du fait d’une
incompétence technique ou d’une mauvaise ambiance dans le ser-
vice, faisant le lit d’erreurs ou de fautes médicales, et témoignant
d’une mauvaise organisation du service ;
✓un défaut de “qualité” de l’“auteur” d’un acte, lequel n’en per-
dra pas pour autant sa qualification d’acte médical et ne se trans-
formera pas en simple acte de soins, cette situation témoignant là
aussi d’une mauvaise organisation du service, la délégation de com-
pétence se devant d’être encadrée de façon suffisamment sécurisée.
Les deux exceptions à la règle du droit administratif
en matière de responsabilité médicale
1. Exercice privé d’un médecin à l’hôpital
Un médecin hospitalier est soumis aux règles du droit adminis-
tratif s’il exerce dans le cadre d’une activité salariée, car il est
acteur du service public. Mais s’il a – même au sein de l’hôpi-
tal – une activité libérale, c’est le droit civil qui s’exerce au même
titre que dans le cadre d’une activité libérale en cabinet ou en cli-
nique. La détermination de ce statut est donc fondamentale pour
savoir à quel titre le médecin incriminé a agi, et donc de quelle
juridiction il relève, civile ou administrative.
L’arrêt du 9 avril 1986 du Conseil d’État précise que si le dom-
mage est en rapport avec l’activité libérale du médecin qui l’a
soigné, l’hôpital n’est pas responsable, et c’est le droit civil qui
s’applique, au nom de l’inexécution contractuelle, mais que
par contre, si le dommage est lié à un “mauvais fonctionne-
ment du service public résultant d’une mauvaise installation
des locaux, d’un matériel défectueux, ou d’une faute commise
par un membre du personnel auxiliaire de l’hôpital mis à la dis-
position des médecins, chirurgiens et spécialistes”, la respon-
sabilité de l’hôpital peut être engagée, à la condition qu’il
s’agisse de soins courants.
2. Faute détachable du service
Malgré une position relativement sécurisée d’“agent du service
public”, le médecin hospitalier peut engager sa responsabilité per-
sonnelle, au titre d’une faute n’ayant pas trait à une erreur de
“technique médicale” mais à un comportement fautif. Étrangère
à la fonction de soins, cette faute revêt un caractère strictement
personnel, et donc “détachable de la fonction”. Elle est rare, voire
exceptionnelle. Elle a un caractère d’une particulière – ou d’une
extrême – gravité. On peut citer :
✓une expérimentation sans consentement, ou avec consentement
mais sans utilité scientifique ;
✓une intervention chirurgicale lourde non urgente sans consen-
tement, voire carrément avec refus explicite du malade ;
✓une attitude impardonnable consistant à abandonner un patient
dans un bloc opératoire où vient de se déclarer un incendie ou
une explosion ;
✓une erreur technique majeure ;
✓une erreur d’aiguillage entre les diverses salles d’un bloc opé-
ratoire ;
✓un refus de se déplacer en garde ;
✓un refus d’examen en délégant la totalité des soins à un interne
sans en assurer le contrôle ;
✓une attitude intolérable à l’égard d’un patient ou d’une famille.
La faute détachable est donc exceptionnelle, et en dehors de sa
qualification juridique, elle fait partie de ces “histoires invrai-
semblables” qui hantent les salles de garde. Par ailleurs, elle se
rapproche souvent bien dangereusement, notamment dans l’énu-
mération qui précède, d’une qualification pénale, avec les risques
majeurs que celle-ci fait courir.
ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE
ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE
DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Disparition de l’exigence de faute lourde pour engager
la responsabilité de l’hôpital
Jusqu’en 1992, le Conseil d’État exigeait la production d’une
faute lourde pour retenir la responsabilité médicale hospitalière
permettant l’indemnisation de la victime. Cette situation datait
de deux arrêts du Conseil d’État du 8 novembre 1935 établissant
que, pour que la responsabilité hospitalière soit engagée, il devait
être établi qu’une faute avait été commise,
VIE PROFESSIONNELLE

La Lettre du Cardiologue - n° 372 - février 2004
43
●faute simple s’il s’agissait d’un acte paramédical ;
●mais nécessité d’une faute lourde pour un acte médical rele-
vant de la responsabilité d’un médecin.
Par un arrêt du 10 avril 1992, dit arrêt VERGOZ, la jurispru-
dence ainsi créée abandonne cette nécessité de “faute lourde” au
profit de la notion de “faute”, a priori dans le but d’améliorer les
chances pour les plaignants d’obtenir une indemnisation, en éta-
blissant que les faits incriminés “constituent une faute médicale
de nature à engager la responsabilité de l’hôpital”, et permet-
tant ainsi d’élargir le champ d’application de la mise en jeu de la
responsabilité hospitalière. Toutefois, toute erreur ne constitue
pas une “faute médicale”, ce qui tend finalement à l’absence de
majoration de la pression sur le corps médical.
Cet arrêt bouleverse en apparence le paysage de la responsabilité
médicale au plan administratif, mais rétablit de fait une vérité
puisque, dans la pratique, la “lourdeur” de la faute était au fil des
années dépossédée de son importance. Il a toutefois l’avantage
de ne plus infliger au médecin le qualificatif de “lourde” dans la
définition de la faute pour laquelle il était poursuivi, et de ne plus
permettre au public de s’indigner qu’un médecin ne puisse être
poursuivi dès lors que la faute n’était que “simple”.
La teneur de cet arrêt VERGOZ a encore été confirmée par un
nouvel arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1997.
La responsabilité sans faute et l’aléa thérapeutique
Initiée en 1990 par l’arrêt GOMEZ, de la cour administrative
d’appel (CAA) de Lyon, la notion de responsabilité sans faute
sera reprise trois ans plus tard par l’arrêt BIANCHI. Dans ce pre-
mier arrêt, la CAA expose que “l’utilisation d’une thérapeutique
nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entiè-
rement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont
l’objet lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s’impose
pas pour des raisons vitales, et les complications exceptionnelles
et anormalement graves qui en sont la conséquence directe enga-
gent, même en l’absence de faute, la responsabilité du service
public hospitalier”. L’arrêt BIANCHI, le 9 avril 1993, se pro-
nonce sur les conséquences dramatiques (tétraplégie) d’une
“simple” artériographie cérébrale, complication apparue en l’ab-
sence de toute faute dans l’indication, la réalisation ou la sur-
veillance de l’exploration. “Considérant que, lorsque l’acte médi-
cal nécessaire au diagnostic ou au traitement présente un risque,
dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est excep-
tionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient
y soit exposé, la responsabilité du service public est engagée.”
Ce nouvel arrêt constitue donc un pas de plus vers la notion de
responsabilité sans faute, si controversée par ailleurs. Il est dans
le même esprit que l’arrêt du 21 mai 1996 sur la présomption de
responsabilité en matière d’infection nosocomiale.
Il faut rappeler toutefois également les critères imposés par l’ar-
rêt GOMEZ, nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité
de l’hôpital en l’absence de faute :
✓que les suites possibles n’aient pas été entièrement connues ;
✓que le recours à cette méthode n’ait pas été imposé par des rai-
sons vitales ;
✓que les conséquences dommageables directes de cette méthode
aient eu un caractère exceptionnel et anormalement grave.
Dans la pratique, il est bien rare que ces trois éléments soient
réunis, ce qui permet de ne pas craindre que le juge administra-
tif soit entré dans la logique de réparation systématique de
l’aléa au profit du patient et/ou aux dépens du médecin.
Car il faut rappeler que la juridiction administrative, tout comme la
juridiction judiciaire, exclut du contrat passé entre médecin et patient
la notion d’aléa thérapeutique (Cour de Cassation, 8 novembre 2000).
En l’absence de ces éléments, la responsabilité de l’hôpital ne
pourra être recherchée que sur la base d’une faute.
Les infections nosocomiales hospitalières
C’est l’un des terrains de choix de la notion de présomption de
faute : survenue chez un patient d’un événement dommageable
sans aucun lien avec la raison pour laquelle il était venu à l’hô-
pital. La présomption de faute pèse alors sur l’hôpital, ce qui est
bien sûr sévère, puisqu’il est en pratique quasi impossible de maî-
triser toutes les sources possibles de contamination. Dans ce
même cas, le juge judiciaire a fait le même choix, par son arrêt
de la Cour de cassation du 21 mai 1996 : “(...) Une clinique est
présumée responsable d’une infection contractée par un patient
lors d’une intervention pratiquée dans une salle d’opération, à
moins de prouver l’absence de faute de sa part”. Ce chapitre
concerne en fait tant les infections bactériennes que les infections
virales et, de fait, la question du dossier du sang contaminé par
le VIH. La cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du
12 février 1998, renforcé la nécessité du lien de causalité.
Le devoir d’information
L’obligation d’information vient, outre une simple question de
bon sens et d’honnêteté vis-à-vis du patient, du Code de déonto-
logie, qui rappelle que le médecin doit à son patient une infor-
mation loyale, adaptée et aussi complète que possible.
L’information s’exerce à trois niveaux : état de santé du patient,
nature exacte des traitements, risques inhérents aux explorations
complémentaires ou aux traitements.
Le médecin doit informer son patient de tout risque grave, quelle
que soit sa fréquence, comme l’ont clairement précisé deux
arrêts du Conseil d’État du 5 janvier 2000 : “Lorsque l’acte médi-
cal envisagé, même accompli dans les règles de l’art, comporte
des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être
informé dans des conditions qui permettent de recueillir son
consentement éclairé, (que) si cette information n’est pas requise
en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être
informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent
qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obli-
gation (d’information)”. Cette obligation d’information se calque
en fait depuis ces arrêts du 5 janvier 2000 en matière de respon-
sabilité hospitalière sur les exigences de la responsabilité en
matière de droit civil, comme l’avait établi la Cour de cassation
dans son arrêt du 7 octobre 1998.
C’est à l’hôpital d’établir que le médecin a procédé à cette infor-
mation, cette position du Conseil d’État (9 juin 1998) se calquant
là aussi sur la position de la Cour de cassation (25 février 1997).
La définition de la gravité du risque se pose pour définir la limite au-
delà de laquelle ce risque “grave”, même s’il n’est qu’“exception-
VIE PROFESSIONNELLE

La Lettre du Cardiologue - n° 372 - février 2004
44
nel”, doit être mentionné. Nous mettrons à part les impératifs très
spécifiques de la chirurgie esthétique, qui ne seront pas détaillés ici.
Rappelons également pour mémoire la question du consentement,
indispensable à obtenir dans notre activité professionnelle, notam-
ment hospitalière, consentement qui sera éventuellement écrit,
en particulier dans le cadre d’expérimentations.
CONCLUSION
Cette responsabilité hospitalière est plus protectrice pour le méde-
cin que la responsabilité civile. Mais pour autant, à travers toutes
ses particularités, elle tient compte de l’évolution récente de la
société à travers la jurisprudence de ces dernières années, notam-
ment concernant l’abandon de la faute lourde, l’aléa thérapeu-
tique ou le devoir d’information. On a vu combien la notion de
faute détachable, qui peut donner lieu à de sévères discussions,
reste malgré tout cantonnée dans des domaines très spécifiques,
et a priori sur des chemins “peu fréquentés”. ■
Bibliographie
❏Bernard M, Bernard G. Histoire de la responsabilité médicale. Rev Fr Domm
Corp 1997 ; 2 : 133-45.
❏Clement S, Piva Cl. Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et
disciplinaire. Rev Prat 1997 ; 47 : 1967-70.
❏Jonas C, Penneau M. Les rapports entre la faute pénale et la faute détachable
du médecin de service public. J Med Leg 1999 ; 42 : 7/8-591/5.
❏Malicier D. La responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disci-
plinaire. Rev Prat 2001 ; 51 : 1001-6.
❏Pierre Ph, Le Gallou A, Mocquet-Anger ML. Chronique de Jurisprudence.
Médecine et Droit 1995 ; 15 : 13-21.
❏Thouvenin D. Responsabilité médicale. Flammarion Sciences, 1996.
❏Veron M. La responsabilité médicale au sein d’une équipe médicale : homicide
et blessures involontaires. Gazette du Palais 1996 : 329-331/2-6.
❏Esper C. La cour administrative d’appel a développé une jurisprudence parti-
culièrement riche en droit médical. Gazette du Palais 1999 ; 16 : 14-7.
❏Denoix de St Marc R. La responsabilité médicale devant le juge administratif.
Bull Acad Natl Med 2000 ; 184, 9 : 1977-90.
❏Paley Vincent C. Responsabilité du médecin. Masson (Droit médical pratique)
2002.
❏Penneau M, Delahaye JF. L’évolution de la jurisprudence administrative en
matière de responsabilité médicale. Rev Fr Domm Corp 1995 ; 1 : 31-7.
❏Guettier Ch. Obligation d’information de patients par le médecin. Responsa-
bilité civile et assurance. Édition du Jurisclasseur, juill.-août 2002 : 4-9.
❏Sicot M. Faute détachable de la fonction. Concours Médical 18-04-98 ; 120 :
151110-2
❏Vilanova J. La responsabilité du médecin hospitalier. Rev Prat 1998 ; 436 :
2-11.
VIE PROFESSIONNELLE
CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LES TROIS ASPECTS1DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
On peut donc constater que les instances judiciaires ou administratives à l’égard de médecins ne sont pas exception-
nelles, que l’exercice soit libéral ou hospitalier, cette distinction déterminant la juridiction compétente. Les fondements
de la justice applicable au corps médical ne doivent plus nous être inconnus, et il nous faut, au même titre que nous
améliorons notre compétence dans notre domaine d’activité médicale, parfaire nos connaissances en nous informant
des modifications les plus importantes intervenant dans le paysage médico-juridique. Cela peut nous aider à prendre
la bonne décision, notamment en termes de précaution ou de prévention. Il est par ailleurs inconcevable d’exercer sans
être assuré, et il est indispensable de vérifier auprès de son assurance que le contrat est adapté aux spécificités du type
d’exercice que l’on a choisi. Enfin, il nous faut parler avec nos patients, parler et parler encore, les informer, recueillir
la preuve de cette information, mais aussi et surtout établir un contact du meilleur niveau possible (ce n’est pas tou-
jours facile...) afin de ne pas partir à la base sur une relation imparfaite, qui ne pourra que s’envenimer en cas de pro-
blème pouvant impliquer notre responsabilité professionnelle.
1. Les deux autres aspects (aspect civil, aspect pénal) sont parus dans La Lettre du Cardiologue n° 370, décembre 2003 et n° 371, janvier 2004.
Annonces professionnelles
Contactez Franck Glatigny
Tél. : 01 41 45 80 57 - Fax : 01 41 45 80 45
E-mail : [email protected]
1
/
4
100%