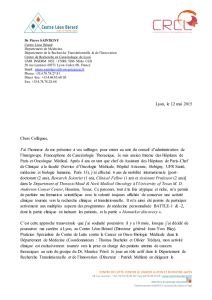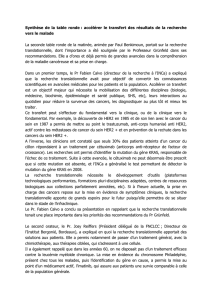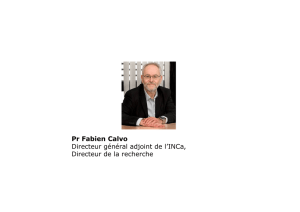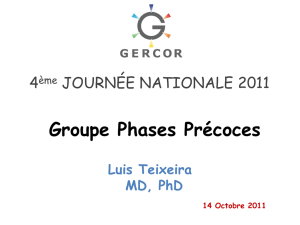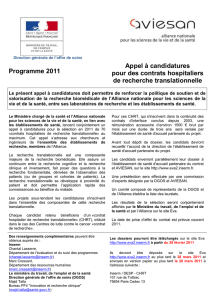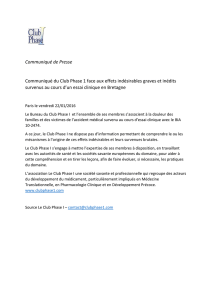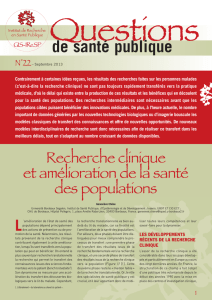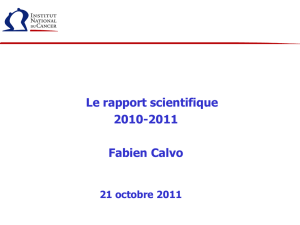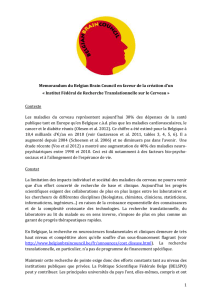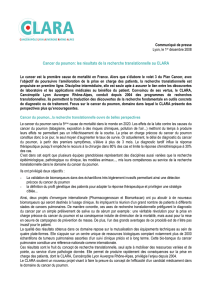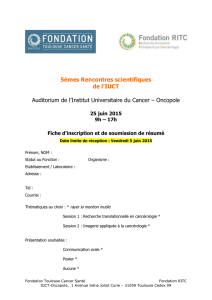GROUPE DE TRAVAIL : INCa / Leem Recherche

2007 1
GROUPE DE TRAVAIL : INCa / Leem Recherche
RECHERCHE TRANSLATIONNELLE ET PLAN CANCER
TRANSLATIONAL RESEARCH AND CANCER PLAN
G. VASSAL1, L. BORELLA2, A. PIERRE3, R. PAMPHILE2, B. BOURRIE4, K. MEFLAH5,
F. AMALRIC2, I. PAUPORTE2, J-L. CAILLOT5, P. FORMSTECHER6, B. DEMERS4,
C. DUMONTET7, M. GREGOIRE8, F. LETHIEC9, A. M BOUE10, D. TONELLI11, R. PILSUDSKI12,
LUC VAN HIJFTE9, C. CAILLIOT13, P. VRIGNAUD4, J-L. MERLIN14, P. OUDET14,
P-Y. ARNOUX15, C. LASSALE15.
1 Cancéropôle Ile-de-France – Hôpital Saint-Louis – 1 avenue Claude Vellefaux – 75475 Paris Cedex 10 -
2 Institut National du Cancer – 52 avenue André Morizet – 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - lborella@institutcancer.fr
3 Servier – 125 chemin de ronde - 78290 Croissy sur Seine
4 Sanofi-Aventis - sanofi-aventis recherche & développement - 371 rue du professeur Joseph Blayac - 34184 Montpellier
Cedex 04
5 Cancéropôle Grand Ouest – CHU – Maison de la recherche en santé – 5 allée de l'Ile-Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1
6 Cancéropôle Nord Ouest – BP 90005 – 59008 Lille Cedex
7 Cancéropôle CLARA – 60 avenue Rockfeller – 69008 Lyon
8 Inserm - 101 rue de Tolbiac - 75654 Paris cedex 13
9 Janssen Cilag - Campus de Maigremont - B.P. 615 - 27106 Val de Reuil Cedex
10 Janssen Cilag - 1, rue Camille Desmoulins - TSA 91003 - 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
11 Novartis - 2-4, rue Lionel Terray - BP 308 - 92506 Rueil Malmaison Cedex
12 Bristol Myers Squibb - 3, rue Joseph Monier - 92500 Rueil Malmaison
13 Astra Zeneca - 1, Place Renault - 92844 Rueil-Malmaison Cedex
14 Amgen - 62, boulevard Victor Hugo - 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
15 Cancéropôle Grand Est – Hôpital de Hautepierre – 1 avenue Molière – 67098 Strasbourg Cedex
16 Leem Recherche – 25 rue de Montévidéo – 75116 Paris

2007 2
RESUME
En France, le Plan Cancer 2003-2007 a mis la Recherche translationnelle au cœur de son programme
de recherche, pour assurer le continuum soins-recherche et l’application la plus rapide possible des
découvertes les plus récentes au bénéfice des patients. Il s’agit d’un domaine de recherche nouveau,
encore mal connu ou mal compris. Un groupe de travail, composé de médecins et chercheurs issus de
la recherche académique et de la recherche industrielle, s’est attaché à définir la Recherche
translationnelle en cancérologie et à en préciser les enjeux. La Recherche translationnelle doit se
développer à proximité du patient afin de permettre un flux bidirectionnel des connaissances de la
recherche cognitive vers ses applications médicales et des observations faites chez le malade vers la
recherche cognitive. Placé sous l’égide de l’Institut National du Cancer et du LEEM Recherche, le
groupe propose une stratégie de mise en oeuvre de la Recherche translationnelle en cancérologie en
France pour la rendre attractive, compétitive et efficace et pour favoriser le développement des
partenariats public-privé.
MOTS CLES
recherché translationnelle, cancer, médecine expérimentale, continuum soins-recherche, recherche
cognitive, recherche clinique.
ABSTRACT
The French Cancer Plan 2003-2007 has made Translational Research central to its research
programme, to ensure the care-research continuum and the quickest application possible for the most
recent discoveries, for the patients’ benefit. This is a new field of research, still little-known or ill-
understood. A working group, composed of physicians and researchers from academic research and
industrial research, sought to define Translational Research in Cancerology and define the issues at
stake in it. Translational Research needs to develop in close connection with the patients in order to
enable a bi-directional flow of knowledge from cognitive research toward medical applications and from
observations made on patients toward cognitive research. Placed under the aegis of the French
National Cancer Institute and LEEM Research, the Group has put forth a strategy for implementing
Translational Research in Cancerology in France to make it attractive, competitive and efficient and to
foster the development of public-private partnerships.
KEYWORDS :
Translational Research, cancer, experimental medicine, care-research continuum, cognitive research,
clinical research.

2007 3
Ce document a été produit dans le cadre d‘un groupe de travail associant des membres de la
recherche industrielle, représentés par le Leem Recherche et de la recherche académique,
représentés par l’Institut National du Cancer et les cancéropôles. Son objectif est de définir – autant
qu’il est possible – le concept de recherche translationnelle, en particulier dans le domaine du
cancer, ainsi que les conditions de son efficacité au service de l’innovation médicale pour les
personnes malades.
CONTEXTE
La recherche translationnelle, également appelée médecine expérimentale, est au cœur du
programme recherche du Plan Cancer, lancé en 2003, qui doit assurer le continuum soins-recherche.
Créée il y a plus de 20 ans aux U.S.A. [I-II], elle ne se développe officiellement en France que depuis
quelques années, même si des médecins et des chercheurs en font sans le savoir, sans la nommer,
depuis déjà bien longtemps.
Dans cette logique, le ministère chargé de la Santé et le ministère chargé de la Recherche ont
souhaité promouvoir l’émergence des cancéropôles établis à l’échelle d’une région ou d’un groupe de
régions et donner un élan à l’effort de recherche dans le domaine de la lutte contre le cancer.
Les cancéropôles ont vocation à développer la coordination opérationnelle de projets mobilisant des
équipes de recherche académiques et/ou industrielles, des services de soins orientés vers l’innovation
et des plates-formes technologiques mutualisées. Ils ont aussi pour objectif de renforcer la place de la
France dans la compétition internationale et de réaffirmer sa position dans la recherche en
cancérologie fondamentale et clinique. Ces organisations ont donc un rôle stratégique à jouer dans
l’émergence d’une recherche translationnelle innovante et de haut niveau scientifique.
La recherche translationnelle concerne tant le domaine du médicament et du biomédicament que les
thérapeutiques cellulaires et géniques, ainsi que les applications diagnostiques. Elle est impliquée à
tous les niveaux de la chaîne de découverte des médicaments, depuis l’identification et la validation de
cibles pertinentes jusqu’à la sélection de patients dont la tumeur est, a priori, sensible à une option
thérapeutique par l’expression de biomarqueurs. Dans ce sens, une recherche translationnelle de
qualité est vitale pour l’industrie pharmaceutique [III] dont la mission est de découvrir et développer des
médicaments anti-cancéreux plus actifs et plus sélectifs, et donc à meilleur index thérapeutique que la
chimiothérapie existante [IV].

2007 4
LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE
La recherche translationnelle doit assurer un continuum entre la recherche biologique cognitive1 et la
recherche clinique2, en prenant en compte le patient dans sa réalité complexe et unique et également
collectivement comme membre d’un groupe de malades. Elle doit ainsi permettre la mise en œuvre
optimale des connaissances les plus récentes dans la pratique médicale [V-VI].
Elle doit se développer à proximité du patient afin de permettre un flux bidirectionnel des
connaissances de la recherche cognitive vers son application au patient et des observations faites
chez le malade vers la recherche cognitive (figure 1).
De la recherche cognitive à la recherche clinique (du laboratoire au patient)
Les chercheurs en recherche fondamentale fournissent aux cliniciens et aux chercheurs de l’industrie
pharmaceutique de nouvelles cibles thérapeutiques : l’identification d’un oncogène activé dans une
tumeur expérimentale a pu ainsi devenir un outil diagnostique, pronostique et permettre le
développement de nouveaux traitements, les outils et les médicaments étant utilisés d’abord dans des
cohortes limitées (transfert) avant d’être étendus à de grandes séries de patients (recherche clinique).
L’industrie pharmaceutique peut donc, en s’appuyant sur les avancées de la recherche cognitive et en
collaboration avec les équipes académiques et cliniques, proposer et développer des traitements plus
adaptés à la physiopathologie de certains cancers, voire des sous-types d’un cancer donné.
Les cliniciens vont ainsi tester, sur une population de malades sélectionnée selon des critères établis à
l'avance, soit un médicament dont le but est, par exemple, de contrecarrer l’hyperexpression du produit
d'un gène identifié, soit un effet combiné d'une thérapie conventionnelle et d’un traitement
complémentaire (thérapie cellulaire, vectorisation du traitement, etc.) sur une pathologie déterminée.
Les résultats obtenus et leur analyse statistique permettront de définir les pourcentages de bons et
mauvais répondeurs et l'efficacité thérapeutique potentielle.
1 La Recherche Cognitive (du latin cognoscere – connaître), aussi dénommée Recherche Fondamentale, que le Petit Robert
définit ainsi : « recherche orientée vers les domaines fondamentaux d’une discipline (opposée à recherche appliquée) ». En
biologie, ou plus largement dans les sciences du vivant, il s’agit bien là de connaître et comprendre les systèmes biologiques qui
régissent la vie, sans se préoccuper immédiatement des applications éventuelles à court, moyen ou long termes. C’est pourquoi
la Recherche Fondamentale explore des modèles comme les végétaux, la bactérie, le virus, le ver, la drosophile, qui sont bien
plus simples que les mammifères, et en particulier l’être humain. En cancérologie, cette recherche cognitive s’attache à
comprendre pourquoi et comment une ou plusieurs cellules deviennent cancéreuses, pourquoi et comment le système
immunitaire protège ou ne protège plus contre ses phénomènes de cancérisation. Les chercheurs utilisent très souvent des
modèles de cancers humains ou de rongeurs, in vitro et in vivo.
La recherche fondamentale est conduite dans des laboratoires de recherche du CNRS, de l’Inserm et de l’Université, le plus
souvent au sein de campus de recherche, mais aussi dans certaines entreprises privées. La proximité de l’hôpital, du malade,
n’est pas une condition nécessaire à son développement.
2 La recherche clinique s’intéresse à l’être humain, qu’il soit en bonne santé ou malade, dans tous les domaines qui
concernent sa santé. Ainsi, en cancérologie, elle se préoccupe du diagnostic de cancer, du dépistage (précoce), du diagnostic
de risque de cancer, des traitements, quels qu’ils soient (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, immunothérapie,..), mais aussi
du patient comme personne malade, dans son environnement, participant éventuellement à des protocoles de recherche
biomédicale. La recherche clinique utilise les outils statistiques et épidémiologiques, qui sont autant de domaines de recherche à
part entière. Elle se développe dans l’hôpital, au lit du malade ou en consultation, mais aussi en réseau avec les partenaires de
la prise en charge du patient. Elle fait appel, directement ou indirectement, à tous les métiers d’un établissement hospitalier.
En cancérologie, plus que dans d’autres disciplines médicales, la recherche clinique et les soins sont (et doivent être) très liés,
puisque l’objectif est de toujours progresser dans un domaine où beaucoup de traitements sont encore insuffisamment efficaces.
Il a même été montré que les patients qui participent à un essai de recherche clinique ont une meilleure chance de survie. Un
des objectifs du Plan Cancer est d’ailleurs d’augmenter le nombre de patients à qui l’on propose de participer à un protocole de
recherche.
La Recherche Clinique essaye donc de comprendre et traiter la maladie chez l’homme, la femme, l’enfant, autant d’êtres
humains éminemment complexes. Elle a aussi un devoir d’application, d’action, dans une certaine forme d’urgence car il s’agit
de milliers de vies en danger.

2007 5
De la recherche clinique à la recherche cognitive (du patient au laboratoire)
L’observation médicale, en particulier dans le cadre des études cliniques, peut conduire à identifier une
question née de l’évolution particulière d’une population de patients pour laquelle l’état des
connaissances biologiques n’apporte pas de réponse [VII].
Les cliniciens et les biostatisticiens reviendront vers les chercheurs en recherche fondamentale pour
leur soumettre de nouvelles problématiques : pourquoi certains patients ne répondent-ils pas au
traitement ? Comment augmenter le pourcentage de bons répondeurs ? Comment augmenter
l'efficacité du produit testé ?
Le dialogue entre clinicien et chercheur, initié par la question, doit amener une recherche cognitive qui
pourra ultérieurement bénéficier en retour au patient ; par exemple :
- l’identification de sous populations de patients sans caractéristiques identifiées dont le pronostic
spontané s’avère sévère ou bénin ;
- l’identification de patients dont la résistance/sensibilité ou la tolérance/toxicité à un traitement s’avère
imprévisible ;
- la définition de caractéristiques biologiques permettant de guider la décision thérapeutique (arbre
décisionnel).
Cela implique d’affiner le modèle initialement conçu par les chercheurs qui tenteront de proposer de
nouveaux moyens et ainsi de suite (figure 1).
Figure 1 - La recherche translationnelle : du malade au malade
Recherche
Translationnelle
Recherche
Cognitive Recherche
Clinique
Patients
Nouveaux moyens diagnostiques
Nouveaux traitements
Continuum soins-recherche : du patient au patient
Faire bénéficier le plus vite possible les patients
des découvertes les plus récentes
Pour assurer ce continuum entre recherche et soins, du malade au malade, la recherche
translationnelle doit :
• transférer et interpréter le plus vite possible les connaissances et les technologies
nouvelles vers des applications diagnostiques et thérapeutiques, au bénéfice des
patients ;
• créer les conditions d’une réelle approche multidisciplinaire impliquant une
concertation entre chercheurs académiques et industriels, médecins et patients ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%