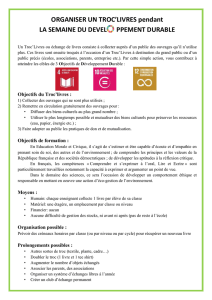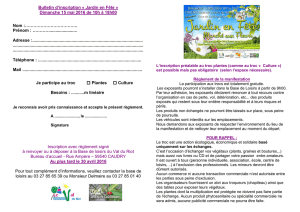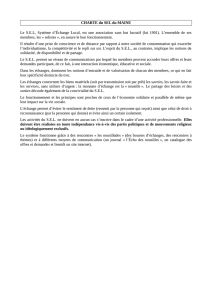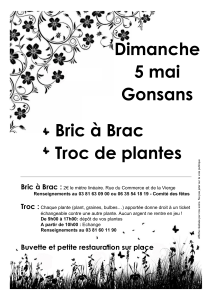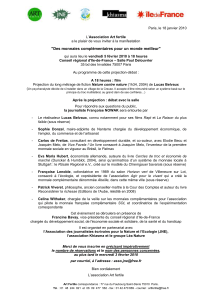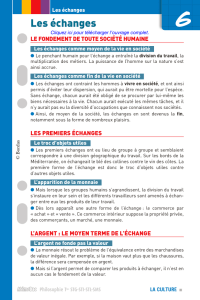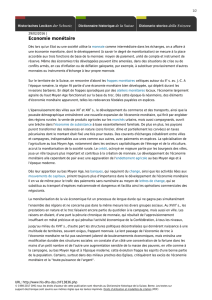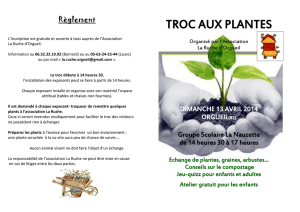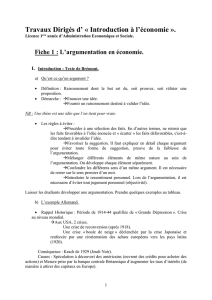Le troc en Russie : perte de légitimité de la monnaie ou perte de

1
LE TROC EN RUSSIE : PERTE DE LEGITIMITE DE LA MONNAIE OU PERTE DE LEGITIMITE
DES INSTITUTIONS MONETAIRES ?
Pepita OULD-AHMED*
Le troc est souvent présenté, dans la pensée économique, comme le signe d’une
démonétarisation de l’économie. L’essor d’un tel phénomène dans nos économies
contemporaines résulte de tensions monétaires extrêmes qui ont pour conséquence de remettre
en cause la monnaie nationale dans ses fonctions cardinales de réserve de valeur et
d’intermédiaire des échanges. Cette interprétation standard du troc trouve son écho dans de
nombreuses expériences monétaires, comme – pour ne citer que les plus spectaculaires –,
celle de l’Allemagne en 1919 puis en 1947-48, ou encore celle de l’URSS en 1917-19. Par
rapport à de tels scénarios de troc, l’expérience monétaire de la Russie post-soviétique
présente un intérêt singulier.
Cet article propose de montrer en particulier que la signification et les fondements du
troc en Russie ne peuvent pas être appréhendés au prisme d’une telle interprétation
traditionnelle de ce phénomène. On verra en effet comment, d’une part, loin de conduire à une
régression ante-monétaire de l’économie, l’essor du troc permet, paradoxalement, de rappeler
le caractère monétaire de l’économie russe. L’expérience des formes complexes des échanges
réglés en nature en Russie révèle comment le troc, ou plus exactement la marchandise cédée
en contrepartie d’un achat, peut, moyennant une organisation stricte et structurée des
échanges, rendre certains services de règlement, et de fait être qualifiée de monnaie privée.
D’autre part, on montrera que le troc n’est pas non plus le résultat d’une remise en cause de la
légitimité de la monnaie nationale. En effet, l’évolution monétaire donne à voir que le troc se
développe à partir de 1993 et persiste encore en 2001 à un haut niveau alors même que
l’économie russe connaît une relative stabilisation monétaire – recul de l’inflation dès la fin
1993, appréciation du rouble dès 1995, et résorption significative des problèmes de liquidités,
à partir de 1996. Et, malgré la fragmentation du système de paiements, on verra que le rouble
reste la monnaie de référence et conditionne l’existence même de ces substituts.
Si le troc ne renvoie pas à une crise de légitimité du rouble, on montrera en revanche
qu’il est la manifestation d’une profonde crise monétaire dont les origines sont à chercher
ailleurs que dans la monnaie nationale elle-même. De par son origine et sa persistance, on
*URA 922-CNRS. CEPREMAP.142, rue du Chevaleret, 75013 Paris. [email protected]

2
montrera que le troc russe rend compte de l’existence d’une crise de légitimité des institutions
monétaires et bancaires officielles. On verra d’abord que l’essor du troc est une réponse des
acteurs à un régime monétaire socialement trop coûteux soutenu par les autorités monétaires
et bancaires. L’inadéquation des politiques monétaires et les comportements bancaires vont en
effet contribuer à alimenter fortement une pénurie de roubles qui se solde à la fois par une
double crise – crise des paiements et crise de financement généralisées -, et par l’émergence
de modalités de paiements alternatives, en particulier le troc. Et, les relâchements récurrents et
ponctuels de la contrainte de liquidité ne suffiront pas à faire reculer les pratiques monétaires
parallèles. La persistance du troc, par-delà la résorption partielle des problèmes de liquidités
amorcée à partir de 1996, révèle, comme on le verra, une crise de confiance des acteurs
économiques vis-à-vis des institutions monétaires et bancaires dans leur capacité à soutenir
durablement une politique de croissance économique. En l’absence d’un véritable système
bancaire tourné vers le financement de l’activité productive et dans un tel climat d’incertitude
monétaire, les réseaux de troc fonctionnent comme des institutions de paiements alternatives
qui, de par leur emprise structurante sur les activités productives, bénéficient de la confiance
des acteurs économiques. On verra ainsi que, c’est à partir d’un renforcement et d’une
réactivation de la confiance qui lie les acteurs des réseaux de troc, confiance fondée sur des
traditions d’échange et des repères communes – confiance que l’on qualifiera de
« méthodique », en reprenant la typologie des catégories de confiance proposée par Aglietta et
Orléan (2002) –, que les réseaux de troc permettent de répondre partiellement à la crise de
paiements et de financement généralisées russe depuis le début de la transition.
I. LE TROC N’EST PAS LE SIGNE D’UNE REGRESSION ANTE-MONETAIRE DE L’ECONOMIE
RUSSE
Comprendre la signification et les fondements du troc russe présuppose que l’on se
désimprègne de sa définition conventionnelle. Il renvoie en effet à un phénomène plus large et
revêt, comme on va le voir, un caractère partiellement monétaire. Le troc prend une telle
ampleur, représentant plus de 50% des règlements des transactions industrielles en 1998 et
encore près de 30% en 2001, que l’on aurait pu penser qu’il porterait atteinte à la légitimité de
la monnaie nationale à supposer qu’il n’en fut pas déjà sa manifestation. Or, on montrera que,
malgré la fragmentation de l’espace monétaire, la confiance dans la monnaie nationale est
préservée et que le rouble reste la seule monnaie de référence.

3
I.1. Le troc ou la marchandise comme support des communautés de paiement privées
Soutenir la thèse d’une réaffirmation du caractère monétaire de l’économie russe à
travers le développement du troc peut surprendre. Mais pour s’en convaincre, il importe au
préalable de montrer la singularité que revêt ce phénomène dans cette économie. Par rapport à
sa définition standard – échange simultané de biens sans l’utilisation de monnaie comme
intermédiaire des échanges – le troc en Russie renvoie à un phénomène beaucoup plus
complexe. Il fait référence au troc au sens strict – l’échange de biens contre biens sans
intermédiaire monétaire – mais renvoie plus largement à trois formes complexes d’échanges
réglés en nature. La première correspond au troc au sens strict (barter), qui consiste en un
échange simultané de deux biens pour leur valeur d’usage et répondant à la double
coïncidence des besoins. La deuxième forme de troc désigne ce que l’on appelle les accords
de compensation (offsets). Elle consiste à livrer des biens qui permettent en contrepartie
d'annuler des créances ou des obligations de paiement futur. Enfin, l’utilisation de wechsels
(zachety) – billets à ordre – représente, même si cela paraît plus étonnant, la troisième forme
de troc. En effet, alors que dans les économies capitalistes, un agent qui émet un billet à ordre
à un autre agent s’engage à payer sa dette en cash à l’échéance, en Russie il sera bien souvent
réglé en nature.
D’un point de vue théorique, on peut dire que le troc en Russie désigne un ensemble
d’échanges où la marchandise1, cédée en contrepartie d’un achat, peut rendre des services de
règlement des dettes et revêtir, de fait, un caractère partiellement monétaire. Il ne s’agit pas
bien sûr de soutenir qu’elle constitue une monnaie à part entière. De nombreux attributs de la
monnaie sont voués à lui manquer. Cependant, si l’on s’appuie sur la distinction opérée par
Hicks (1989) entre la monnaie publique, laquelle remplit l’ensemble des fonctions d’unité de
compte, de réserve de valeur et de moyen de paiement, et la monnaie privée, qui elle ne
remplit que certaines de ces fonctions monétaires, la marchandise, cédée en contrepartie d’un
achat, peut être qualifiée de monnaie privée. A la différence du rouble, elle présente une
double caractéristique : il s’agit d’une monnaie partielle puisqu’elle ne fait qu’endosser la
fonction de paiement ; sa légitimité est circonscrite car elle n’est acceptée, enfin, qu’au sein
de micro-systèmes de paiements locaux et privés.
Néanmoins, pour que la marchandise puisse servir d’instrument des paiements, il faut
évidemment davantage que ce qu’exige la monnaie nationale. Alors que l’utilisation du rouble
pour payer une dette permet son extinction immédiate, les formes complexes du troc en

4
Russie révèlent que le paiement à travers la marchandise, cédée en contrepartie d’un achat, ne
devient effectif que dans deux cas de figure. Le premier renvoie au cas où la marchandise
cédée par l’agent A, en contrepartie d’un achat, fait valeur d’usage pour l’agent B qui la
reçoit. Hors de cette configuration, il est erroné de considérer que le paiement est reconnu au
moment où l’entreprise A règle l’entreprise B, par exemple, à l’aide de sa propre production.
La livraison de marchandises à l’entreprise B correspond à un transfert de biens sans avoir
encore produit pour cette dernière, de son point de vue de créancière, un pouvoir d’achat.
Pour que la marchandise utilisée par la firme A comme moyen de paiement se transforme en
paiement effectif pour la firme B, il faut que cette dernière, si elle n’utilise pas cette
marchandise pour sa propre production, réussisse à vendre celle-ci contre du cash à une autre
entreprise ou parvienne à l’utiliser à son tour comme moyen de règlement d’un créancier.
Ceci signifie que le dénouement de la transaction bilatérale ne se réalise pas au moment de la
cession par l’entreprise A d’une marchandise-moyen de paiement à l’entreprise B, mais
seulement lorsque B aura réussi elle-même à acheter quelque chose à l’aide de cette
marchandise cédée à une entreprise C. C'est seulement à ce moment que la firme B aura
transformé la marchandise reçue en pouvoir d’achat et que la dette de l'entreprise A pourra
être considérée comme éteinte. Il manque encore quelques étapes pour que le dénouement de
la transaction bilatérale A-B se transforme en véritable validation sociale de la production de
A. Car lorsque B éteint une de ses dettes en se défaisant auprès de C de la marchandise-
contrepartie reçue en paiement de A, elle ne fait que reporter la contrainte monétaire2 sur une
autre entreprise. La validation sociale n’est donc acquise que lorsque prend fin la séquence
des reports et que la marchandise-paiement arrive dans les mains d’un agent aux yeux de qui
elle a une valeur d’usage.
Aussi, se met en place une relation de dette médiatisée par la marchandise et non par la
monnaie qui pourrait être qualifiée de relation de dette « fractionnée ». En effet, lors du
paiement en monnaie, extinction de la dette et recouvrement de la créance sont simultanés. A
l’inverse, lorsque la marchandise est utilisée comme moyen de paiement, elle permet certes
d’éteindre la dette du côté du débiteur ; mais du côté du créditeur, le recouvrement de la
créance – en dehors du cas de la double coïncidence des besoins – ne sera effectif que lorsque
1 On envisage non pas une marchandise qui serait élue équivalent général, mais la marchandise dans sa
généricité, c’est-à-dire actualisée dans toutes les marchandises particulières.
2 On entend par contrainte monétaire ce que définit Aglietta de la manière suivante : « la contrainte monétaire
signifie que chaque participant aux échanges doit vendre sa marchandise, c'est-à-dire prouver en obtenant de la
monnaie qu'il disposait avec cette marchandise particulière d'une fraction du travail global de la société. Ayant
satisfait à cette obligation, il dispose d'un pouvoir d'achat social sur l'ensemble des marchandises grâce auquel il
peut acheter toute valeur d'usage de son choix dans la limite des relations d'équivalence, c'est-à-dire toute valeur
d'usage qui représente une fraction identique de travail social » (Aglietta, 1997, p. 356). Autrement dit, la
contrainte monétaire est l’expression du « saut périlleux de la marchandise » de Marx.

5
le créancier aura lui-même converti cette marchandise en moyen de règlement de ses propres
dettes. Aussi, pendant la période où l’entreprise B cherche à transformer le produit reçu en
cash ou à le transmettre en paiement à un tiers, – période qui oscille selon les enquêtes3 entre
un et sept mois –, la relation de dette reste ouverte. Autrement dit, tant que le produit obtenu
par l’entreprise B ne donne pas lieu à un usage effectif (pouvoir libératoire ou productif),
celle-ci consent un crédit. Aussi, lors de l’utilisation de la marchandise comme moyen de
paiement, la relation de crédit précède bien souvent la relation monétaire. Les enquêtes de
Commander et Mummsen (2001) montrent une évolution dans le comportement des directeurs
d’entreprises qui recourent au troc entre 1995 et 1997. Même si les marchandises reçues par
les firmes sont essentiellement désirées pour leur valeur d’usage et utilisées dans le processus
de production, le troc fait de plus en plus l’objet d’une vente différée, accroissement qui
témoigne de la montée de cette nouvelle forme de crédit interentreprises.
A la différence d’une relation de crédit bancaire traditionnelle, la relation de dette qui
lie les entreprises diffère sur deux aspects essentiels. En effet, la relation de dette véhiculée
par l’utilisation de la marchandise comme moyen de paiement n’est pas bilatérale mais
tripolaire : son dénouement implique non seulement le débiteur (l’entreprise A) qui utilise la
marchandise pour régler sa dette et le créditeur (l’entreprise B) qui la reçoit, mais aussi un
tiers agent (l’entreprise C) qui acceptera in fine la marchandise de la part de B pour paiement
ou pour sa valeur d’usage et par-là clora la relation de paiement A-B. La deuxième
particularité de cette relation d’endettement renvoie à la transformation de la relation
débiteur/créditeur autour de la contrainte monétaire : alors que dans une relation de crédit
bancaire, la relation de dette s’éteint lorsque le débiteur s’affranchit de sa contrainte
monétaire – qui se double dans le cas d’un financement de sa production par le crédit
bancaire, d’une contrainte de remboursement – ; dans le cas d’une relation d’endettement,
médiatisée par la marchandise, la preuve de la validation sociale de la marchandise revient
au créancier.
Aussi, compte tenu des conditions particulières qui rendent possible l’utilisation de la
marchandise comme moyen de règlement par une communauté privée d’acteurs, il n’est pas
surprenant que les formes du troc exigent une organisation stricte et ordonnée de ces échanges
en nature. Dans le cas russe, le réseau est cette forme d’organisation des échanges réglés en
nature qui permet de créer les conditions et d’améliorer la probabilité selon laquelle les
marchandises, cédées en contrepartie d’un achat, réalisent un paiement effectif entre les
membres du réseau. Le réseau de troc fonctionne ainsi comme une institution de paiement
3 Voir en particulier les résultats de Marin, Kaufmann et Gorochoskij (2000).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%