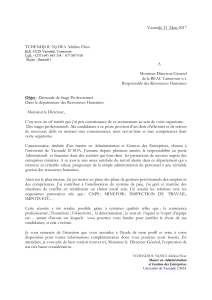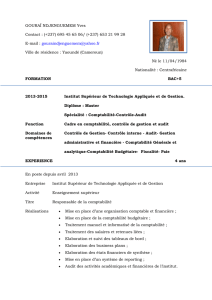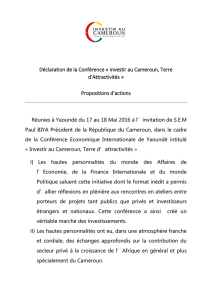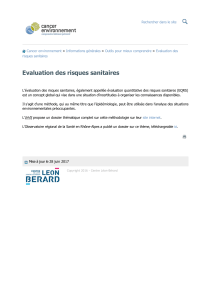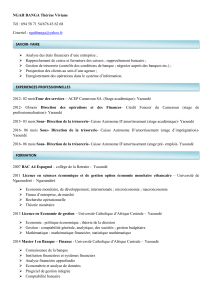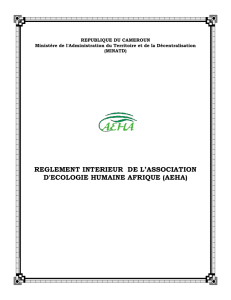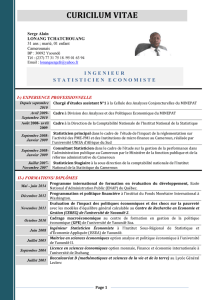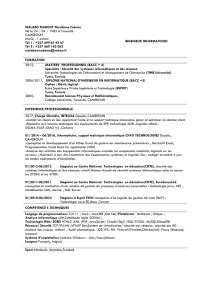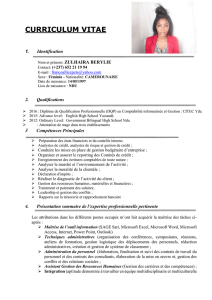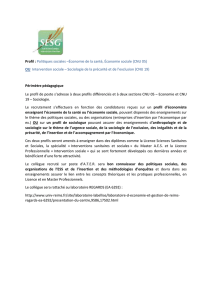Rôle du garde-malade dans le système de santé camerounais

1"
"
Le garde malade au cœur de l’organisation du système de santé au
Cameroun : entre participation à la prise en charge des malades et risques
de débordements
ou
Les profanes « professionnels » de santé : Le garde malade au cœur de
l’organisation du système de santé au Cameroun
Edmond VII MBALLA ELANGA1
Introduction
Depuis la fin des années 80, réduit à sa portion congrue par les politiques d’ajustement
structurel (PAS) et la doctrine de la bonne gouvernance, l’État camerounais, a finalement
engendré ce que Pierre-Joseph Laurent appelle une « modernité insécurisée »2. Dans cette
situation, ce sont les possibilités licites d’entrevoir le chemin de la survie à long terme qui
s’amenuisent pour la majorité de la population, augmentant de ce fait le sentiment
d’insécurité. Les villes camerounaises, et la ville de Yaoundé en l’occurrence, sont
devenues les machines à « fabriquer » les pauvres et les exclus. Ainsi, par exemple, la part de
l’offre de la santé s’amincit devant l’augmentation des services privés payants. On observe
également une croissance de la corruption et des comportements déviants, au sein des
institutions sanitaires. En d’autres termes, le temps de la modernité insécurisée conjugue
l’affaiblissement de la prise en charge coutumière de la vie commune et les difficultés de
l’État camerounais à organiser sereinement les conditions de traitement sanitaire de pans
entiers de sa population. C’est dans ce contexte que se développe dans les structures sanitaires
camerounaises en général et celles de Yaoundé en particulier le phénomène de garde-malade,
symptomatique de l’état de dysfonctionnement dans lequel se trouvent aujourd’hui certaines
structures sanitaires.
Ce papier tente donc de comprendre la place et le rôle que les garde-malades jouent
dans l’organisation du travail et l’admission des soins dans les institutions sanitaires de
Yaoundé. Il est question d’analyser les enjeux de la présence d’un grand nombre de cette
catégorie d’acteurs dans les institutions sanitaires de la ville de Yaoundé. Qu’est ce qui
explique cette présence ? Comment ces profanes collaborent-ils avec les professionnels quand
on sait que l’hôpital est, en principe, l’une des institutions les plus délicates à gérer ? Telles
sont les questions qui nourrissent notre réflexion.
1. Cadrage sémantique du concept de garde-malade et approche méthodologique
Si dans certains pays comme la France, le garde-malade est une personne formée3 ; au
Cameroun, il est le plus souvent un inexpert. Il n’a aucune connaissance profonde de
l’organisation du système de santé encore moins de l’admission des soins aux patients. Il
s’agit, le plus souvent, d’un membre de la famille (le frère, la sœur, le cousin, la tante,
l’épouse, etc.) ou ami du patient. Il a le profil d’un sans emploi. Dit autrement, le garde-
malade est une personne qui exerce un emploi précaire ou qui est même sans emploi : une
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Doctorant en sociologie, Université de Yaoundé 1.
2 Pierre-Joseph Laurent, Les pentecôtistes du Burkina Faso, Paris, IRD-Khartala, 2003, 442 p.
3 http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/pdf_fiches_CCIP/garde_malade.pdf

2"
"
personne qui a donc du temps. En effet, on observe une sorte de répartition des tâches au sein
des familles, lorsque l’un des membres tombe malade. Les personnes qui ont des moyens
financiers (dont qui ont un emploi) délèguent celles qui n’en ont pas, afin de garder le
malade4. Si les premiers passent de temps en temps rendre visite au malade, les seconds
restent en permanence au chevet du malade et rendent compte à ceux qui sont hors de
l’hôpital de l’évolution de l’état de santé du malade.
Notre analyse s’appuie sur une collecte de données menée, d’une part, dans quatre
hôpitaux ou centres de santé de la ville de Yaoundé5 et de données documentaires, d’autre
part. En effet, si les données de terrain ont été collectées dans des hôpitaux de la ville de
Yaoundé, d’autres ont été collectées à partir des ouvrages et d’autres sources documentaires.
Cette réflexion est en quelque sorte une association de deux approches : la sociologie de la
santé et la sociologie urbaine. Il est question pour nous de replacer la « vie » des institutions
sanitaires et les observations faites dans un contexte beaucoup plus global : celui d’un
système de santé qui se développe dans un environnement où le phénomène d’urbanisation
joue un rôle central. En effet, il est difficile de comprendre certains phénomènes comme celui
des garde-malades si l’on fait abstraction du fait que ce sont des phénomènes qui émergent et
se développent dans un tissu social qui subit des mutations et des dynamismes liées à
l’urbanisation (exode rurale, ru-urbanisation, etc.).
2. Le garde-malade comme un acteur clé du fonctionnement de l’Hôpital à Yaoundé
« Par nature et par définition, l’homme est un être vivant, un être en proie à un
certain nombre de processus biologiques et physiques parmi lesquels la naissance, la
croissance, la maturité, la dégénérescence, le vieillissement, la fatigue, la maladie, la mort »6.
Pour entretenir la vie, c’est-à-dire repousser le plus loin possible l’avènement de la mort,
l’homme a élaboré dans toutes les sociétés des stratégies que l’on appelle des remèdes ou
médicaments. L’état de malade étant toujours un état d’impossibilité pour le malade de
continuer à être autonome, les sociétés ont mis au point plusieurs mécanismes qui permettent
à « ceux qui ne sont pas couchés »7 de s’occuper de ceux qui le sont. En effet, « C’est bien le
paradoxe de la maladie qu’elle est à la fois la plus individuelle et la plus sociale des choses.
Chacun d’entre nous l’éprouve dans son corps et parfois en meurt ; de la sentir en lui
menaçante et grandissante, un individu peut se sentir coupé de tous les autres, de tout ce qui
faisait sa vie sociale ; en même temps tout en elle est social, non seulement parce qu’un
certain nombre d’institutions la prennent en charge aux différentes phases de son évolution,
mais parce que les schémas de pensée qui permettent de le reconnaître, de l’identifier et de la
traiter sont éminemment sociaux : penser sa maladie c’est déjà faire référence aux autres »8.
Les mécanismes qui participent à la prise en charge du malade sont de nature
différente, en fonction des types d’organisations des sociétés, de leur niveau de
développement matériel ou encore des systèmes de santé mis en place par ces sociétés. Dans
les pays développés comme ceux de l’Union européenne, par exemple, les citoyens sont pris
en charge par des systèmes de sécurité sociale, qui différent d’un pays à un autre, mais dont
l’objet reste le même : prendre en charge les citoyens malades. En Afrique Sub-saharienne, la
prise en charge des malades constitue encore une difficulté pour les États. On assiste à une
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4 Cette définition du garde-malade obéit davantage à un portrait classique qu’à une réalité permanente. Certains
garde-malades n’obéissent toujours pas à cette définition.
5 Hôpital central, Hôpital de district d’Efoulan, Hôpital Jamot, Hôpital de district de Biyem-Assi.
6 Mbonji Edjenguèlè, Santé, maladies et médecines africaine. Plaidoyer pour l’autre tradipratique, Yaoundé,
Les presses universitaires de Yaoundé, 2009, p.92.
7 Expression populaire camerounaise qui signifie être malade ou être en mauvaise santé.
8 Marc Augé et Herzlich, Le sens du mal, Paris, Aubier, 1984, p. 36.

3"
"
situation où une minorité (quelques milliers fonctionnaires et d’employés des grandes
entreprises du secteur privé) peuvent dignement se prendre en charge en cas de maladie. Le
reste, la majorité, se trouve dans une situation d’insécurité qui handicape lourdement sa prise
en charge. C’est donc dans ce contexte que s’est développé au sein des institutions sanitaires
le phénomène de garde malade.
En effet, la présence des gardes-malades, au sein des institutions sanitaires de la ville
de Yaoundé, en fait des personnes centrales et indispensables au bon fonctionnement de
l’appareil sanitaire et par ricochet à la guérison des malades. Ils sont au cœur de l’organisation
du travail et de l’admission des soins. Ils surveillent l’évolution des perfusions, avertissent les
infirmières lorsque celles-ci sont finies, les réveillent nuitamment en cas d’urgence,
s’occupent de l’hygiène des patients, parcourent les pharmacies, le plus souvent situées hors
des hôpitaux, pour acheter les remèdes après les prescriptions des médecins, etc. Parfois, ils
collaborent avec les professionnels de santé de façon un peu plus concrète. On retrouvera par
exemple un garde-malade participer à l’accouchement d’une femme ou encore un autre tenir
un patient blessé à qui on administre les soins.
Dans certains hôpitaux les garde-malades sont plus nombreux que le personnel de
santé et les patients. Le rôle qu’ils jouent dans l’organisation du système de santé au
Cameroun illustre une situation où la place des profanes est aussi et parfois plus importante
que celle des experts. Sans la présence des garde-malades, certains patients se retrouveraient
abandonnés dans les centres de santé ou les hôpitaux. Ce sont aussi ceux-ci qui jouent le rôle
de psychologues et qui soutiennent psychologiquement le malade. Non pas que les
professionnels ne le font pas, mais cette tâche incombe d’abord (officieusement) aux garde-
malades. Les patients se sentent en sécurité et rassurés lorsqu’ils sont entourés des leurs. « Je
ne me sens pas l’aise quand tu n’es pas là. Ces femmes aux blouses blanches ne me rassurent
pas », dit une patiente de l’Hôpital de Jamot à sa sœur. Au sein des institutions sanitaires,
comme dans la plupart des institutions camerounaises, tend à se développer des formes de
solidarité mécanique en l’absence de celles organiques.
L’exode rural et les migrations massives des populations des villages vers la ville de
Yaoundé ont transformé cette ville en milieu de vie hétérogène où l’ordre traditionnel
cohabite avec l’ordre urbain. Il se développe ce que les auteurs de l’École de Chicago
appellent le « village dans la ville » 9. Celui-ci unit ses habitants par de multiples liens où
s’entrecroisent les voisinages, la parenté, l’amitié, les solidarités professionnelles et enfin des
formes de solidarité tribales ou ethniques. Être citadin yaoundéen, dans ce cas de figure,
signifie davantage habiter la ville de Yaoundé et non avoir la mentalité ou les habitus urbains,
mieux encore la mentalité de la ville de type occidentale10. Faute d’un système de sécurité
sociale à même de prendre en charge un pan important de la population camerounaise, les
« acteurs faibles »11, mieux encore les « acteurs affaiblis » (les malades, les garde-malades et
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 Yves Grafmeyer, Sociologie urbaine, Paris, Nathan, 1994.
10 Il est davantage question d’un type de citadin particulier : le citadin africain. Celui-ci est une mixture de la
modernité et de la ruralité. Il puise indifféremment dans l’un ou l’autre registre, en fonction des situations
concrètes auxquelles il est soumit. On assiste ainsi à une sorte de reconstruction d’un ordre traditionnel en milieu
urbain. Cette reconstruction met en exergue les manières de faire, d’agir ou de penser, propres aux zones rurales,
qui se reconstruisent en milieu urbain par les citadins de fraîche et même de longue date, non socialisés à la
culture urbaine occidentale.
11 Jean-Paul Payet et Denis Laforgue, Qu’est-ce qu’un acteur faible ? Contributions à une sociologie morale et
pragmatique de la reconnaissance Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008. L’emprunt du terme «
faible » à M. de Certeau (1980) est, comme tout emprunt marqué par la duplicité. L’acteur faible s’inscrit bien
dans la tradition d’une pensée de la réhabilitation des capacités et des ressources d’action d’individus dominés,
disqualifiés, stigmatisés. Chez cet auteur, le faible n’a pas de lieu à soi ; le territoire appartient tout entier au fort.
Le faible ne peut avoir de projet au sens d’une stratégie maîtrisée de son développement ; il n’a que des tactiques
qu’il développe dans des interstices, des failles, des niches. Le faible s’inscrit clairement dans le champ de la

4"
"
leur famille), développent des mécanismes de prise en charge qui puissent dans les référents
culturels, certes en décrépitude pour certaines, mais encore suffisamment efficaces et à même
de jouer un rôle de pis-aller. Si les garde-malades participent à la prise en charge des malades,
leur présence, au sein des institutions sanitaires, constituent aussi des risques et des inconforts
pour ces institutions.
3. Risques et inconforts d’une présence inadéquate
Si la présence des garde-malades apparaît comme essentiel au fonctionnement des
institutions sanitaires, il n’en demeure pas moins que cette situation peut conduire à des
déviances, au mieux, à des conséquences tragiques, au pire. En effet, il arrive parfois que
certains garde-malades administrent aux patients des posologies en contradiction avec celles
du personnel de santé. Un malade peut par exemple estimer que la posologie d’un médecin
n’est pas efficace : « ce sont des petits comprimés, on lui demande d’en prendre 2 par jours,
je vais lui en donner 3 ou 4 », déclare une garde-malade de l’hôpital de district d’Efoulan. Les
déclarations de cette garde-malade sont l’illustration parfaite de la définition même du
profane. Elle est une ignorante, elle ne sait pas ce que c’est que le médicament : sa
composition, ses effets, son efficacité, etc. Elle fait un rapport entre la grosseur du comprimé
et son efficacité, ce qui est loin d’être vrai.
Dans d’autres cas, ce sont par exemple les perfusions qu’ils font couler plus
rapidement, lorsque les patients se plaignent de la lenteur de leur écoulement. Au pire, ce sont
des personnes étrangères à la famille qui pénètrent les enceintes des hôpitaux pour accomplir
des crimes. Dans un hôpital de la région de l’Ouest du Cameroun, un malade est mort dans un
hôpital suite à la consommation de comprimés qui ne lui avait pas été prescrits par son
médecin mais qui se trouvaient pourtant dans une boite qui, elle contenait des comprimés qui
lui avait été prescrits. L’enquête a par la suite révélée qu’une personne étrangère au service
était entrée dans la chambre du malade et avait substitué les bons comprimés des faux.
Des efforts sont certes faits pour limiter l’intrusion des personnes étrangères au sein
des chambres des malades. On peut lire afficher sur les mûres et les portes des affiches avec
ces messages : « Pas plus d’un garde-malade par malade », « Salle interdite aux personnes
étrangères »12. Mais dans la réalité, on peut retrouver cinq, voire six à sept garde-malades
autour de certains lits de malades. Dans des salles, étroites, de six ou huit lits, le nombre
d’individus qui s y retrouvent donne davantage l’impression d’être dans un camp de réfugiés
d’exilés de guerre, que dans une salle d’hospitalisation d’un hôpital, situé dans une ville,
capitale politique d’un pays en situation de paix. Cette situation n’est pas l’apanage des
hôpitaux de la ville de Yaoundé. « Hôpital de première catégorie, c'est-à-dire, le plus grand
de la sous région Afrique centrale, l’Hôpital Laquintinie de Douala est depuis peu confronté
au problème d’espace. La conséquence de ce flux de malades est que l’on trouve quatre, six
voire dix malades dans une même salle d’hospitalisation. Parfois, avec un pronostic médical
opposé. Chaque malade peut recevoir jusqu’à dix visiteurs simultanément ».13
Les aspects liés à la salubrité ne sont pas à éluder. Le grand nombre de garde-malades
au sein des salles d’hospitalisation en fait des lieux où la salubrité est la chose la moins
présente ; mieux encore, où elle est la chose la mieux partagée. Bien que nous n’ayons pas des
données, nous pouvons affirmer, avec moins de risque de nous tromper, que certains de ces
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
domination en y faisant valoir une posture de résistance, quand bien même de Certeau érige ses ruses au rang d’«
art du faible ».
12 Affiches colées sur les mûres de l’hôpital de district d’Efoulan.
13http://www.ajafe.net/sante/sensibilisation/112-infections-nosocomiales-la-sante-en-danger-dans-les
hopitaux.html

5"
"
garde-malades ressortent de ces institutions sanitaires contaminés à certaines maladies. A
l’hôpital central de Yaoundé, où nous avions été garde-malade en 2007, et où nous avons
collecté nos données a posteriori, on constate que les moustiques (vecteurs du paludisme)
sont nombreux. Les garde-malades passent leur nuit, soient dans les couloirs des salles
d’hospitalisation, soient dans des boucaros construits pour la circonstance. Quelque soit
l’endroit où ils passent ces nuits, ils sont sujets aux piqûres de moustiques et aux
désagréments comme les coups de vent.
Le gouvernement a initié la reforme hospitalière. Problème : la lutte contre les
infections nosocomiales en est le diagnostic manquant. C’est un cadre de la santé formé en
hygiène hospitalière, qui fait la révélation. « Dans les établissements de soins, affirme-t-il,
trois lits sur dix sont occupés par un patient victime d’une infection nosocomiale, il s'agit d'un
véritable fléau qui mine les hôpitaux camerounaises ». Contracté par un malade, 48 ou 72
heures après son admission dans un centre de santé, les infections nosocomiales font des
milliers de victimes chaque année au Cameroun. En l’absence d’une politique nationale de
lutte contre les infections nosocomiales, les hôpitaux camerounais, les personnels soignants
ou administratifs, les patients, les garde-malades et les usagers, sont les réservoirs naturels de
microbes, de bactéries et de micro-organismes.
Conclusion
La présence des garde-malades au sein des institutions sanitaires de la ville de
Yaoundé exprime les défaillances d’un système sanitaire auquel les familles ne font pas
totalement confiance, d’une part, et met aussi en exergue les logiques profondes qui
participent à la guérison des malades dans un contexte africain, d’autre part. Confier un
membre de sa famille aux personnels de santé, c’est prendre un risque. Il n’est donc pas
question de laisser un patient à l’hôpital et de tourner le dos. Cette hypothèse reste même
inenvisageable dans certaines institutions sanitaires. Le garde-malade ne surveille pas
seulement le malade, il surveille davantage le personnel de santé, le « motive » quand il faut.
Dans un contexte où le personnel de santé se plaint de son salaire de catéchiste, il accorde
plus d’attention aux malades dont les gardes sont « coopératifs ». Il incombe donc à ceux-ci
de jouer le jeu afin de permettre la prise en charge efficiente de leur patient. Il doit non
seulement participer aux tâches sanitaires mais également être à l’écoute des « attentes » du
personnel soignant, au risque de voir son malade abandonné ou pris en charge avec la
« modestie » qui s’impose.
Références bibliographiques
Augé Marc et Herzlich, Le sens du mal, Paris, Aubier, 1984.
Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Paris, U.G.E., 1980.
Grafmeyer Yves, Sociologie urbaine, Paris, Nathan, 1994.
Mbonji Edjenguèlè, Santé, maladies et médecines africaine. Plaidoyer pour l’autre tradipratique,
Yaoundé, Les presses universitaires de Yaoundé, 2009.
Pierre-Joseph Laurent, Les pentecôtistes du Burkina Faso, Paris, IRD-Khartala, 2003.
Payet Jean-Paul et Laforgue Denis, Qu’est-ce qu’un acteur faible ? Contributions à une sociologie
morale et pragmatique de la reconnaissance, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008.
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/pdf_fiches_CCIP/garde_malade.pdf, consulté
le 14 avril 2011 à 8h 47.
http://www.ajafe.net/sante/sensibilisation/112-infections-nosocomiales-la-sante-en-danger-dans-les-
hopitaux.html, consulté le 24 avril 2011 à 9h 38.
 6
6
1
/
6
100%