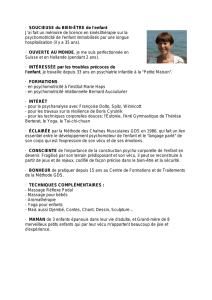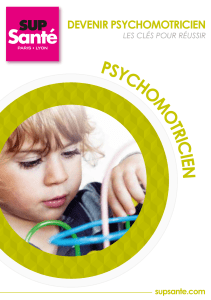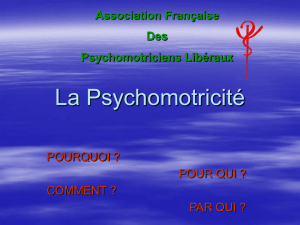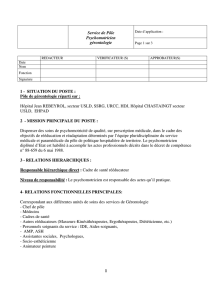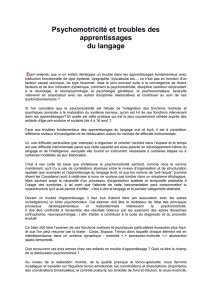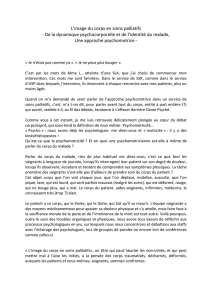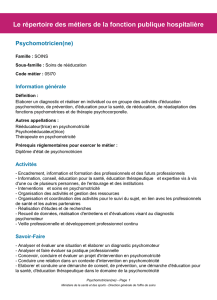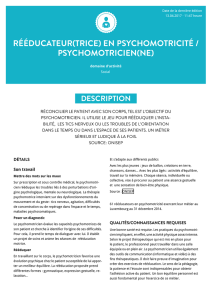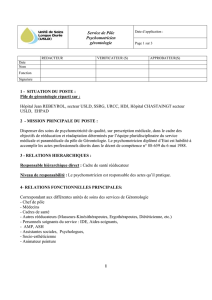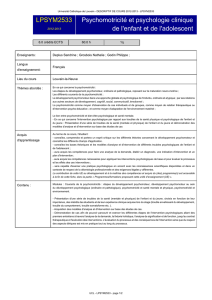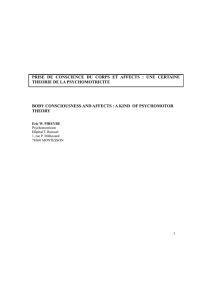parlement communauté française

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Session 2015-2016
juin 2016
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
RELATIVE AU BACHELIER EN PSYCHOMOTRICITÉ
DÉPOSÉE PAR CAROLINE PEROONS, JOËLLE MAISON, EMMANUEL DE BOCK

Développements
1. La psychomotrocité
Le terme psychomotricité a été initialement conçu en Allemagne en 1844 par Wilhelm Griesinger
(1817-1868), fondateur de la neuropsychiatrie. On doit sa reprise en France à Jean Dupré qui, à
l’aube du XXème siècle, souligne le rapport entre les acquisitions motrices et le développement
intellectuel. Julian de Ajuriaguerra (1911-1993) a ensuite contribué à l’institutionnalisation de la
psychomotricité en France. Il est bien connu pour son intérêt pour le développement de l'enfant, les
désordres psychomoteurs, les troubles de l'écriture, et la dyslexie.
Pendant que la psychomotricité est peu à peu investie et développée dans divers champs de
recherche (pédagogie, psychiatrie, psychologie), elle se profile comme une discipline à part entière,
rendant compte de la liaison constante entre corps et psychisme dans un contexte où ces deux
entités ont majoritairement été pensées séparément. Des chercheurs comme Antonio Damasio
développent des connaissances considérables sur le rôle que les émotions et le corps prennent dans
le développement de l’intelligence chez tout être humain. Leur intégration permet notamment à la
psychomotricité de se définir comme une approche spécifique.
L'organisation psychomotrice visée est constituée de quatre paramètres fonctionnant en synergie,
dont l'un peut être perturbé, et sert alors de point d'appel pour le soin :
a) L'activité neuro-motrice dépendant des lois du développement et de la maturation (tonus,
équilibres coordination-dissociation, équipement sensoriel et moteur, genèse de la
latéralité) ;
b) La dimension tonico-émotionnelle, sensori-motrice et affective qui, dès les premiers
échanges de la vie relationnelle, va influencer la qualité de la posture, la gestualité
intentionnelle et permettre la construction du schéma corporel ;
c) La dimension cognitive qui conduit le sujet à intégrer et à maîtriser les rapports qu'il
entretient avec l'espace, le temps et sa corporéité ;
d) La dimension de l'identité qui se construit dans l'interaction du sujet avec son
environnement familial et social.
Les troubles psychomoteurs se manifestent donc par un déséquilibre des fonctions psychomotrices
détaillées ci-avant, lequel retentit sur le comportement, les conduites et les compétences.
Benoit Lesage, dans Jalons pour une pratique psychocorporelle : Structures, étayage, mouvement et
relation, décrit la pathologie psychomotrice comme suit : « les corps se figent, les disponibilités
s’étiolent, le mouvement devient compact, perd de sa richesse à tous points de vue : le rapport au temps,
à l’espace et les qualités du geste s’appauvrissent. Le sujet se restreint globalement, suspend ou limite
ses interactions et ses échanges, ce qui se marque au niveau du corps lui-même »1.
2. Evolution de la discipline en Belgique
En Belgique, les années 1970 voient s’ouvrir les premières formations en psychomotricité, sous la
forme de spécialisation en un an dans le programme des études d’éducateur spécialisé, mais
également en option pour les étudiants en assistant en psychologie. Alors jeune association, l’ABEP
(Association Belge d’Education Psychomotrice) organise également des formations spécifiques en
psychomotricité pour les professionnels des secteurs éducatifs et de la santé. Plusieurs secteurs
s’interrogent déjà sur la place de la psychomotricité : l’école maternelle, les centres de santé
mentale, le secteur de l’aide à la jeunesse, du handicap, etc. Pour donner du corps à ces questions,
1 Benoît LESAGE, Jalons pour une pratique psychocorporelle, Toulouse, Maison d’Editions Érès, 2012, p.
74.

deux congrès internationaux sont organisés en Belgique, l’un en 1976 sous l’égide de l’ULB et
l’autre en 1978 à Liège, qui accueille le troisième congrès international en collaboration avec la
Fédération Française des psychorééducateurs et le soutien des ministres des deux pays.
Un Forum Européen de la Psychomotricité est créé en 1995 avec l’objectif de construire une base
minimale commune aux différents pays européens, tant sur le plan de la formation que de la
profession elle-même. Le Forum européen organise depuis lors un congrès international tous les 4
ans.
Dans les années 80, de nouvelles formations spécifiques plus conséquentes sont mises en œuvre. Un
besoin de reconnaissance se fait sentir, de même qu’une différenciation progressive avec les métiers
existants (kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède). En 1988, le Ministre de la Santé de l’époque,
Philippe Busquin, propose que les psychomotriciens siègent comme observateurs au Conseil
national des professions paramédicales.
Des psychomotriciens décident ensuite de fonder une structure officielle leur permettant d’être un
interlocuteur efficace et reconnu par les instances politiques. C’est ainsi qu’en 1989, les premiers
statuts de l’Union Professionnelle Belge des Psychomotriciens Francophones sont publiés au
Moniteur.
Le Processus de Bologne, initié le 19 juin 1999, qui constitue un processus unique et volontaire de
coopération intergouvernementale en vue de la libre circulation des étudiants et des professionnels,
offre un nouveau ressort aux processus d’harmonisation visant la reconnaissance de la
psychomotricité.
Plusieurs législations francophones adoptées au début des années 2000 reconnaissent la spécificité
de l’intervention psychomotrice ainsi que le psychomotricien en tant que professionnel paramédical.
Ces textes concernent l’A.W.I.P.H., les centres de Santé Mentale, les maisons de repos et de soins.
Dans le cadre de l’enseignement maternel, la psychomotricité est reconnue spécifiquement dans
l’horaire des enfants depuis 2002. Le titre du professionnel concerné est « maître de
psychomotricité à l’école maternelle », il ne s’agit donc pas du titre de psychomotricien. Différents
professionnels, dont les enseignants et les psychomotriciens, peuvent y accéder moyennant pour
chacun des conditions particulières de formation complémentaire.
A partir de 2006, une réflexion concernant la mise en place d’une formation de base pour le
psychomotricien est entamée entre les écoles existantes et l’Union professionnelle. Un premier
dossier dans ce sens a été présenté conjointement auprès de la Ministre de la Santé le 24 mai 2007.
Il aboutira en 2012 par l’ouverture du bachelier.
L’approche de la psychomotricité s’est progressivement différenciée du côté francophone et
néerlandophone du pays. Au sud, la psychomotricité s’appuie sur un concept intégré et non
différencié du psychisme et du moteur. L’accent est mis sur l’évolution du lien entre le psychisme et
le moteur. Au nord, l’attention est plutôt portée vers l’aspect neuromoteur et fonctionnel.
Avec cette variation de focus, on aboutit en toute logique à une distinction des formations
proposées. En 2007, seules les Hautes Ecoles francophones ont introduit une demande d'ouverture
d'un baccalauréat paramédical en psychomotricité destiné à remplacer progressivement l'année de
spécialisation en psychomotricité de type pédagogique, ainsi que l'option « psychopédagogie et
psychomotricité » de la formation d'assistant en psychologie.
Ce bachelier a été construit pour correspondre au programme élaboré dans le cadre du Forum
Européen de la psychomotricité en vue d'une harmonisation progressive des formations au sein de
l'Union Européenne. Il est donc en concordance avec le programme français donnant accès en
France au statut de psychomotricien et répond aux normes européennes de 180 crédits. La Haute
Ecole « Léonard de Vinci » à Bruxelles a, par exemple, ouvert un bachelier en psychomotricité tout
en maintenant son offre de formation en kinésithérapie. Certes, kinésithérapie et psychomotricité
ne sont pas absolument hétérogènes, mais l’avis N°74 du Conseil Général des Hautes Ecoles insiste
sur l’éloignement des deux formations, affirmant la non-concurrence entre la spécialisation
proposée aux étudiants de kiné et le bachelier entièrement consacré à la discipline.
Du côté néerlandophone, la KULeuven dispense l’option en psychomotricité pour la kinésithérapie

dans le cadre du master « sciences de la revalidation et de la kinésithérapie ». Cette option
comprend 42 ECTS. Aucun alignement à la formation minimum définie au niveau européen n'est
actuellement envisagé.
Dans ce contexte, s’annonce la dernière étape de la reconnaissance du psychomotricien, celle en
tant que métier de la Santé au niveau du Ministère de la Santé Publique Nationale Belge.
En 2009, l’administration de la santé publique nationale a réalisé un dossier mettant en évidence la
possibilité d’une reconnaissance légale différenciée entre les deux entités.
En 2013, quatre moins après le début du bachelier, le Conseil National des professions
paramédicales, a mis en place un groupe de travail pour rendre un avis sur la demande de
reconnaissance francophone. Dans ce groupe, composé des professions de la santé déjà reconnues et
majoritairement néerlandophones, il n’y avait qu’un seul psychomotricien francophone avec droit
de vote. « A aucun moment, les arguments amenés par les psychomotriciens francophones et
justifiés par de nombreux documents, n’ont été repris. L’invitation comme expert du docteur J.M.
Gauthier, professeur reconnu de l’Université de Liège a été refusée »2. Ce groupe de travail a rendu
un avis contraire, prenant appui sur l’argument concernant la présence de compétences de base du
psychomotricien dans d’autres formations paramédicales.
Si ces compétences sont bien présentes, elles sont marginales au regard de celles qui sont
développées en 180 crédits dans le cadre du bachelier, dont la plus-value a été démontrée par le
Conseil général des Hautes Ecoles comme offrant une réponse à un besoin sociétal. Selon l’ARES,
« il ressort clairement par la comparaison des grilles avec d’autres sections telles que la
kinésithérapie, l’ergothérapie et la logopédie que le contenu de cette formation se distingue par son
approche spécifique de la psychomotricité dans toute sa dimension relationnelle »3. « Notons que
1250h d’activités d’enseignement sont consacrées à la psychomotricité dans la grille de formation.
Les stages du Bachelier en psychomotricité sont exclusivement effectués dans ce domaine, au
contraire des autres professionnels pour lesquels un stage en psychomotricité n’est même pas
obligatoire »4.
3. Cadre légal
Mis à part l’acte défini dans la Circulaire du 15 mars 2002 de Frank Vandenbroucke au
kinésithérapeute individuel, il n’y a aucune législation déterminant les soins apportés aux troubles
psychomoteurs. Or cet acte a un champ d’application très limité et est restrictif au niveau de l’âge.
Il ne concerne que les enfants de moins de 16 ans, après avis d'un spécialiste en (neuro)pédiatrie et
proposition de traitement, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé; et
les enfants jusqu'à 18 mois inclus, présentant des troubles manifestes cliniques du développement,
établis à l'aide d'une évaluation effectuée par une équipe pluridisciplinaire spécialisée.
La loi relative aux droits du patient du 22 août 2005, article 5 définit que: «Le patient a droit, de la
part de son praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins». On ne peut
hélas pas garantir le respect de cet article puisque le psychomotricien n’est pas considéré comme un
praticien, tel que défini par l’article 2, 3° de la même loi faisant référence à l’arrêté royal n°78 du 10
novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, ni tel que visé dans la loi du
29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de
l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales.
Pourtant, dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et
primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, articles 3, 3bis, 3ter, la
2 Jean-Pierre YERNAUX, Lettre ouverte suite aux derniers évènements et courriers concernant la psychomotricité, 21
juin 2016.
3 ARES, Argumentaire relatif au titre professionnel lié au bachelier en psychomotricité, p.2.
4 Idem, p.3.

psychomotricité est de toute évidence un élément déterminant du développement de l’enfant. Elle
est reconnue comme facteur favorisant l’épanouissement corporel et moteur de l’enfant. L’ONE
reconnait d’ailleurs l’importance de la pratique et agrée des ateliers de psychomotricité.
L’article 19§2 du décret du 3 avril 2009 de la Région Wallonne relatif à l'agrément des services de
santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de
subventions, détermine que sur la base d’un projet de service de santé mentale, des fonctions
complémentaires sont accordées par le Gouvernement, dans le domaine de la psychomotricité
notamment. L'article 15§ 2 de ce même décret détermine les diplômes nécessaires pour les
travailleurs exerçant une des fonctions complémentaires, parmi lesquels, le diplôme en
psychomotricité.
C’est ainsi qu’au sein d’un Service de Santé Mentale (ou Centre de Guidance Psychologique)
Provincial, on trouve par exemple, « une psychomotricienne [qui] propose un suivi thérapeutique
individuel. Les séances de psychomotricité sont destinées à des enfants de 2 à 10 ans présentant des
troubles liés au contrôle tonico-émotionnel et à la construction de la vie relationnelle ainsi que les
troubles de l’efficience motrice, de l’organisation praxique, du schéma corporel »5. « Le panel des
demandes motivant l’arrivée des enfants à l’atelier (…) est assez large : trouble de l’attachement,
inhibition psychomotrice, agressivité, légère déficience mentale, agitation,… Plus globalement,
l’atelier accueille des enfants avec des problématiques liées à l’adaptation ; il n’y a ainsi pas de
pathologie lourde, mais plutôt des difficultés d’insertion dans la collectivité. Je dirais que ces
enfants sont en difficulté relationnelle et que cela se concrétise par exemple par des difficultés
scolaires (la source principale des demandes de prise en charge) »6.
4. Intervention des mutuelles
Toutes les mutuelles interviennent via l'assurance obligatoire pour l’acte de kinésithérapie repris
dans la nomenclature : « Pour les pathologies reprises dans la liste F, jusqu’à 60 séances par an
seront remboursées au tarif le plus élevé, avec un maximum de 30 séances par prescription ». Sur la
base de l’avis du Conseil technique de la kinésithérapie, les sous-catégories suivantes pour la liste F
ont été retenues : les pathologies post-traumatiques, certaines affections respiratoires, les
neuropathies périphériques, les troubles de développement psychomoteur, la rééducation à la
marche chez les personnes âgées, la rééducation fonctionnelle chez les patients atteints du syndrome
de fatigue chronique et de fibromyalgie.
Outre ces interventions prévues dans le cadre de l'assurance obligatoire, certaines mutuelles
répertoriées par l’INAMI interviennent dans le cadre de l’assurance complémentaire pour des
séances de psychomotricité, sous certaines conditions, telles que la reconnaissance par l’Union
Professionnelle Belge des Psychomotriciens Francophones.
Il est difficile d’évaluer aujourd’hui le nombre de psychomotriciens, qui sont souvent répertoriés
administrativement sur base de leur première formation, tout en ayant été engagés pour une fonction
de psychomotricien sur base d’une formation complémentaire en psychomotricité. On peut, en
fonction des informations disponibles actuellement, considérer qu’il y a environ 350 personnes
travaillant effectivement en tant que psychomotricien (du côté francophone), parmi lesquelles plus
de 60 ETP psychomotriciens répertoriés officiellement dans les institutions de l'AWIPH. Plus d’un
millier d'étudiants sont inscrits au bachelier.
5 Anne FONTAINE, « Quand le regard de l’autre-étranger impose le silence du jeu/je. Etude d’un cas de mutisme
sélectif dans son investissement de l’espace relationnel », Travail de fin d’études en vue de l’obtention du titre de
Bachelier en psychomotricité, Catégorie Paramédicale, CESA, Année scolaire 2015-2016, p.25.
6 Idem, p. 26.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%