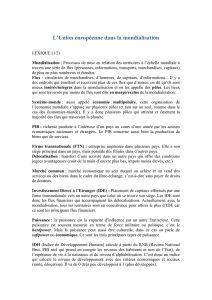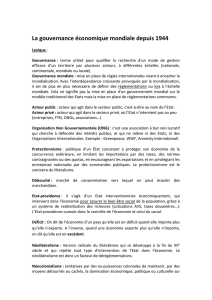Chapitre 2 : La mondialisation, fonctionnement et territoires

Chapitre 2 : La mondialisation, fonctionnement et territoires
La mondialisation, caractérisée par l'intensification des échanges à l'échelle planétaire se
déploie dans tous les domaines. Elle est liée à la diffusion du capitalisme marchand, industriel
et financier, repose sur un système géoéconomique et géopolitique mis en œuvre dans un
contexte libéral mais concerne également tous les liens d'interdépendance entre différentes
parties du monde dans le secteur de l'information et des communications. Les migrations
internationales, elles aussi en forte croissance s'insèrent aussi dans ce processus. Les acteurs
de la mondialisation sont très nombreux, encadrent l'organisation des territoires, on assiste
également à une explosion des flux mondiaux. La mondialisation structure l'espace mondial
mais hiérarchise également les territoires ce qui entraîne de nombreux débats. Les inégalités
sont en effet présentes à toutes les échelles entre pôles et périphéries, entre espaces
géostratégiques et territoires en marge de cette dynamique.
Ainsi comment la mondialisation fonctionne-t-elle et comment organise-t-elle les différents
espaces de la planète ?
Leçon 1 : Quels types d’acteurs sont impliqués dans le système mondialisé ?
Comment s’organisent les flux de biens, de services, d’informations à l’échelle planétaire ?
Quels débats et quelles contestations le processus de mondialisation nourrit-il ?
A) Une diversité d'acteurs
Les États demeurent des acteurs impliqués dans la mondialisation. Ils sont à l'origine de nombreux
accords comme ceux du GATT( General Agreement on Tariffs and Trade) signés en 1947,
remplacé aujourd'hui par l'OMC. Il s'agit de baisser les tarifs douaniers pour développer le principe
de l'économie de marché. Les États encadrent ainsi l'organisation des territoires par leur rôle
géopolitique (à l'ONU ou durant les sommets européens), géoéconomique, social, juridique. Ils
assurent la défense et la promotion de leurs intérêts à travers les organisations continentales ou
économiques (UE, ALENA, MERCOSUR, ASEAN, APEC) qui visent à renforcer les liens
d'interdépendance entre États voisins (solidarité de proximité)
Ces organisations internationales sont donc également dans cette logique de mondialisation comme
le FMI (Fonds monétaire international) qui accorde des prêts aux pays en difficulté financière. La
banque mondiale contribue par des financements au développement des États membres.
Les FTN ( déf à connaître : entreprise d'une certaine taille économique développant son activité à
l'échelle internationale et présente à travers des filiales productrices ou commerciale dans au moins
6 pays différents) sont également des acteurs essentiels. Elles réalisent 57 % du PIB mondial et
assurent au moins 1/3 du commerce mondial.
Elles ont une influence et un pouvoir d'actions considérables, ont des liens étroits avec le pouvoir
politique et sont responsables de la plupart des IDE (investissements directs à l'étranger.)
On compte 80 000 firmes et 75 millions de salariés travaillant dans les FTN.
Elles mettent en place une DIT (division internationale du travail) qui spécialise les territoires à
toutes les échelles (fournitures de produits primaires, biens manufacturés, services)
D'autres acteurs, organisés en réseaux ou communautés humaines rendent compte également du
phénomène de mondialisation à travers leur interdépendance. Cela est visible à travers les relations
familiales, culturelles entre des immigrés vivant dans un territoire et qui envoient par exemple de
l'argent à leurs familles restées au pays.
Ce sont des liens que l'on peut introduire dans cette notion d'interdépendance qu'est la
mondialisation.

Les ONG (organisations non gouvernementale) agissent et mobilisent l'opinion sur des causes
transnationales, humanitaires comme Médecins du monde, Action contre la faim ou
environnementales comme WWF/ Greenpeace.
Ainsi à retenir :
Les principaux opérateurs des processus de mondialisation appartiennent au secteur privé
(firmes transnationales et leur cortège d’entreprises sous-traitantes)
➢ Exemple à donner : le téléphone portable/ Nokia considéré comme une firme transnationale/
Déploiement mondial
➢ C'est une entreprise quasiment présente dans le monde entier
➢ Marchés aussi bien présents dans les pays développés (États-Unis, Allemagne) que dans les
pays émergents comme le Brésil ou la Chine
➢ Stratégies spécifiques : localisation dans des pays où la main d’œuvre est moins chère et
conditions fiscales intéressantes.
➢ Possibilité de constituer aussi de vastes marchés de consommation en développement.
Des acteurs publics (groupements supranationaux, États)
Rôle important des États : Ils participent à l'économie mondiale, assurent la défense et la
promotion de leurs intérêts
➢ Ils participent à la gestion des relations internationales (ONU, OMC (organisation mondiale
du commerce, FMI)
➢ Organisations continentales
➢ Union Européenne
➢ ALENA (Accord de libre échange nord-américain depuis 1994, c'est une zone de libre
échange entre USA , Canada, Mexique
➢ Mercosur (marché commun du Sud, il regroupe des pays d'Amérique du sud : Brésil,
Argentine, Paraguay, Uruguay, Venezuela)
Autres acteurs :
Des associations, ONG (organisations non gouvernementales (ex : Amnesty International,
Greenpeace) qui fonctionnent selon des logiques de réseaux (à l'échelle mondiale). Ils
participent donc à la mondialisation en mobilisant l'opinion publique mondiale sur des
thèmes médiatisés (environnement etc...)
B) Une intensification des flux à l'échelle de la planète
Des flux humains en forte croissance :
Le nombre de migrants internationaux était de 214 millions en 2009. Les raisons sont multiples
mais sont en majorité liées aux inégalités de développement et à la pauvreté. Il s'agit d'un système
entre pôles émetteurs (Asie : Chine, Inde, Pakistan, Indonésie, Afrique et ensemble Amérique
centrale-Caraïbes)et pôles récepteurs (surtout Amérique du nord : USA, Europe occidentale).
On assiste aussi à une augmentation des migrations de main d’œuvre qualifiée dans les pays
développés : Brain drain : fuite des cerveaux)
On note également une augmentation des flux touristiques avec le tourisme comme produit de
grande consommation. Il se déploie au sein de trois grandes zones : bassin euro-méditerranéen,
bassin Amérique du nord/ Caraïbes, bassin Asie orientale-Pacifique.
Depuis 50 ans, le commerce international a explosé, les flux sont en augmentation mais
disparates.
Plus de 2/3 des échanges sont réalisés par les pays industrialisés, entre les 3 pôles (Triade)
Cet essor s'appuie sur la révolution des transports et des équipements plus performants comme les

ports avec leurs plate-formes multimodales (lieux de correspondance entre différents modes et
réseaux de transport) et le principe des hubs (plate-forme de correspondance dans un réseau de
transport)
On note aussi l'importance des flux d'informations (satellites, Internet, fibres optiques).
En 10 ans, le nombre de téléphones mobiles dans le monde est passé de 740 millions à 5, 3 milliards
Les flux financiers sont totalement mondialisés car ce sont eux qui s'affranchissent véritablement
des frontières à travers la capitalisation boursière qui a été multipliée par 7 en 20 ans.
La logique spéculative (fait de faire circuler des capitaux en recherchant un profit rapide ne
correspondant pas à la production de biens ou de services ou à un investissement direct) renforce les
liens financiers entre les différentes places boursières, provoquant parfois des crises (une vingtaine
depuis les années 70)
A retenir :
Flux croissants de marchandises (ex qui peut être donné : ampleur des marchandises
exportées et importées à travers l'entreprise CMA/ CGM dont le siège social est à
Marseille) : trafic essentiellement maritime
➢ Flux financiers : marchés financiers devenus planétaires : une logique financière et
spéculative qui domine la mondialisation (on peut mentionner que ce système est instable :
crise de 2008)
➢ Flux d'informations, de communication (exemple de l'Iphone travaillé en classe que l'on
peut utiliser également pour les flux de marchandises)
➢ Flux et réseaux à travers des révolutions numériques (Internet etc...)
➢ Flux croissants des hommes : nombre croissant de travailleurs migrants, flux touristiques.
C) Une mondialisation en débat
La mondialisation libérale est contestée par les antimondialistes et altermondialistes qui dénoncent
les excès de la mondialisation renforçant selon eux les inégalités sociales et accusant les
actionnaires de s'accaparer les bénéfices.
De nombreux mouvements de contestations ont vu le jour (forums sociaux, mouvement des
indignés de Stéphane Hessel).
Pour trouver des alternatives, de nombreux comportements émergent comme l'économie sociale et
solidaire, le commerce équitable, de nouveaux modes de gestion démocratiques comme le
microcrédit sont envisagés.
De plus une tentation de redonner une place forte à l'intervention de l’État dans l'économie
nationale apparaît (protectionnisme et nationalisation détachés de logiques d'acteurs privés)
Leçon 2 : Quelles sont les caractéristiques des pôles et espaces majeurs de la mondialisation et
des territoires restés en marge ?
A) Hiérarchisation des territoires de la mondialisation
La mondialisation est transformée par la multiplication des pôles mais demeure malgré tout le fait
de trois principaux centres d'impulsion de l'économie mondiale : La Triade.
En 2008, ces trois pôles majeurs représentaient 70% du PIB mondial, 75% du commerce mondial et
90% des opérations financières mondiales.
Les États-Unis reste le pôle essentiel, le pays crée près d'1/4 de la puissance mondiale. L'UE joue
également un rôle essentiel en assurant 20% du volume total des importations et des exportations de

la planète. Le Japon est également un pôle majeur qui organise un espace asiatique polycentrique
puisque la Corée du Sud, Singapour et la Chine littorale participent à son dynamisme.
Les pays émergents sont des espaces de plus en plus actifs dans la mondialisation et visent à
devenir de nouveaux centres de l'économie mondiale : BRICS (Brésil (première puissance
économique du continent sud-américain, nombreuse richesses agricoles), Russie, Inde, (grande
puissance montante, se distingue dans des secteurs comme les industries pharmaceutiques,
biotechnologie, informatique..) Chine, Afrique du Sud). Leur IDH (Indice de développement
humain) demeure cependant encore bas comme la Chine qui malgré sa croissance économique a un
IDH de 0,699 et se classe au 100ème rang mondial.
D'autres États forment des pôles secondaires mais participent activement à la mondialisation
comme les pays pétroliers du Golfe persique (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite.)
On note cependant de nombreux espaces en marge de la mondialisation. Ce processus provoque en
effet une asymétrie existant entre les lieux centraux et les lieux périphériques qui assurent
seulement des fonctions de production et d’exécution.
Ceux qui sont le plus à l'écart sont les PMA (pays les moins avancés), essentiellement en Afrique
subsaharienne mais aussi en Asie et en Amérique. Ces pays connaissent des difficultés
sociales (accès à l'éducation, aux soins très restreint), économiques (peu d'emplois) politiques
(conflits, dictatures, instabilité gouvernementale). Ce sont cependant des espaces qui attirent
certaines entreprises de sous traitance avec des salaires faibles pour des activités de confection ou
de service (call centers)
Il existe aussi des États dits intermédiaires avec une situation moins catastrophique que les PMA
mais avec une croissance économique très limitée et une dépendance avec les PED. Ils exportent
des matières premières comme le Gabon pour l'énergie ou le Pérou pour les ressources minières.
Ainsi à retenir
Des zones inégalement intégrées à la mondialisation :
➢ Triade : rôle majeur dans l'organisation de l'espace mondial (Europe occidentale, Amérique
du nord, façade orientale de l'Asie (on ne le limite plus au Japon puisque maintenant intégration du
littoral chinois). Présence importante des principales villes mondiales dans ces zones
➢ Multipolarité en progression (de nombreux pôle émergent : intégration progressive dans la
mondialisation : Les BRICS, la Chine devient une puissance mondiale
➢ Les pays émergents : insertion spécialisée dans la mondialisation (Venezuela, Nigeria États du
Golfe pour les ressources énergétiques, Les Tigres asiatiques, Mexique pour le développement
industriel, certains produits agricoles : Chili, Argentine.
➢ Mais de vastes ensembles géographiques encore en retrait : Afrique, Asie centrale... : PMA
(pays les moins avancés)
Le rôle d'impulsion dans la mondialisation demeure limité donc à quelques pôles au sein de l'espace
mondial même si ils se multiplient
Ainsi l'économie mondiale devient multipolaire, les dynamiques des territoires évoluent
constamment mais des espaces demeurent encore en marge.
B) Les métropoles, un rôle essentiel dans la mondialisation
A une autre échelle, les grandes métropoles mondiales participent activement à la mondialisation.
Elles attirent, organisent les flux et fonctionnent en réseau pour former un archipel mégapolitain
mondial (AMM)

Elles concentrent des pouvoirs économiques, financiers et politiques. Elles ont des fonctions de
commandements (sièges de gouvernement, des organisations internationales, sièges sociaux des
FTN, des grands quartiers d'affaires, des marchés financiers (Wall Street à New York, la City
de Londres, Paris, Tokyo, Singapour)
Ce sont des villes avec une forte croissance : elles peuvent former des mégalopoles (tissu urbain
continu de métropoles)
On assiste ainsi au phénomène de métropolisation : explosion urbaine avec activités modernes et
internationales. Comme il y a une forte concentration de fonctions stratégiques dans ces zones,
concentration également humaine.
Mais les disparités socio-spatiales sont également présentes et dénoncées : ex des grandes
métropoles comme en Inde avec hôtels de luxe qui juxtaposent les bidonvilles, tensions sociales et
urbaines visibles dans les grandes villes)
C) Des zones d'interfaces de la mondialisation : les façades maritimes
Ce sont des espaces essentiels de la mondialisation : on assiste d'une part à un processus de
littoralisation (concentration des hommes et des personnes sur les littoraux)
Ce sont des Zones de connexion aux échanges mondiaux, le commerce se fait principalement par
voie maritime, ex : zone d'Asie du sud-est qui concentre les deux
premiers ports mondiaux : Shanghai et Singapour)
On distingue trois grandes façades maritimes :
La Façade atlantique de l'Amérique du nord qui s'étend de la vallée du Saint Laurent jusqu'au golfe
du Mexique, en passant par la Mégalopolis qui compte plus de 220 millions d'habitants!)
En Europe du Nord, la Northen Range qui s'étend du Havre à Hambourg, est la première façade
maritime du monde. Sur un littoral de 600 km, on trouve une concentration de ports de premier plan
(Rotterdam, Anvers, Hambourg, Amsterdam)
Enfin la façade maritime de l'Asie orientale composée d'une longue façade chinoise et d'un
ensemble d'îles et de presqu'îles. C'est la première façade maritime pour le volume de ses échanges
et par son dynamisme (Shanghai premier port mondial, Singapour le deuxième, Hong Kong...
Ces ports se développent très rapidement et sont très souvent des ZIP (zone industrialo-portuaire)
Les ressources des océans suscitent aussi des convoitises, les enjeux de ces espaces géostratégiques
sont donc nombreux. Les tensions sont multiples sur les marchés des matières premières
énérgétiques, cela a entraîné un essor de prospection et d'exploitation des hydrocarbures marins
(pétrole et gaz).
Les ressources exploitables dépendent également de la délimitation des frontières en milieu
maritime gérée par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM)
1
/
5
100%