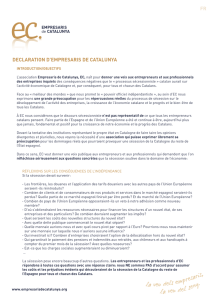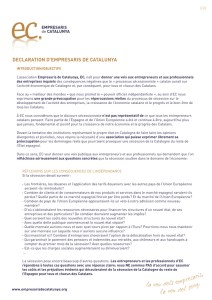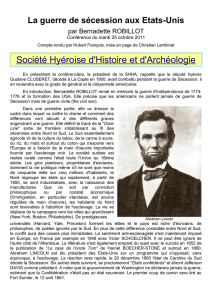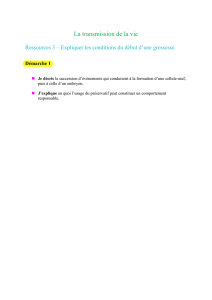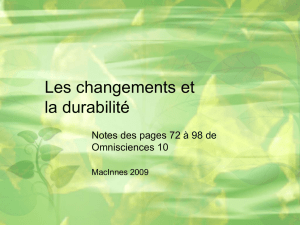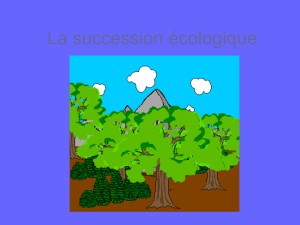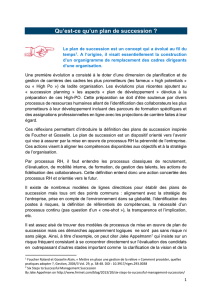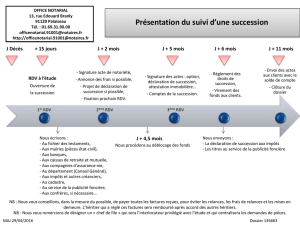Les séparations d`États dans l`Union européenne

BANQUE DES MÉMOIRES
Master de Droit international public
Dirigé par Yves Nouvel et Carlo Santulli
2015
Les séparations d'États dans l'Union
européenne
Charles-Emmanuel Detry
Sous la direction de Gérard Cahin

J'adresse tous mes remerciements à M. le Professeur Gérard Cahin pour la qualité de ses
enseignements et pour sa disponibilité et sa bienveillance dans l'accompagnement de ce mémoire.
Au terme de cette dernière année de master, je souhaite également assurer les membres de ma
famille, parents et grands-parents, de ma reconnaissance et de mon affection pour leur total soutien
au cours de mes études.

Introduction
Actualité et place du phénomène dans les relations internationales
Paradoxes et enjeux propres à l'Union européenne
Position du problème en droit international
Partie I. Le démembrement d'un État de l'Union européenne
Titre 1. La séparation d'une collectivité de son État d'origine
Chapitre 1. Caractéristiques des collectivités potentiellement séparatistes dans l'Union européenne
Chapitre 2. Appréhension par le droit international et européen des séparations d'États
Titre 2. Les options d'autodétermination de la collectivité séparatiste
Chapitre 1. L'accession à l'indépendance comme nouvel État
Chapitre 2. L'intégration à un autre État membre de l'Union
Partie II. Le destin de la collectivité séparatiste dans l'Union européenne
Titre 1. Les solutions suggérées par la pratique internationale
Chapitre 1. L'indétermination du droit applicable à l'Union européenne
Chapitre 2. L'appartenance aux organisations internationales après une séparation d'États
Titre 2. Les aménagements envisageables à raison de la nature particulière de l'Union
Chapitre 1. L'Union européenne, « objet politique non identifié »
Chapitre 2. Les solutions inspirées par le modèle de la Fédération
Conclusion
Note : une table des matières complète est disponible à la fin du mémoire.

Hergé, Le Lotus bleu, Bruxelles, Casterman, 1946, p. 31.

INTRODUCTION
Jean Monnet a résumé sa conception de la construction européenne par cette formule
lapidaire : « nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes ». Soixante-cinq ans
plus tard, le point de vue du droit international demeure différent sur la question : puisque la
forme étatique reste la seule configuration par laquelle les peuples deviennent pleinement
aptes à la vie internationale, c'est bien la « coalition » des États qui permet l' « union » des
hommes. C'est ainsi que l'Union européenne fut fondée par un traité, acte parfaitement
interétatique par lequel ses membres appellent à l' « union sans cesse plus étroite entre les
peuples de l'Europe »1, sans pouvoir évidemment préciser quels peuples il s'agit d'unir. Or,
dans un monde qui compte près de quatre fois plus d'États en 2015 qu'il n'en rassemblait à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, nombreuses sont toujours les collectivités qui aspirent à
grossir leurs rangs en accédant à cette qualité, si l'on en juge par la proportion importante des
membres des Nations Unies encore travaillés à ce jour par des mouvements séparatistes.
En effet, dans la mesure où les espaces non territorialisés se font rares, l'apparition
d'un nouvel État procède normalement du démembrement d'un État existant. Les Européens,
marqués depuis vingt-cinq ans par les séquelles de l'éclatement de l'URSS et de la
Yougoslavie, ont une expérience récente et dramatique du processus. Après la déclaration
d’indépendance du Kosovo, l’historien Jean-Arnault Dérens avait estimé qu’il ne fallait pas y
voir « la dernière pièce du puzzle post-yougoslave, mais la première pièce d’une nouvelle
fragmentation »2, prédiction que semblent confirmer les récents événements d'Ukraine. Un vif
débat porte sur le rôle joué par l'Union européenne dans la crise qui a conduit au rattachement
de la Crimée à la Russie et à un conflit d'indépendance dans le Donbass ; mais à tort ou à
raison, l'Union européenne est aussi fréquemment accusée, à trop vouloir l'unité des États
membres, de saper l'unité au sein des États membres – en bref, d'alimenter les tendances
séparatistes dont les voisins de l' « autre Europe » n'ont pas le monopole et qui semblent
également grandissantes parmi les Vingt-Huit.
1Perspective tracée par le préambule du Traité sur l'Union européenne et aujourd'hui récusée par certains États
membres : le Premier ministre britannique David Cameron a fait un cheval de bataille de la suppression de cette
formule des traités européens, le gouvernement néerlandais ayant lui aussi exprimé récemment ses réticences.
2Cité dans T. GARCIN, « Vers une Europe de plus en plus fragmentée ? », Diploweb.com, 24 août 2011.
1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
1
/
79
100%