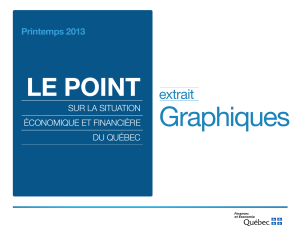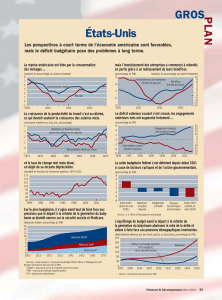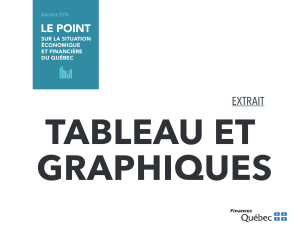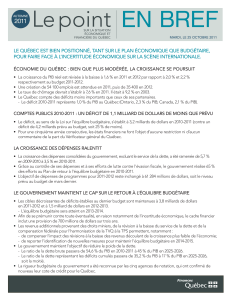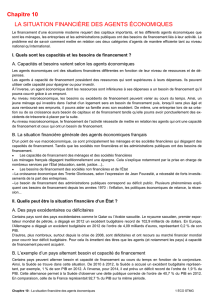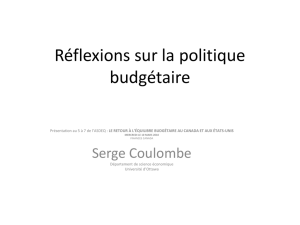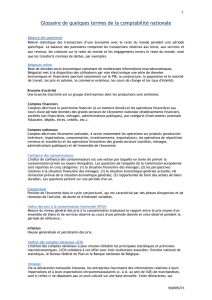Politique budgétaire

Séance du 22/10/2010
La politique budgétaire
I Les trois grandes fonction de l’Etat
Fonction d’allocation : allouer des biens ou des services
La fonction a pour objectif de satisfaire des besoins collectifs qui ne peuvent être rendus par
le marché tels que l’armée, la police, la justice, le réseau routier ou des besoins tutélaires tels
que l’éducation et la santé.
Problème de connaître la limite : certains services publics (eau, électricité, gaz,
télécommunications, poste, transport ferroviaire, autoroutes) sont maintenant concédés
à des entreprises privées. Dans certains pays la santé où l’éducation sont produits par
des entreprises privées.
Cette fonction s’exerce par la consommation publique et par la FBCF publique. La FBCF
publique ne contient les équipements militaires que s’ils sont susceptibles de servir à des fins
civiles (hôpitaux, infrastructures portuaires ..)
Fonction de redistribution des revenus :
La fonction s’exerce par les prestations sociales, c’est-à-dire par des transferts en espèces ou
en nature aux ménages, destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la
protection contre un certain nombre de risques ou de besoins (santé, logement, famille,
emploi, vieillesse). Ces transferts sont effectués par l’intermédiaire des régimes organisés de
façon collective (mutuelles), par des unités des APU ou des ISBLSM.
Limite entre prestations en nature et en espèces. Il est difficile de trancher entre le rôle
de répartition du revenu et de fourniture de services.
Le choix de financement de ces prestations relève aussi de la fonction de redistribution. Le
choix du type de recettes n’est pas neutre en terme de distribution des revenus. Les cotisations
sociales (à la charge de l’employeur, du salarié ou de l’indépendant) pèsent uniquement sur le
facteur travail et sont directement liées au risque que la prestation correspondante est censée
couvrir. Ce lien est affaibli dans le cadre des retraites par répartition et lorsque l’Etat
intervient avec des transferts pour couvrir le déficit de la Sécurité Sociale. L’impôt pèse sur
tous les revenus (travail et capital, revenus d’activité et retraite) et appelle donc à contribution
autant les actifs que les non actifs. Sa base est plus ample. Le choix du type d’impôt a une
grande importance en termes de redistribution. Par exemple la TVA pèse au final sur le
consommateur et donc sur les ménages moins riches. Par un même impôt on peut effectuer
une redistribution, par exemple, le barème de l’IRPP est progressif (différents taux), il
contient des déductions, des exonérations etc.

Fonction de régulation conjoncturelle/économique
C’est l’aspect que l’on étudie ici, celui de l’impact de la politique budgétaire sur la croissance
ainsi que celui de la croissance sur la politique budgétaire
II Les concepts pertinents
dans la comptabilité nationale, le secteur institutionnel des APU regroupe les
unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non
marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu ou du patrimoine.
Leurs ressources principales sont des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations
sociales). Le SI est subdivisé en trois sous secteurs : administration centrale (APUC),
administrations locales (APUL) et administrations de sécurité sociale (ASSO).
- l'APUC est formée de l'Etat et d'organismes divers d'administrations centrales
(c'est le sens du sigle ODAC) qui en dépendent : universités, CNRS, CEA,
ANPE, …
- les APUL regroupent les collectivités locales et des organismes divers
d'administrations locales (ODAl).
- les administrations de sécurité sociale rassemblent toutes les unités qui
distribuent des prestations sociales à partir de cotisations sociales obligatoires
(régimes d'assurance sociale), et les organismes auxquels ces unités procurent
leurs ressources principales (hôpitaux publics,…), appelés organismes
dépendant des assurances sociales (ODASS).
l'importance économique des APU repose sur l'importance de leur valeur ajoutée (18
% de la VAB totale, 16 % du PIB en 2001) et sur celle des prélèvements obligatoires
collectés (45 % du PIB).
- les APU dégagent le plus souvent un besoin de financement (ce qui reste de
l’épargne après les dépenses d’investissement), ce qui n'est pas vraiment
problématique dans la mesure où de nombreuses dépenses publiques sont un
investissement pour l'avenir.
- le taux de prélèvements obligatoires effectifs est le rapport de tous les
prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) au PIB. On assimile
souvent la montée de ce taux de PO à celle du rôle de l'Etat providence. De
1960 (32,2 %) à 1984 (45,5 %), les trois quarts de la hausse du taux de PO
sont dus aux cotisations sociales (socialisation de la répartition) et un quart
seulement aux impôts. L'élévation du taux de PO peut aussi être due à la
faiblesse de la croissance (le numérateur croît plus vite que le dénominateur).
Si par exemple, le PIB avait crû après 1974 au même rythme que de 1965 à
1973, le taux de PO aurait atteint seulement 38 % en 1984 ! Si les prestations
sociales liées aux chômage étaient restées analogues à ce qu'elles étaient
avant le premier choc pétrolier, le taux de PO aurait été de 42,5 % en 1984.
ces quelques remarques et calculs montrent qu’il est abusif d'identifier le poids de
l'Etat à celui des seuls PO. La CN permet de ce point de vue des analyses moins
grossières en présentant plusieurs ratios (base 1980):
- le taux de PO effectifs, de 43,6 % en 2004
- le taux de prélèvements nets de transferts (PO utilisés par les APU pour
financer leur fonctionnement), de 19,4 %

- le taux de PO effectifs consolidés (PO déduits des PO que se versent
mutuellement les APU), de 41,8 %
- le taux de prélèvements nets consolidés, de 16,6 %
- de plus, les conventions de la CN et ses révisions régulières font que le taux
de PO effectifs a été au cours du temps plutôt révisé à la baisse. Ces révisions
imposent de relativiser le fétichisme dont sont assortis ces chiffres et l'idée
d'un seuil de taux de PO à ne pas dépasser (40 % sous Giscard, 45 % pour
Mitterand).
depuis quelques années, le poids des dépenses publiques dans le PIB prend parfois la
vedette au taux de PO dans les débats, en partie parce que ce ratio est naturellement
plus élevé que le taux de PO (54 % en 2004 contre 43,6 % pour le taux de PO). L'écart
entre les deux ratios vient de ce que les PO ne sont pas les seules ressources qui
permettent des dépenses. Si la hausse du poids des dépenses publiques dans le PIB
entre la fin des années 1970 et la première moitié des années 1980 est bien le résultat
d'un accroissement du degré de socialisation de l'économie française, ce mouvement
s'est interrompu depuis 1985. Depuis presque vingt ans, le poids des dépenses
publiques dans le PIB dépend essentiellement de la conjoncture.
III Impact de la politique budgétaire sur l’activité
Ces politiques conjoncturelles sont d'un ressort connu : action par les dépenses
publiques et jeu du multiplicateur keynésien (multiplicateur budgétaire) ; action sur les
impôts et soutien au revenu disponible des agents (jeu du multiplicateur fiscal). En
théorie, le multiplicateur fiscal est plus faible que le multiplicateur budgétaire
(multiplicateur budgétaire en économie ouverte:
1
1
1 (1 )
Y G k G
ct
;
multiplicateur fiscal en économie ouverte:
0 3 0
1 (1 )
c
Y T k T
ct
si on
joue sur le montant des impôts (
31
kk
car c<1)) car la baisse initiale des impôts est
pour partie épargnée par les agents privés. Elle ne soutient donc pas la demande
intérieure dans les mêmes proportions qu'une hausse de même ampleur des dépenses
publiques. Multiplicateurs budgétaire et fiscal peuvent être utilisés aussi pour ralentir
l'activité économique.
les effets favorables d'une politique budgétaire expansionniste sur la demande
intérieure peuvent être contrebalancés par leurs effets sur les variables
financières. Toutes choses égales par ailleurs, la dégradation du solde public suite à
une politique expansionniste peut se traduire par une tension à la hausse sur les taux
d'intérêt. Cette hausse tend à freiner l'investissement productif et résidentiel (effet
d'éviction par le taux d'intérêt à la fois à cause de la hausse même des taux et à
cause de l'éviction des besoins de financement des entreprises par les besoins du
gouvernement sur le marché des capitaux et des crédits), mais elle peut aussi attirer les
capitaux étrangers. Cet afflux exerce à son tour deux effets contraires : d'un côté, il
stimule la demande intérieure (ces capitaux financent l'investissement intérieur) ; de
l'autre, il pousse à la hausse le taux de change national, ce qui réduit la compétitivité
prix du pays et donc freine ses exportations (c'est l'effet d'éviction par le taux de
change).
au total, l'effet expansionniste d'une politique budgétaire de relance sera d'autant
plus fort

- que l'économie est relativement fermée (cf formule du multiplicateur en
économie ouverte
1'
1 (1 )
Y G k G
ct
: plus
est petit plus k’
est grand)
- que le surcroît de demande s'adresse aux producteurs nationaux
- que l'emploi (donc les revenus) s'ajuste rapidement à la production
- que l'investissement est sensible à l'évolution des débouchés
- que l'économie dispose d'importantes capacités de production inemployées
(sinon l'ajustement passera aussi par plus d'inflation ce qui réduira l'effet
expansionniste)
- que les taux d'intérêt sont peu sensibles aux évolutions du solde public
- que l'investissement et la consommation sont peu sensibles au niveau des
taux d'intérêt
- que les flux de capitaux et le taux de change réagissent peu aux variations de
taux d’intérêt.
ces considérations montrent bien dans quelle mesure l'efficacité des politiques
budgétaires peut s'être émoussée. En effet, les économies d'aujourd'hui sont de plus
en plus ouvertes, les variables financières y prennent une place de plus en plus
importante. Dans ces conditions, le multiplicateur budgétaire est empiriquement
relativement faible. Pour la France, on estime ainsi qu'un surcroît de dépenses
publiques équivalent à un point de PIB se traduit par une hausse du niveau du PIB de
l'ordre de un point aussi, de sorte que le multiplicateur budgétaire serait
aujourd'hui proche de l'unité (ce n'est donc plus trop un multiplicateur !).
les politiques de relance ne sont de plus efficaces à court terme que si elles sont
crédibles (on retrouve l’importance de cette notion comme pour la politique
monétaire), cad si les ménages et les entreprises estiment que ces politiques vont
effectivement soutenir la croissance. Dans le cas contraire, et notamment si les
ménages s'inquiètent de la détérioration des finances publiques, ils peuvent épargner
leur surcroît de revenu et l'expansion budgétaire creuse le solde public sans soutenir la
croissance. Très concrètement, en France, l'échec relatif des dernières politiques de
relance (1975, 1981-1982, 1991-1993) en a durablement réduit la crédibilité. Certains
petits pays (comme le Danemark ou l'Irlande) et même les Etats-Unis sous le second
mandat de Clinton, où la situation des finances publiques étaient initialement très
dégradée, ont au contraire pu connaître des périodes où des politiques budgétaires
restrictives étaient perçues comme une bonne nouvelle par les agents économiques, si
bien qu'elles s'accompagnaient d'une forte croissance, à rebours du mécanisme du
multiplicateur keynésien. La communication et la pertinence de la politique (d’où
l’importance du diagnostic conjoncturel), comme en matière monétaire, joue donc un
rôle essentiel en matière budgétaire.
par ailleurs, l'utilisation de la politique budgétaire pour réguler la conjoncture se
heurte à des difficultés pratiques importantes.
- contrairement à la politique monétaire, la politique budgétaire est
relativement inerte : les autorités publiques ne peuvent modifier du jour au
lendemain le niveau des recettes et des dépenses publiques.
- de plus, les délais sont asymétriques : l'effet psychologique des hausses
d'impôts est immédiat alors qu'il faut parfois attendre près d'un an pour que
les agents économiques ressentent les effets des baisses d'impôts.
- enfin, le choix des dépenses à augmenter et des impôts à baisser pose
problème : une analyse fine de la conjoncture par le gouvernement s'impose
pour qu'il y apporte les remèdes qu'il juge les plus appropriés (et là encore, il
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%