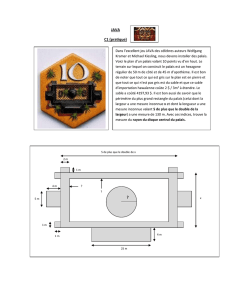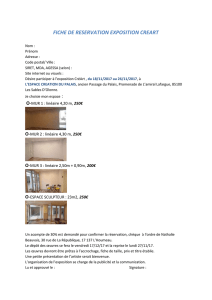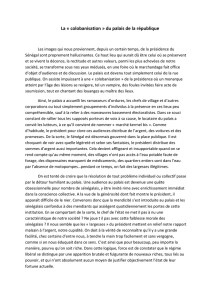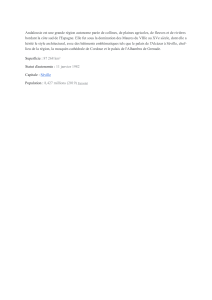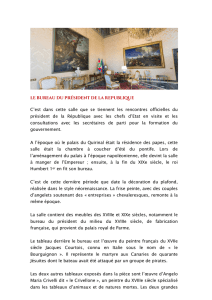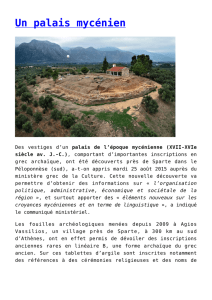histoire de l`architecture iii

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE III
1
HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE III
Architecture Renaissante du XVIe : reprendre les antiques (Rome et Grèce, méconnue alors) en connaissant
les règles de l’architecture. (Analyse en relevé, innovation des modes de représentation, redessin).
LES ORDRES
! Système de classification de l’archi européenne (XVe-XVIIe). Innovation renaissante, inspiration antique.
Traité de Serlio : premier à les classifier, un des 1ers théoriciens de l’archi dont on a des traces depuis
Vitruve (De Architectura). Présentation des ordres architectoniques à la 1ere page de son 4e livre : 5 colonnes.
TOSCAN (VI) / DORIQUE (VII) / IONIQUE (VIII) / CORINTHIEN (IX) / COMPOSITE (X)
- Rapport (numéros) entre le diamètre au pied et la hauteur. Elancement. De – en – robuste.
- Travail et Finesse des chapiteaux et bases. Plus grande complexité à droite.
- Signification. Idée reprise de Vitruve. Ordre robuste : dieux belliqueux, idée de force. Ordres plus fins :
déesses féminines (Vénus). Supposition erronée : Parthénon dorique, voué à
une déesse.
Adaptation et transmission à la religion chrétienne même si Saint Pierre de
Bramante est corinthienne. Puis généralisation de cette idée : ordres robustes
pour programmes publics de démonstration du pouvoir : prisons, forteresses ;
ordres riches et ornés : bâtiments privés des notables.
Toscan : invention vitruvienne
Dorique : présent dans la Grèce
antique. Métopes et triglyphes.
Ionique : présente dans la Grèce antique.
Chapiteau ionique à volute.
Corinthien : plus récent (confusions) basé sur
la Rome antique, meilleure représentation au
Panthéon. Chapiteau végétal (feuille d’acanthe).
Composite : dorico-ionique, réinterprétation
moyenageuse.
DONATO BRAMANTE
Originellement peintre à Milan, serait allé à Rome pour aller étudier les styles antiques ; en réalité,
perte de pouvoir de son commanditaire : va à la capitale pour les grands chantiers.
1er archi à créer une architecture au niveau de celle des antiques. Travaux répertoriés dans les livres de
Serlio (modèle que l’on peut reproduire). Egalement dans le traité de Palladio sur les antiques même s’il n’a
jamais atteint la richesse constructive d’alors, ne possédant pas les mêmes moyens matériels (plus
économique, reproduction des marbres par la peinture, raison du succès de Bramante).
Tempietto, San Pietro Di Montorio, Roma
Lieu supposé du Martyr de saint Pierre (en
réalité à la Basilique Saint Pierre). Lieu de
mémoire (cf dôme du rocher de Jérusalem) :
édifice à plan centré. Reprend la forme des
temples ronds antiques (cf Vitruve et vestiges
visibles de Rome).
16 colonnes à l’extérieur, introduction d’une
base au dorique. A l’intérieur, pas la place
donc 8 colonnes séparant des niches.
Métopes : mélange chrétien et païen
symbolique. A l’étage : accent sur les motifs
géométriques enfin, dôme en béton
All’Antica. Aucune correspondance des
ordres int / ext.
Palais : nouveauté. Même des gens peu
riches veulent leur palais. Exposition du
pouvoir.

Palazzo Caprini (o casa di Raphaelo), Roma
Seul palais de Bramante sur 3 dont on a une grande
documentation (écrit de Vasari). Modifications après son
achèvement.
Particularité : bossage rustique au rdc et couple de demi-colonnes
doriques à l’étage.
Rdc : portes sous arcades et lucarnes (logement du boutiquier).
Etage : ordre entoure les fenêtres.
! Distinction entre noblesse du piano nobile et commerce du rdc.
Nouveauté très appréciée.
Accès à la construction de palais à la bourgeoisie en utilisant des
méthodes économiques (béton, stuc …). Ici, bossage avec
système de coulage en béton.
Source : maisons de la Rome antique disparues (Pompéi XVIIIe),
Ouvrage de Fabio Calvo qui illustre les logements riches antiques,
origine : miniature du Ve de la Reine de Carthage en désespoir
depuis sa maison : bossage suivi d’une loggia à colonnade.
Palazzo Dei Papi, Roma
Jules II, arrivé au pouvoir, transfèrera ses appartements un étage plus haut afin de ne pas être
confronté aux souvenirs de son prédécesseur : construction d’un viaduc de 300 m pour mener
à la grande niche (détente et rafraichissement en été). Succession de 3 cours (inférieure,
médiane, supérieure) séparées par des escaliers monumentaux. Montrer la puissance papale
aux pèlerins en visite au tombeau de Saint Pierre.
Depuis la chambre du pape, vue perspective de la succession des cours, rompue par l’ajout
du portique.
Escalier du Belvédère : colimaçon, succession des ordres (sauf corinthien) au fil de
l’ascension selon la robustesse. Pour éviter les chocs des proportions et conserver les
rapports (la hauteur étant constante), les colonnes sont amincies au fur et à mesure. (8
toscanes, doriques, ioniques puis 12 composites). Toujours le même entablement.
Basilica di San Pietro, Roma
Jules II (passionné de construction de grands bâtiments) motivation à être
pape : destruction de la basilique constantine de Saint Pierre (au fur et à
mesure que l’on érige la nouvelle) pour en construire une nouvelle :
renforcer l’image papale et image de la ville aux pèlerins.
Plan centré (origine byzantine) divisé en 9 parties autour du
tombeau de St Pierre, intégration du chœur et de l’abside construits
récemment sous Nicolas V (Rossellino).
Piliers d’angles soutenant la coupole centrale : forme proche du ¼
de cercle : adoucir le carré stricte du plan centré. Mur de grande
épaisseur de béton avec niches incrustées (origine antique). Mais
abandon de cette idée car plan inconvenables pour les
cérémonies. Ajout d’une nef à ce plan centré (type croix latine).
Mort de Jules II et Bramante, les piliers supports de la coupole
avaient déjà été construits (pour obliger les successeurs à
construire selon Bramante). Sur le modèle du Panthéon mais trop
faibles : construction plus tard avec même idée.
La voûte : colossale (2m d’épaisseur). Procédé antique de coulage de béton avec caissons de bois
octogonaux disposés sur des cintres en bois. Arcs en briques constituent la structure principale, béton coulé
dans l’entre-arc.
Palais des tribunaux
Il n’existait pas de type ‘tribunal’ en Europe. Rome : 10aine de
tribunaux mal organisés, mauvais fonctionnement de la justice.
Regroupement en un seul tribunal : renforcer le pouvoir de la justice
et du pape.
Réalisation d’une grande place devant ce palais.
Grand plan centré sur une cour avec portique. (idée antique : place
entourée de bâtiments publics, forum). 4 grands escaliers publics
menant aux 4 tribunaux, 4 escaliers privés (logements des juges sur
le site, éviter la corruption). Prisonniers dans caves et tours d’angles :
renforce l’image de forteresse (+ bossage rustique colossal en

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE III
3
travertin au rdc). Salles de tortures au fond pour ne pas déranger.
RAPHAEL
Plus connu pour ses peintures. Il est reçu à Florence dans les ateliers de Michellangelo et da Vinci. Puis
appelé par Jules II à Rome, alors au sommet de son succès. Successeur désigné de Bramante sur le
chantier de Saint Pierre (apprend l’architecture en dessinant celle de Bramante). A à peine 30 ans, c’est une
grande charge, s’aide des écrits de Vitruve. (Reprend l’idée de la nef de Bramante)
Villa Madama, Roma
Commanditaire : futur pape Clément VII pour le pape Léon X (pour que la villa reste dans le patrimoine privé
des Médicis). A 10 km de Rome, lieu de villégiature pour des séjours non prolongés et vivre à l’Antique. Sur
la route des messagers (rester au courant des affaires).
Aide de Fabio Calvo et Antonio Da Sangallo le Jeune (connaissance de Vitruve).
Seulement la moitié sera construite (même pas le théâtre).
Madama : fille de Charles V, de la famille de Léon X, a repris la villa à sa mort.
PLAN : D’un côté la rivière, de l’autre la
colline. Composition du plan selon un axe
longitudinal centré sur une cour
circulaire : un écrivain latin, Pline le jeune
avait écrit que la forme idéale et le D mais
mauvaise retranscription en O. Sur le
côté, une piscine : être alimenté en
poisson frais (cf antique).
Loge majeur au Nord pour ne pas souffrir
de la chaleur en été. Théâtre de forme
grecque sur le pan de la colline. Léon X
appréciait beaucoup la chasse : des
boxes pour 200 chevaux.
FACADE : bâtiment pas très haut, pièces secondaires en
bas (cuisine).
Bases des pilastres et piédestaux en travertin. Corps du
pilastre : alternance briques et tuf, piliers couverts d’enduit.
Méthode économique. Chapiteaux et angles en travertin
(importance des angles devant être véritables mise en
avant dans le traité de Scamozzi, le reste peut être enduit :
solution suffisamment durable car visible depuis les antiques)
Certain piédestaux sont en tuf couvert de stuc (et non en travertin) :
logique des éléments loin des yeux ou loin du passage (risque de
choc).
Au niveau de la corniche : consoles en travertin séparées par des briques. Architrave : plate bande séparée
par des éléments structuraux en travertin ou tuf (source antique, dessin de Giuliano da Sangallo : portique de
Pompée). Eléments très saillants (40 cm), usage impossible de la brique seule. Le
tout est enduit. On aurait pu utiliser un monolithe de marbre, mais solution moins
économique.
! Bâtiment qui n’a jamais été rénové, nous donne beaucoup d’informations sur les
méthodes de construction à l’antique de cette époque.
On ne connaît que 6 palais de Raphael.
Palais Branconio
Giovanni Branconio : conseiller des papes Jules II et Léon X. Protégé du Vatican,
rente papale. Volonté de faire construire un palais visible depuis celui des papes
(prouver à Léon X qu’il pouvait devenir cardinal). Dans la même rue que le palais
Caprini. Plusieurs projets avant la solution finale.
PLAN : fenêtres de la grande salle donnant sur la rue principale, cuisine au 1er étage
(pas commun) mais possibilité d’avoir les plats chauds, escalier secondaire pour
rejoindre la cave. Cheminée pour éviter les odeurs. Puit pour eau à proximité.
FACADE : type nouveau, inspiration du Palazzo di Traiano (appelé aujourd’hui

mercati di traiano, dessin de Giuliano da Sangallo).
1er projet : Volonté de 4 boutiques + entrée mais cela donne au 1er étage des ouvertures trop grandes. Peu
appréciable mais montre la capacité d’analyse antique.
2e projet : les arcades sans tabernacles deviennent des niches, largeur
réduite. Les boutiques sont dans l’axe. Les ouvertures à l’étage sont élargies.
Ajout de colonnes et d’arcades au dessus des boutiques, ornementation,
feston, armoiries avec les 2 aigles.
2e étage, totalement différent.
Solution aux angles : axe demi colonne – niche – élément rectangulaire : non
vertical : réduction de la niche et de l’élément rectangulaire et également
déplacement de l’axe vers la droite à chaque étage. Irrégularité acceptée car
imperceptible et maitrisée.
Palazzo Alberini, Roma
Commanditaire : riche marchand (ni noble, ni homme d’église). Palais pour
être loué à deux banquiers. Situé dans la rue des banques majeures rendue
régulière par Jules II.
Boutiques du rdc bâties rapidement et utilisées pendant la construction :
mise à profit des rentes tirées pour la construction du reste de l’édifice.
PLAN : 2 appartements identiques pour 2 familles. Pas de couloirs
mais logique d’enfilade des pièces publiques. Liaison directe cuisine-
bûcher.
FACADE : rdc bossage rustique, 1er étage : ordre dorique simplifié, 2e
étage secondaire (moins haut). Rappel d’une construction contemporaine :
palais Caprini de Bramante.
Rdc : bossage diff du palais Caprini : plat et en table, joints évidents mais
réduits en profondeur.
Grande plate bande au dessus des boutiques. Demi cercle : briques très
polies. Joints apparents différents des joints réels.
1er : plus de demi-colonnes mais simples pilastres. Plus de frise avec
métopes et triglyphes ni chapiteau.
2e : lignes géométriques en continuité avec le 1er. Fenêtres à oreilles aux 4
coins.
Sommet : loggia (typique Florence) afin d’avoir une vue de l’ensemble de la
ville.
! Référence n’est plus lisible : Raphael a adapté sa façade au point
de vue et à la lumière (expérience de peintre). Le traitement de la surface
correspond à la logique intérieure de la fin de l’empire (source antique).
Impossibilité d’observer la façade avec un point de vue frontal mais
seulement latéral : des demi-colonnes très saillantes cacheraient les
fenêtres (image confuse) : réduction de la saillance des éléments verticaux.
Pilastres peu saillants (2-3 cm) mais révélés par la lumière latérale rasante.
Eléments horizontaux ont une saillance normale.
Pas de volonté d’exposer la richesse ou le pouvoir car banquiers :
langage convenable à l’usage. Utilisation de matériaux riches et robustes.
ANTONIO DA SANGALLO LE JEUNE
D’une famille d’artisan (charpentier) liés aux Medici à Florence. 2
oncles architectes (Antonio da Sangallo le vieux et de Giulio da Sangallo) au
service des papes Jules II et Léon X. Devient architecte par l’expérience
pratique du projet et du chantier (aide de Bramante). Renforcement de
nombreux bâtiments de Bramante qui construisait très rapidement.
Bonnes connaissances de l’art de bâtir : plus ingénieur qu’architecte
selon certains (disaient qu’il ne rendait pas l’architecture comme un art
supérieur, jugé d’un niveau inférieur car pas peintre) : volonté de devenir
maître de la théorie de l’architecture en étudiant en détail Vitruve et les
antiques.
Ses connaissances ont aidé Raphael dans la villa Madama (construite à
l’antique sur une colline).
Importance pour le dessin (de haut niveau). Privilégiait la qualité à l’originalité.

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE III
5
Palais Farnèse
Volonté de reproduire la maison à l’antique selon Vitruve.
Un des plus grands palais de l’époque à Rome (x10 Palais Branconio mais
mêmes qualités architectoniques)
SITE : Palais entouré par 4 rues (dont la via Giulia), place
aménagée par le propriétaire devenu pape pour que la façade soit visible
de loin. Façade régulière. Entrée monumentale.
COUR : accessible par 4 entrées. Escalier comme zone publique
amène aux pièces principales (début d’un type). Superposition sur 3
étages de demi-colonnes (doriques, ioniques, corinthiennes,) illogique par
rapport à la hiérarchie des ordres, peut être pour donner plus
d’importance au piano nobile.
Corniche : concours remporté par Michel Ange. Le frère de ASGLJ écrira
au pape à ce sujet : il n’aurait pas suivi les règles Vitruviennes, strictement
ordonnées par ASGLJ. Corniche trop saillante et trop lourde.
ATRIUM : Fra Giocondo (1511) présente l’illustration du vestibulum
avec voûte en berceau de la domus selon Vitruve (erroné, Pompéi
découvert plus tard, on ne peut pas tout comprendre à partir de Vitruve).
Reprise de cette idée par ASGLJ pour l’atrium du palais.
! 2 rangs de colonnes + voûte en berceau avec caissons. Cour et
portique visibles.
Solution innovante de l’angle : pilier d’angle.
FACADE : bossage interrompu présent aux angles et à l’encadrement de la porte, de plus en plus
lisse avec les étages. (cf Florence, XVe). Surface en briques apparentes très soignée. Solution économique
d’inspiration antique. Banc : suit la forme d’un homme assis.
Système des ordres inversés par rapport à la cour. Suit les règles de Vitruve dans les détails, jusqu’au
chapiteau ionique.
Palazzo Baldassini, Roma
Plus petit projet mais même qualité (même taille que palais Branconio). Il
avait l’habitude de faire des petits projets pour des hommes moins
riches de la petite noblesse (Baldassini est avocat) mais même qualité
(simplicité certes mais mêmes principes). D’après les carnets d’ASGLJ,
les deux palais étaient dessinés sur les mêmes feuilles : solution
monumentale pour petit palais, véritable nouveauté en Europe.
! Ensemble sur un axe longitudinal traversant la cour avec même
disposition de l’escalier.
Mise en place d’une petite cour près de l’escalier pour lui apporter de la
lumière et éviter une irrégularité des fenêtres dans la façade.
ATRIUM : même idée avec pilastres plaqués contre le mur par
soucis de place.
FACADE : Même système de briques apparentes et bossage
(comme revêtement, la surface totale était en briques). Grand succès de
cette solution qui permettait une irrégularité qui serait visible avec un
système d’ordre : pdv pratique de ASGLJ.
COUR : Plus riche que la façade. Œuvre en pierres. Arcades
ouvertes sur un seul côté mais même esprit. Métopes de l’ordre
dorique : ni homme d’église ou noble mais homme de loi (codex,
tablettes)
Palais Sachetti, maison de Da Sangallo
Acquisition d’un palais déjà en construction. Il dû faire avec l’existant :
difficile de suivre Vitruve. Hauteurs déjà établies : impossible de faire un
escalier comme il veut ni de faire une cour selon un axe longitudinal.
Etude par le dessin (dessine le plan du 1er sur le rc par économie de
papier).
Puis à l’angle de la cour, au niveau de la cuisine : proximité de l’eau. 1er
étage ionique.
Façade : corniche : pièces en travertin structurels plus saillante que les
briques : permet d’enduire en stuc sans différence d’épaisseur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%