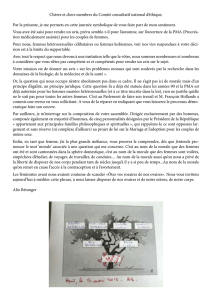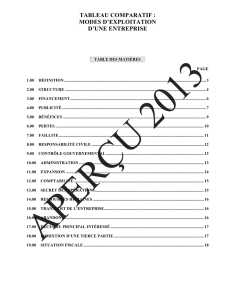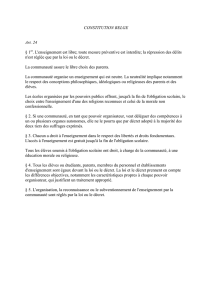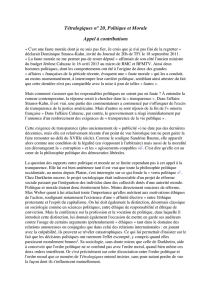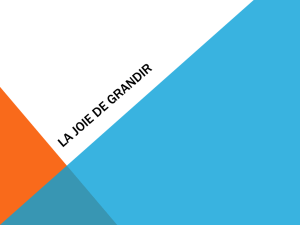La tradition juridique occidentale admet généralement l`hypothèse

Droit, éthique et responsabilité.
Jean-Louis Genard
La tradition juridique occidentale admet généralement comme un acquis l’hypothèse de la
séparation de la morale et du droit. Et c’est sur cette base que les interférences pouvant
survenir entre les deux domaines paraissent à chaque fois problématiques.
Comme le rappelle J. Habermas
1
, sans doute est-ce la philosophie kantienne qui a, à cet égard,
posé avec le plus de netteté les termes de cette disjonction au travers de la distinction bien
connue entre « agir par devoir » et « agir conformément au devoir ». L’objet spécifique de la
morale étant donc l’évaluation des intentions et de la bonne volonté, le droit ne s’intéressant
quant à lui qu’à la positivité des faits. Contre ce qui apparaît comme un acquis incontestable
de la modernité, des tendances récentes laissent penser à l’accentuation croissante des
chevauchements entre les deux disciplines et, notamment, à la multiplication d’attentes
adressées au droit en vue de « dire » la morale. Plusieurs événements qu’a connus la Belgique
ces dernières années semblent aller dans ce sens, mais le phénomène paraît bien avoir une
portée générale. Dès lors qu’est posée la question des rapports entre droit et morale, voilà très
certainement l’hypothèse le plus souvent assumée. Or, les choses ne sont à mon sens pas si
simples et, en tout cas, pas si évidemment univoques.
Tout d’abord, pour bien saisir l’évolution des relations entre droit et morale, il me semble
nécessaire de distinguer deux niveaux où peuvent se jouer ces interactions. Le premier serait
celui des références normatives, le second celui des formes d’interprétation de l’action, qui est
d’ailleurs celui sur lequel s’appuie la distinction kantienne puisque ce qui fait question chez
Kant c’est bien la possibilité d’opérer deux lectures de l’activité, l’une morale et l’autre
juridique. Un acte peut ainsi être juridiquement conforme tout en étant guidé par de mauvaises
intentions et donc moralement douteux.
Au premier niveau des chevauchements entre droit et morale seraient en jeu des contenus
moraux substantiels comme par exemple lorsqu’est mise en évidence une discrimination dont
serait l’objet telle ou telle catégorie sociale, le droit étant appelé à la condamner. Au second
niveau seraient en jeu les formes dans lesquelles est interprété l’acte litigieux, objet du recours
juridique. Dans ce second cas, il s’agit bien aussi de relations entre droit et morale dans la
mesure où l’enjeu de l’interprétation juridique est de savoir si l’acte incriminé sera ou non
interprété selon une grille de lecture faisant appel aux catégories morales, intention,
responsabilité, volonté, faute, culpabilité,…
En reprenant l’hypothèse aujourd’hui classique de M. Villey, on peut admettre que le droit
moderne s’est construit autour d’un processus de « subjectivisation du droit », c’est-à-dire
d’un processus au terme duquel les notions morales d’intention, de volonté… mais aussi de
faute et de culpabilité sont devenues constitutives du droit. Ce qui différencie fortement le
droit moderne du droit romain par exemple. D’une certaine façon, il serait d’ailleurs possible
de suivre l’évolution du droit moderne –et bien sûr particulièrement du droit pénal moderne-
au travers des évolutions des formes de problématisations de l’intention. Il faut d’ailleurs se
rappeler que l’expérience du droit que connaît Kant est en réalité dominée par une perception
de la faute dans laquelle l’objectivité de la « faute » conduit très naturellement les juges à
1
J. HABERMAS, Droit et démocratie, Gallimard, Paris, p.

« présumer » l’intention ; ce qui explique par exemple qu’à l’époque les « fous » soient
condamnés à l’égal des « normaux », parce que la folie est présumée résulter d’un abandon
volontaire aux « passions ». L’histoire ultérieure du droit se caractérisera par une
problématisation plus complexe des intentions. Que cela soit au travers par exemple de la
prise en compte des circonstances atténuantes (intégrées en général dans les corpus juridiques
durant la première moitié du 19e siècle) ou au travers des divers discours produits par les
sciences humaines à propos de l’autonomie de la volonté et, en particulier, le discours psycho-
pathologique. Ces dernières remarques invitent d’ailleurs à une reconsidération des positions
kantiennes qui se situent très certainement en-deçà des pratiques juridiques effectives. Le
droit, loin de ne s’occuper que de la conformité externe des actions au devoir, comme le
suggère Kant, s’emploie aussi très certainement à percer les intentions des acteurs. Bref, la
question de la surcharge du droit par la morale mérite sans doute quelques nuances et
problématisations.
Je souhaiterais situer principalement mon propos sur les interférences entre droit et morale au
niveau des formes d’interprétation de l’action. Mais avant cela, je proposerai une brève
remarque sur l’autre niveau, celui des références normatives par rapport auquel il me paraît
nécessaire de nuancer le diagnostic d’une surcharge morale croissante du droit.
(1) Là où le droit dit la morale.
Lorsque nous envisageons les actuelles interférences du droit et de la morale, nous avons
généralement en vue le processus par lequel les magistrats se trouvent de plus en plus souvent
appelés à se prononcer sur des questions qui paraissaient auparavant relever du seul domaine
de l’éthique ou de la morale. Sans minimiser cette nouvelle tendance, il faut sans doute
insister sur ses liens avec l’émergence de sociétés fondées sur un pluralisme moral bien plus
accusé qu’il ne l’était auparavant, un pluralisme dans lequel bon nombre d’analystes ont cru
pouvoir diagnostiquer une « perte de repères », voire une « perte de sens ». sans doute le
partage entre droit et éthique n’était-il auparavant rendu possible que parce que les choix
moraux qui constituaient l’arrière-plan des normes juridiques faisaient l’objet d’un relatif
consensus social, consensus sans doute illusoire mais qu’à tout le moins le droit n’était pas
appelé à interroger. Il serait en effet particulièrement trompeur de croire que les normes
juridiques ne possèdent pas d’arrière-plan moral. Sans doute n’est-ce pas vrai de l’ensemble
des normes, et notamment des normes techniques qui ne cessent aujourd’hui de se multiplier,
mais il faut rappeler ici à quel point le droit pénal par exemple supporte une telle charge
morale. Par ailleurs, on a de bonnes raisons de penser que nombre de mouvements sociaux
contemporains (féminisme, homosexualité…) ou de mouvements d’opinion liés à des
questions plus ponctuelles (euthanasie ou avortement par exemple), témoins du
développement du pluralisme, mettent simplement en évidence le fait que le libéralisme
politique, tel qu’il est aujourd’hui institué, est loin de demeurer neutre par rapport aux choix
de vie de chacun, comme il en professe pourtant la revendication. Autrement dit, le
libéralisme se trouve pris entre des principes constitutifs formels (illustrés par les droits de
l’homme) qui s’appuient sur la constitution d’une sphère éthique relevant de l’autonomie de
chacun (à la réserve près que celle-ci n’empiète pas sur celle d’autrui) et des normes
juridiques dont le contenu ne cesse de se révéler bien plus substantiel qu’il n’y paraît. Il n’est
dès lors pas étonnant de voir surgir, à l’intérieur même du droit, nombre de conflits
d’interprétation dont l’enjeu est en fait l’articulation de ces deux niveaux de normativités.
Autrement dit, nombre de litiges juridiques dont l’objet est manifestement éthique
apparaîtraient rapidement, à un examen un tant soit peu approfondi, comme le résultat

d’attentes de conformité du droit positif à des principes juridiques ouvertement revendiqués.
A cela s’ajoute par ailleurs un retour global de l’éthique
2
qui fait porter sur le droit, souvent
aidées en cela par des pressions médiatiques, des attentes qui étaient inscrites à l’arrière-plan
de normes qui n’étaient tout simplement pas activées dans ces cas. C’est ce qu’illustrent par
exemple les procès dont sont l’objet certains hommes politiques pour des faits s’apparentant
de près ou de loin à de la corruption. Il peut paraître là que le droit est appelé à remoraliser le
politique, mais somme toute, si l’on regarde l’objet de ces procès souvent très médiatisés, ce
n’est là que l’activation d’une fonction traditionnelle du droit.
Toutefois, au-delà de ces questions, j’inviterais volontiers à poser la question des nouvelles
relations entre droit et morale au travers des évolutions du concept qui me semble être
précisément commun aux deux domaines, celui de responsabilité. Concept constitutif à la fois
de la morale et du droit et dont le processus de subjectivisation est précisément, à suivre M.
Villey, à l’origine du droit moderne. Il faut en effet rappeler ici que l’hypothèse de M. Villey
à propos de cette origine consiste à montrer (pour le regretter mais tel n’est pas l’objet de
notre interrogation) à quel point le droit moderne est lié à un processus de moralisation au
travers de ce que j’ai appelé ailleurs la sémantique de la responsabilité
3
, c’est-à-dire le
vocabulaire –je le répète- moral, de l’intention, de la volonté, de la faute, de la culpabilité,...
En portant notre attention sur cette hypothèse, nous serions rapidement conduits à observer
que, somme toute, la surcharge morale du droit est un phénomène bien ancien puisqu’il
remonte, à suivre toujours M. Villey, à des auteurs comme Jean Duns Scot ou Guillaume
d’Occam. Tournant radical s’il en est puisque, pour Villey, avec la modernité, le droit pénal
devint « l’auxiliaire de la règle de conduite, la sanction de règles de morale installées au
sommet du droit », alors que « le droit civil a été refondu comme un prolongement de la
morale »
4
. De telles remarques qu’il faut, à mon sens, mettre en balance avec l’hypothèse de
la disjonction héritée de Kant, invitent évidemment à la prudence quant à l’affirmation d’une
surcharge éthique qui serait portée aujourd’hui par le droit.
En prenant la question des relations entre droit et morale sous l’angle de la responsabilité, je
souhaiterais soulever brièvement quatre questions : celle tout d’abord du développement du
modèle de la responsabilité sans faute et donc du retour d’une conception objectiviste de la
responsabilité et, dans la continuité de cette hypothèse, celle d’un déplacement des formes
d’évaluation de l’action donnant davantage d’importance à ce que j’appellerai les
modalisations actualisantes de l’action ; celle ensuite des implications qu’a sur l’interprétation
responsabilisante de l’action le recours de plus en plus fréquent aux dispositifs thérapeutiques
comme complément des décisions judiciaires ; celle enfin de l’extension de l’usage de la
responsabilité pour justifier une conditionnalisation accrue des droits, en particulier des droits
sociaux. Dans chacun de ces cas où, de fait, se recomposent les relations entre droit et morale,
je chercherai brièvement à montrer qu’il ne faut en tout cas pas conclure trop hâtivement à des
incursions de la morale au sein d’un droit qui en aurait été auparavant bien plus exempt. Tout
au contraire, il s’agit là plutôt de nouveaux infléchissements dont l’interprétation mérite d’être
nuancée et qui, d’ailleurs, dans certains cas (en particulier dans le quatrième point), voient les
pratiques judiciaires jouer plutôt le jeu d’une préservation de la sphère du droit d’incursions
moralisatrices excessives.
2
J.L. GENARD, « Le retour de l’éthique », dans G. GIROUX (éd), La pratique sociale de l’éthique, Bellarmin,
Québec, 19
3
J.L. GENARD, La grammaire de la responsabilité, « Humanités », Cerf, Paris, 1999.
4
M. VILLEY, « Esquisse historique sur le mot « responsable » », dans Archives de philosophie du droit, n° 22,
1977, p. 55

(2) L’objectivation de la responsabilité et la sollicitude à l’égard des victimes.
Qu’en est-il donc aujourd’hui de la tendance à la subjectivisation de la responsabilité qui
serait le signe d’une moralisation du droit moderne ?
En prenant les choses à grands traits, s’il est une tendance qui, sans doute, caractérise
l’évolution du droit de la responsabilité, c’est ce qu’on pourrait appeler le retour d’une
responsabilité objective, illustrée par l’extension du recours au principe de la responsabilité
sans faute
5
. C’est-à-dire d’un usage de la responsabilité où celle-ci se trouve reconnue
indépendamment de toute intention volontaire de provoquer les conséquences dommageables
qui ont entraîné le litige.
Si on suit les interprétations que Villey donne du processus de subjectivisation du droit
moderne, auquel il reproche précisément d’avoir mêlé droit et morale au travers de l’usage de
la sémantique de l’intention, de la volonté,… on pourrait être tenté de voir dans ce processus
une distanciation entre droit et morale. Cette interprétation ne me semble toutefois pas
extrêmement convaincante. En effet, ce que l’on entend par responsabilité peut en réalité
recouvrir plusieurs dimensions
6
. Ainsi peut-on distinguer à la fois une responsabilité
subjective liée à l’intention d’une responsabilité objective liée essentiellement à la
considération des conséquences d’un acte commis par ailleurs, le cas échéant, sans aucune
intention malveillante. Ainsi, la responsabilité peut-elle être considérée sous l’angle de
l’auteur de l’acte aux conséquences litigieuses ou sous celui de la victime de ses
conséquences. Bref, le droit peut centrer ses pratiques prioritairement sur la désignation de
coupables ou sur la nécessaire sollicitude à l’égard des victimes. Ces distinctions sont
d’ailleurs au cœur de l’opposition que l’on fait traditionnellement entre droits pénal et civil, le
droit pénal s’employant essentiellement à déterminer et punir un coupable, en cherchant à
préciser le degré de responsabilité intentionnelle de son acte ; alors que le droit civil s’emploie
au contraire à organiser la juste réparation des conséquences de l’acte litigieux. Une juste
réparation qui, dans le droit civil classique, demeurait essentiellement tributaire de décisions
pénales attestant d’une responsabilité intentionnelle. Et c’est précisément ce lien que
problématise la notion de responsabilité sans faute.
Est-ce à dire pour autant, comme le suggérerait une lecture de l’évolution du droit s’inscrivant
dans la ligne des travaux de M. Villey, que nous assistons à ce niveau à un recul du processus
de moralisation du droit caractéristique de la modernité ?
Si de nombreux indices plaident aujourd’hui en faveur de l’hypothèse d’une avancée d’un
droit qui serait davantage soucieux de juste réparation et de sollicitude à l’égard des victimes
au prix, éventuellement, d’un glissement de l’acception de la responsabilité vers le modèle de
la responsabilité objective dont la reconnaissance juridique autorise la réparation, il ne
faudrait pas, me semble-t-il, en tirer trop rapidement de telles conclusions. Dans ce cas, il me
semble en effet que ce qui serait en cause serait plus de l’ordre d’un nouvel infléchissement
moral du droit. Là où, classiquement, prévalait l’impératif moral de punition du coupable,
semble s’imposer davantage (sans que cela exclue bien entendu le premier infléchissement)
5
Pour une analyse détaillée de cette tendance, du moins à partir de l’exemple français, voir L.ENGEL, La
responsabilité en crise, Questions de société, Hachette, Paris, 1995.
6
Pour une analyse historique de l’émergence de ces différentes dimensions, voir J.L.GENARD, La Grammaire
de la responsabilité, op. cit.

l’impératif –également moral- de sollicitude à l’égard des victimes. Bref, le concept de
responsabilité peut connaître plusieurs accentuations. La responsabilité est, par exemple, à la
fois « faculté de commencer » et « obligation de répondre », sans qu’il soit possible de la
définir par l’une à l’exclusion de l’autre. Or, si la punition du coupable semble interpréter
avant tout la responsabilité comme « faculté de commencer », l’extension du modèle de la
responsabilité sans faute, traduisant une sollicitude accrue à l’égard de la victime, fait quant à
elle la part belle à la responsabilité comme obligation de répondre. Bref, plutôt que d’une
responsabilité entendue à la première personne (Je), il s’agit ici d’une responsabilité centrée
sur la deuxième personne (Tu). Nous ne serions donc pas ici face à un retrait du processus de
moralisation du droit, mais plutôt face à un nouvel infléchissement moral pour lequel la
question de la détermination des intentions voit son importance s’atténuer au profit de
l’impératif de réparation des dommages.
Mais ce processus s’accompagne également d’une révision des éléments en fonction desquels
s’opère l’évaluation de l’acte, et, en particulier, des éléments constitutifs de ce que j’ai appelé
la grammaire des modalités.
(3) Vers une évolution des modalisations de l’action.
En suivant le travail des linguistes, on peut rappeler que l’évaluation des responsabilités, et
donc l’évaluation morale d’un acte, s’opère en mettent en œuvre les quatre auxiliaires de
modalités : vouloir, devoir, savoir et pouvoir. En effet, lorsque nous cherchons à déterminer
des responsabilités, nous sommes inévitablement conduits à nous poser des questions comme
« que devait-il faire ? » ; « qu’a-t-il voulu faire ? » ou « voulait-il réellement ce qu’il a
fait ? » ; « savait-il ce qu’il faisait ? » ; « pouvait-il faire autrement ? »… Ces auxiliaires de
modalités peuvent d’ailleurs être spécifiés en distinguant d’une part ceux qui portent sur les
dimensions virtualisantes ou intentionnelles des actes (devoir et vouloir) de ceux qui portent
sur leurs dimensions actualisantes (savoir, pouvoir) et, d’autre part, ceux qui portent sur les
dimensions subjectivantes des actes (vouloir et pouvoir) de ceux qui portent sur leurs
dimensions objectivantes (devoir et savoir).
Dimension
Objectivante
Subjectivante
Virtualisante
Devoir
Vouloir
Actualisante
Savoir
Pouvoir
Si nous observons à ce niveau l’évolution du droit, nous pourrions faire l’hypothèse que nous
assistons aujourd’hui, dans l’évaluation juridique des actes litigieux, à un accroissement de
l’importance accordée aux modalisations actualisantes. De nombreux indices laissent en effet,
à l’inverse, penser à l’actuel déclin d’évaluations qui seraient essentiellement basées sur les
modalisations virtualisantes, c’est-à-dire sur le seul niveau intentionnel. Dans de nombreux
procès, en particulier certains procès mettant en scène des détenteurs de responsabilités,
s’imposent de plus en plus des impératifs de prudence qui influent , souvent
rétrospectivement, sur l’évaluation des responsabilités. Certes l’acteur n’a pas voulu ce qui est
arrivé, mais s’imposait à lui une obligation de savoir et de précaution, qui dessine en retour
les contours d’une responsabilité sans faute intentionnelle. « Il aurait dû savoir, parce qu’il
pouvait éviter ou minimiser les risques » : tels sont les impératifs qui voient aujourd’hui leur
importance s’accuser.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%