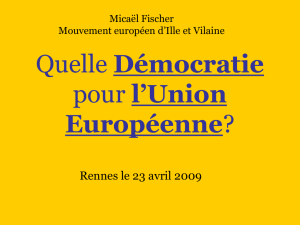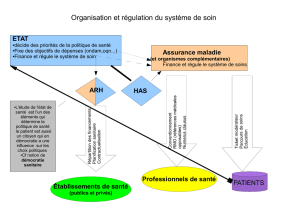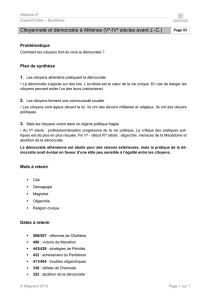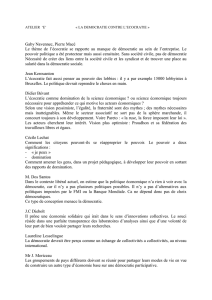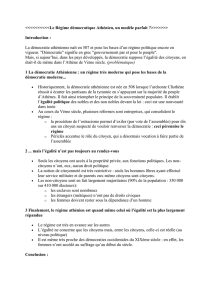La démocratie et le marché

Jean-Paul FITOUSSI
La démocratie et le marché
Jean-Paul FITOUSSI
Professeur des Universités à l’Institut d’Études Politiques de Paris, Président du Conseil Scientifique de l’IEP de
Paris, il est également Président de l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE), Secrétaire
général de l’Association Internationale des Sciences Économiques, et membre du Conseil d’Analyse
Économique (CAE) auprès du Premier Ministre. Expert au Parlement Européen dans le cadre de la Commission
Économique et Monétaire, il est membre de la Commission Économique de la Nation.
Ses principales contributions ont porté sur les théories de l’inflation, du chômage, des économies ouvertes, et sur
le rôle des politiques macroéconomiques.
Il a publié de nombreux articles dans des revues économiques françaises et internationales ainsi que plusieurs
ouvrages en anglais et en français, dont certains ont été traduits en de nombreuses langues.
Parmi ces ouvrages :
- The slump in Europe : Reconstructing Open Macroeconomic Theory, 1988,
- Le débat interdit, 1995,
- Economic growth and capital and labour markets, 1995,
- Rapport sur l’état de l’Union Européenne 2004, la règle et le choix, 2002,
- EDF, le marché et l’Europe, 2003.
Pour ses travaux, Jean-Paul FITOUSSI a reçu le prix de l’Association Française des Sciences Économiques
(AFSE) et le Prix Rossi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques.
Intérêt de l’ouvrage :
Cet ouvrage, en suivant le fil conducteur des liens entre démocratie et marché, a le mérite de procéder à une
vulgarisation des différentes théories économiques pouvant se rattacher à cette réflexion. S’il éclaire sur les
imbrications de la démocratie et du marché et des enjeux que cela représente pour nos sociétés, cet essai ne tente
pas de donner des solutions explicites, mais de proposer des pistes de réflexion en la matière.
FICHE :
Dans cet ouvrage, Jean-Paul FITOUSSI tente de répondre à une question centrale : le marché est-il compatible
avec la démocratie ? L’axe central de son étude est de rechercher le régime politique optimal pour le marché. Il
s’attache à démonter que ce qu’il nomme « la démocratie de marché » peut prendre des formes très diverses et
qu’en conséquence, la démocratie et la politique ne sont pas nécessairement les adversaires de l’efficacité
économique.
L’auteur considère que les discours anti-marché ou anti-démocratie sont purement idéologiques et qu’ils ne
correspondent pas à la réalité. Certains économistes, comme Kenneth ARROW considèrent que le marché n’est
en théorie compatible avec aucun régime politique, et que toute intervention de l’Etat ne peut que réduire
l’efficacité de l’économie. Cette conception est expliquée par l’auteur par la tendance au cloisonnement des
savoirs, c’est-à-dire à l’indépendance des raisonnements politiques et des raisonnements économiques.
L’objet de ce livre est de comprendre pourquoi l’efficacité économique et sociale se situe précisément dans un
compromis entre marché et démocratie et de démontrer qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une
intervention politique peut se révéler indispensable.
Dans une 1e partie, Fitoussi va tenter de rechercher quel est le régime politique optimal pour le marché, ou en
d’autres termes quel est le meilleur régime politique pour favoriser le développement économique.

L’auteur concentre son étude sur la démocratie, qui semble être un bon régime en raison du surcroît de bien-être
qu’elle procure aux agents économiques. Selon lui, le degré de démocratie a des effets sur la croissance
économique. Le développement des libertés politiques serait favorable jusqu’à un certain degré, et au-delà serait
néfaste.
Dans toute société qui se développe, l’auteur distingue un primat de la recherche de l’efficacité économique. A
partir d’un certain enrichissement, dans toute société naît un désir d’accéder à plus de liberté. Mais c’est le
niveau de développement qui permet un certain degré de liberté politique. La démocratie aurait d’autant moins
de chances de persister que le niveau de développement d’un pays est faible.
Jean-Paul Fitoussi cite la thèse de Robert Barro, thèse de la démocratie comme bien de luxe. Cette thèse expose
les implications politiques et sociales de l’efficacité économique. La liberté politique est considérée par Barro
comme un bien de luxe. Même si l’accroissement des libertés politiques peut avoir un effet défavorable sur la
croissance, les pays riches pourraient subir une réduction du taux de progrès économique. La conclusion de
Barro est que « les pays avancés de l’ouest contribueraient davantage au bien-être des nations pauvres en
exportant leur système économique plutôt que leur système politique ».
L’auteur cite ensuite la thèse de l’efficacité économique de la démocratie. A cet égard, il cite Dani Rodrick. La
supériorité de la démocratie en terme de bien-être devrait conduire à de meilleures performances en terme de
croissance.
Dans un 2e chapitre, l’auteur procède à une étude de la complémentarité entre marché et démocratie. Il
soutient à cet égard l’idée de « démocratie de marché » plutôt que d’économie de marché.
Jean-Paul Fitoussi s’interroge sur la primauté de la démocratie ou du marché. Une réforme politique doit-elle
être engagée sur des critères d’efficacité économique ou doit-on se demander si elle permettrait d’accroître
l’adhésion des populations au régime ? Selon lui, la « démocratie de marché » suppose ainsi une hiérarchie entre
système politique et système économique. Il démontre la complémentarité entre les deux en exposant les limites
d’une répartition des revenus exclusive par le marché ou par la démocratie.
La thèse libérale s’appuie sur la théorie pure de l’équilibre général de concurrence parfaite. Cette théorie du
capitalisme a un fort pouvoir de séduction. En effet, les lois de concurrence pure et parfaite permettent de tendre
spontanément vers une situation de plein emploi et d’allocation optimale des ressources (équilibre général
Walrassien et optimum de Pareto). Mais son champ de validité est conditionnel. Les conditions de son
application sont rarement réunies dans la réalité économique. Cela conduit à des situations où le marché n’assure
pas spontanément une équité dans la répartition des richesses. L’équilibre peut impliquer de réduire le bien-être
d’une partie de la population. Ces inégalités ne sont pas la conséquence des dysfonctionnements des marchés,
mais au contraire sont compatibles avec un fonctionnement parfait de ces marchés. La théorie de l’économie de
marché n’offre pas de solution optimale à une telle situation mais indique une voie hors marché (théorie de la
survie).
La démocratie est en perpétuel mouvement et cette instabilité du politique peut à terme remettre en cause
l’existence même de la démocratie. La démocratie ne peut subsister en tant que régime politique que si elle
limite son emprise sur la répartition des richesses.
C’est pour ces raisons qu’il existe une forte complémentarité entre marché et démocratie puisque ces deux
systèmes se confortent mutuellement.
Le 3e chapitre expose la diversité des formes institutionnelles de « la démocratie de marché ». Il n’existerait
donc pas de modèle démocratique universel.
Pour faire face aux dysfonctionnements du marché, il existe une multiplicité de solutions et dans la pratique
chaque pays met en œuvre celle qui correspond le mieux à sa culture. La « démocratie de marché » désigne ainsi
un régime où le système économique obéit à une détermination politique.
Le marché ne fournissant qu’une équité incomplète, la démocratie se doit d’agir en matière d’équité pour rendre
le système acceptable. Cette intervention se fait par le biais d’une politique sociale.
Les différences de performance économiques entre pays ont fréquemment conduit à ériger en modèles certaines
expériences nationales. Mais si certains éléments de politique économique peuvent se révéler positifs dans un
pays pour une période donnée, leur importation dans un autre pays peut ne pas produire les effets escomptés.

D’après des études empiriques menées sur le sujet, il semble que les institutions n’ont pas un rôle essentiel sur
les résultats économiques, mais en revanche leur cohérence joue un rôle important.
En conséquence, les institutions les plus favorables au développement seraient celles qui permettent un
fonctionnement libre des marchés.
Enfin, dans son dernier chapitre, FITOUSSI examine les relations entre démocratie et globalisation. En effet,
l’ouverture des économies à l’échelle mondiale exige une conduite active des politiques économiques par les
gouvernements.
Aujourd’hui, l’autonomie de l’économique et les contraintes qu’il impose à la décision politique réduisent le
champ de « l’assurance collective » que représente la démocratie. Elle accroît la part du marché et réduit celle de
la démocratie. Ce changement ne provient pas d’une décision politique mais d’une contrainte extérieure qui
s’impose à la démocratie.
Mais la légitimation de la croissance des inégalités entre les pays et au sein de chaque pays par la mondialisation
dessert la démocratie et la mondialisation elle-même. Les difficultés liées au présent mouvement de globalisation
viennent de la conception selon laquelle l’extension de la sphère du marché impliquerait le retrait de l’Etat (thèse
de la substituabilité entre marché et démocratie).
Mais la compétitivité globale des pays ne semble pas lié au poids de l’Etat, ni à celui du système de protection
sociale. En conséquence, l’efficacité économique n’est pas plus élevée là où l’Etat est minimal.
L’auteur conclut en soulignant le fait que la mondialisation ne fait pas bon ménage avec la démocratie en tant
que principe transcendantal d’organisation des sociétés. Elle modifie les systèmes de redistribution (systèmes
d’équité) sans que cela ait fait l’objet d’un choix explicite.
Pourtant, rien dans l’évolution de nos sociétés ne valide la croyance selon laquelle la recherche de cohésion
sociale serait un obstacle à l’efficacité économique. Ce n’est donc pas l’ouverture des pays aux échanges
internationaux qu’il s’agit de remettre en cause, mais un discours rhétorique de légitimation d’un capitalisme
dominateur qui considère la démocratie et le politique comme des obstacles au développement (discours qui a
pénétré tous les esprits).
1
/
3
100%