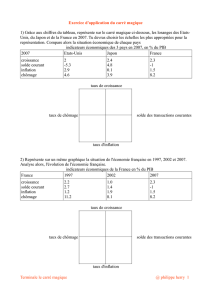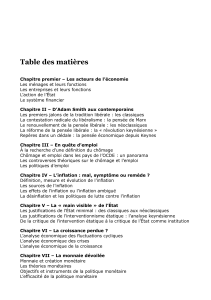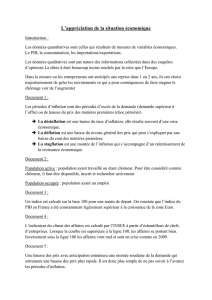3 - Les explications non économiques du sous - E

Chapitre 1 – L’Inflation et le Chômage
Il existe un lien étroit entre l’inflation et le Chômage – En effet l’économiste
Philips a actualisé en 1958 une étude statistique sur le sujet. Dans cette étude, ce
n’est pas le taux d’inflation qui apparaît mais le taux de salaire. On considère
cependant que la liaison être ces deux variables est suffisamment bonne pour
que l’on puisse remplacer l’une par l’autre. Ce chapitre établit une analyse éco
de ces deux notions très valabres.
Section 1 = L’inflation
L’inflation fait partie de notre univers quotidien. Ses causes sont diverses et son
ampleur variable selon les pays et les époques. Mais, dans tous les cas, une
inflation trop élavée détruit la confiance dans la monnaie, affaiblit la
compétitivité du + extérieur, accentue les inégalités sociales et encourage les
comportements spéculatifs. Dans les situations extrêmes d’hyper inflation, c’est
le fondement même de l’organisation des échanges qui est remis en cause. Aussi
l’inflation doit-elle être combattue. Maîtriser l’inflation fait partie des
responsabilités fondamentales de tout gouvernement.
1 – Définitions
1.1. L’inflation
L’inflation est la hausse ,durable de l’ensemble des prix. On ne doit pas parler
d’inflation quand le prix d’un seul bien ou d’un groupe de biens augmente. Il
s’agit là d’une modification de prix relatif, mais pas nécessairement d’une
augmentation générale des prix. Par ailleurs l’inflation s’inscrit dans le temps :
c’est un + dynamique. Expliquer l’inflation ; c’est explication pourquoi la
hausse du niveau général des prix se prolonge et non pas seulement pourquoi il
existe une hausse ponctuelle du niveau + des prix.
1.2. La déflation
Il y’a déflation dans un pays lorsque, exprimée en termes monétaires, la
demande globale de B & S est inférieure à l’offre de ceux-ci. La manifestation
concrète en est une baisse globale des prix et surtout un baisse de la x° et de
l’emploi.
(cette insuffisance de la demande par rapport à l’offre peut avoir plusieurs
origines : - baisse des dépenses de consommation privée ;
- diminution des dépenses d’investissement des entreprises,
- baisse des dépenses publiques,

2
- fléchissement de la demande d’exportation ;
- gonflement des stocks,
- surproduction, etc...
On parle aussi de déflation pour désigner un pol.+ volontaire des autorités d’un
pays pour lutter contre une inflation très forte. Si l’inflation est modérée, les
moyens ordinaire de lutte contre l’inflation, que nous verrons plus loin, peuvent
résoudre le problème. Par contre, si l’inflation est très forte, une véritable
assainissement monétaire est nécessaire ; il consiste en la brusque suppression
d’une partie importante de la monnaie en circulation.
1.3. La stagflation
Ce néologisme – formé des mots stagnation et inflation désigne une situation
dans laquelle se rencontrent à la fois certains traits de l’inflation (exemple :
hausse des prix) et certaines caractéristiques de la déflation (exemple : le sous –
emploi) Ce + est assez fréquent à notre époque. En effet, beaucoup de pas
connaissent a actuellement à la fois une forte hausse des prix et un taux de
chômage également élevé.
1.2. La désinflation pour verso
La désinflation désigne une diminution du taux de croissance du niveau général
de prix (taux d’inflation). Il faut bien faire la distinction entre déflation qui le
contraire de l’inflation et la désinflation qui désigne une baisse du taux
d’inflation.
II Les indices de mesure de l’inflation
Pour mesure l’inflation, il faut construire en indice synthétique des prix. mesurer
le prix d’un bien particulier ne pose pas de problème ; il suffit de l’observer sur
un Xe répéter cette observation à intervalles de temps réguliers permet d’obtenir
une série temporelle du prix, par exemple une douzaine d’œuf valait 1150 en
juin 2002, 1200 en juin 2004 et 1250 en juin 2006. On appelle indice
élémentaire (ou indice partiel, le rapport multiplié par 100 de deux + d’un même
bien mesurés à deux moment différents. Au numérateur figure le prix actuel ; au
dénominateur figure le prix dans la situation de base ou de référence.
Dans notre exemple, la base est en juin 2002 (indice juin 2002 – 100)
L’indice des prix des + œufs est, en juin 2004 :
+++++
L’indice du prix des œufs est, en juin 2006.

3
++++
Pour mesurer l’évolution des prix d’un ensemble de biens, il faut combiner leur
indice élémentaire plans indice synthétique. Un indice synthétique est la
moyenne des indices élémentaires pondérés par la part de chaque post dans la
dépense totale de la période de référence (ou cœfficient budgétaire)
Exemple de construction d’un indice synthétique
Supposons que la consommation soit réduite à 3 produits pour, œufs et beurre.
La période de base sera l’année 2002, la période courante l’année 2006. Le
calcul de l’indice synthétique s’effectue en 3 étapes.
1°) le choix d’un « panier de biens ». Soit ½ pain, 1 dizaine d’œufs et 250
groupe de beurre.
2°) Calcul des coefficients budgétaires :
produit
quantité
Prix 2002
Coût de panier
Coef.budgétaire
Pain
Œufs
beurre
0,5
1dizaine
0,25 Kg
520
1150
2320
0,6 * 520 = 260
1* 1150 = 1150
0,25* 2320 = 580
260 :1990 = 13,1%
1150 :1990 = 57,8%
580 :1990 = 29,1%
Total 1990
Total 100%
3 – Calcul de l’indice synthétique
produit
Prix
2006
Coéf.
budgétaire
Indice élémentaire
Multiplication des 2
dernières colonnes
Pain
Œufs
beurre
590
1250
2480
13,1%
57,8%
29,1%
(590 : 520) *100=113,5
(1250/1150)*100=108,7
(2480/2320)*100=106,9
0,131*113,5 = 14,9
0,578*108,5 = 62,8
0,291*106,9 = 31,1
Indice synthétique
Total = 108,8
On dira que les prix ont augmentés de 8,8% entre 2002 et 2006.
Cette méthode de construction aboutit à un indice de type « Laspeyres » dans
lequel les pondération (coef budgétaires) sont fixes durant toute la durée de vie
de l indice et calculées dans la période de base.
Exemple Laspeyres (prix) de l’année t, base 100 l’année 0 note

4
++++++++++++++
P1t – prix du produit i l’année t ;
Quantité = quantité du produit i de l’année 0
III – Caractéristique de l’inflation
3.1. Mathématique de l’inflation
L’inflation est un + cumulatif. Quand le taux d’inflation est égal à P chaque
année, l’évolution de l’indice des prix à partir de Po = 100 est la suivante :
Années Indice de prix
0 Po = 100
1 P1 = 100 (1+P)
2 P2 = P1 (1+P) – Po (1+P) 2
3 P3 = P2 (1+P) + Po (1+P)
. .
. .
. .
N pn = pn-1 (1+P) = Po (1+P) n
Exemple : De faible différences dans les taux d’inflation entre les pays
entraînent rapidement de très fortes disparités dans les niveaux des prix.
Si un pays A a 3% d’inflation annuelle et un pays B 5% d’inflation annuelle, au
bout de 10 ans on aura
P10A = Po (1+0,03) 10 = 134,4
P10B = Po (1+ 0,05)10 = 164,9
Dans le cas du pays A, la hausse des prix a été de 34,4% alors que dans le
pays B elle a été de 62,9% en 10 ans.
Les produits du pays B ne peuvent plus être compétitifs par rapport à ceux du
pays A.
3.2. Les différents type d’inflation
De la même façon que le mouvement d’une automobile est caractérisé par
sa vitesse et par son accélération (ou sa décélération) l’inflation doit être
caractérisée par son taux (c’est la vitesse de hausse des prix) et par la variation
de son taux (c’est l’accélération ou la ralentissement de la hausse des prix.)

5
Dans les situation de faible inflation, les prix sont quasiment stables. Leur
taux de croissance, approximativement contant, n’excède pas 2 a 2,5% par an.
Parler de quasi-stabilité des prix est justifié dans la mesure où un taux de 2%
n’entraîne un doublement du niveau des prix qu’au bout de 36 ans Exemple les
P 4 entre 1960 et 1965 (taux d’inflation moyen = 1,3%) les pays Bas entre 1986
et 1990 taux d’inflation moyen = 1,2%
L’inflation rampante – elle se caractérise d’abord par des taux plus élevés
(entre 2,5% et 5,6%). Ces taux, encore modérés, ne doivent abuser : il signifient
que l’inflation est au cœur du système éco. Et qu’il ne sera pas aisé de s’en
débarrasser. Ce type d’inflation se caractérise également par une tendance à
l’accélération, rendant nécessaire une pol.+ anti-inflationniste.
Quand le taux d’inflation varie autour de sa moyenne on parlera
d’inflation équilibrée. Dans ce cas, les agents éco. Ont une perception claire de
l’inflation et l’intègrent dans leurs calculs : les entreprise y adaptent leur pol+
des prix, les salariés, leurs revendication salariales ; l’état, ses dépense et sa pol+
fixale. Ces situation sont en pratique associées à des situations d’inflation faible
ou modérée. Les EU en 1960 et 195 (1,7% taux de plus élevé) et 1,1, le taux le +
faible ; En France en 1986 et 1990 taux le faible 2,7% et le plus élevé 3,6%.
Quand le taux d’inflation dépasse 5 ou 6%, on peut dire que l’on entre
dans une période d’inflation soutenue. Cette situation se caractérise par
d’importants risques de dérapage vers des taux de en + élevés pour lesquels une
inflation à 2chiffres (plus de 10%) constitue un seuil psychologique important.
Lorsque l’inflation n’est maîtrisable et que son taux croît très rapidement
ou parfois de la façon vertigineuse, ou parle d’hyperinflation exemple : en
Allemagne en 1923, l’Argentine ou le Brésil dans les années 1990.
Le taux d’inflation peut aussi être élevé et très instable. Cette situation
correspond essentiellement à des cas de chocs inflationnistes, dont les chocs
pétrolier de 1973 et 1979 constituent, des exemples caractéristique. Cette
situation se trouve également dans le cas d’hyperinflation. Exemple = l’inflation
est de 49% en 1972 au Japon ; elle passe en 23,1% en 1974 en revient à 5,2% en
1976 ;
Le taux d’inflation peut aussi entre des variations régulières et
prolongées : ou bien une baisse régulière dans le cas d’une inflation rampante ;
ou bien baisse régulière et ou parlera alors de désinflation. Exemple le
d’inflation en France décroît régulièrement de 13,5% en 1970 à 2,7% en 1986.
IV – Les causes de l’inflation
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%