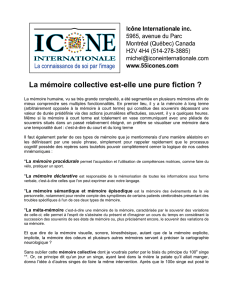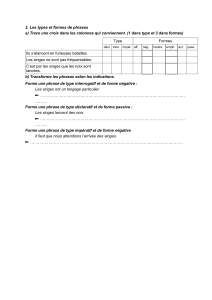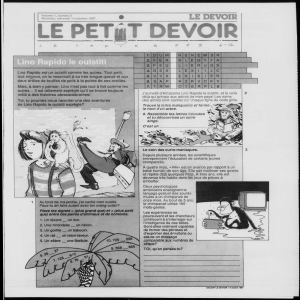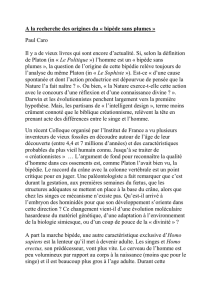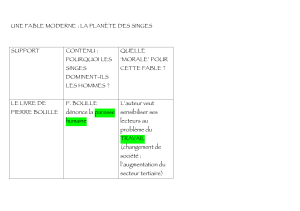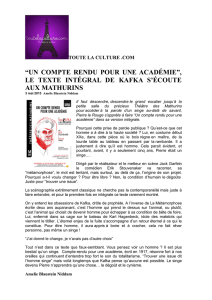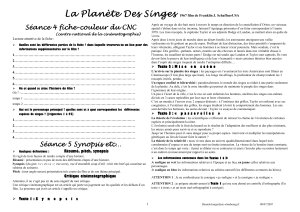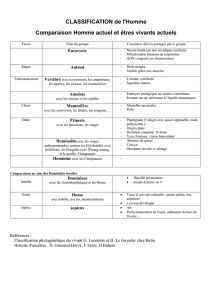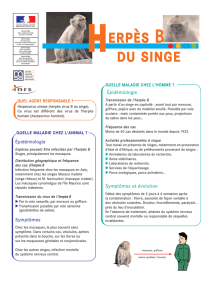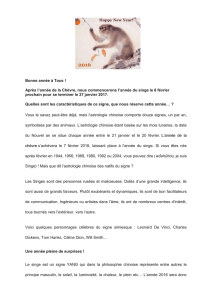Singerie » par Susan Surette

Musée Bruck de Cowansville : Nomades, joueurs et voyeurs
15 juin au 14 juillet 2013
SINGERIE : n. f. Se dit aussi d'une décoration murale, d'une peinture, d'une tapisserie dont les
singes sont les principales figures (dictionnaire de l’Académie française)
Les singes ont souvent servi d’interprètes entre les humains sinon entre les dieux et la
population, assumant parfois l’identité, ou du moins les caractéristiques, à la fois des divinités
et des hommes. Ils ont personnifié aussi bien le maître de sagesse, le fou malicieux, le brave
compagnon, le joyeux bouffon et le libertin que de petites et ridicules créatures. Pendant des
siècles, les sculptures et les tableaux réalisés en Asie, sur le subcontinent indien, en Égypte, en
Amérique du Sud et en Europe ont témoigné de la nature complexe et changeante des rapports
entre l’homme et le singe, toutes des œuvres fondées sur la reconnaissance de similitudes entre
les deux espèces, ce que corrobore aujourd’hui le séquençage de l’ADN.
C’est en fonction de similarités comportementales et physiologiques établies entre l’homme et
le singe qu’on a utilisé le singe dans l’art occidental pour représenter la déchéance de
l’humanité, mettre en garde contre les sept péchés capitaux, satiriser ceux qui détiennent le
pouvoir, et plus récemment, pour se moquer des valeurs de la classe moyenne dans la société.
Quand les singes se retrouvent au centre de la composition d’une oeuvre, ils nous mettent au
défi d’établir un lien avec eux, que ce soit sur le plan émotif ou social, ils éveillent en nous de
l’empathie, une réflexion intérieure ou carrément le dédain. Au cours du dernier siècle, avec le
singe-outil indispensable de la recherche médicale et scientifique, la prolifération des zoos
comme attractions touristiques, l’émergence d’études sur la faune et la possibilité accrue de
voyager, notre relation avec le singe est devenue trouble du fait de jugements moraux
conflictuels.
L’intérêt de France Jodoin pour les singes découle de deux expériences clés. Il y a eu d’abord
la maladie de son père, un homme qui a toujours adoré cet animal et qui, dans les derniers mois
de sa vie, a offert un singe en peluche à quelques-uns de ses enfants. Pour France, ce jouet,
perché sur le déambulateur de son père, facilitait la communication avec l’être souffrant qu’elle
aimait – le singe est devenu l’interprète, celui capable de combler le vide entre deux
générations. Le deuxième événement marquant a eu lieu en Inde, où Jodoin a photographié des
macaques dans leur habitat naturel. En les observant, elle s’est rendu compte qu’à leur façon de
se comporter et d’exprimer leur personnalité, ils contribuaient à la complexité de leur vie
sociale; ils jouaient en effet toutes sortes de rôles aussi bien entre eux que parmi la population,
où ils sont libres de circuler. Comme chacun de nous, chacun des singes que peint Jodoin est un
être à part entière tout comme il fait partie d’une communauté.
La technique picturale de Jodoin incite le spectateur à jeter un regard fugace sur des êtres
mystérieux. Elle met en lumière aussi ce qu’on peut appeler le transitoire dans l’acte de
peindre, ce moment décisif où l’artiste fusionne médium, émotions et idées. La coexistence de
masses impressionnistes et de fines lignes expressives délimite la forme des sujets et les anime.
Jodoin est une peintre gestuelle. Dans ses tableaux, les singes semblent bien vivants. Ce sont
des animaux dynamiques, non pas des êtres qui attendent passivement qu’on fasse leur portrait;
ils tout occupés à forger leur vie, à jauger et juger leur monde et le nôtre.
Susan Surette, MA, professeure à temps partiel, département d’histoire de l’art, Université
Concordia
1
/
1
100%