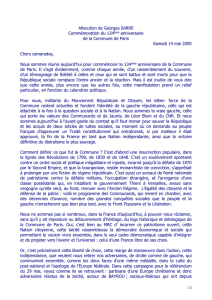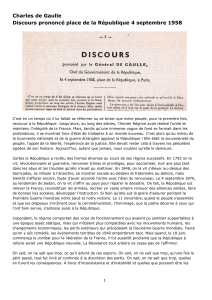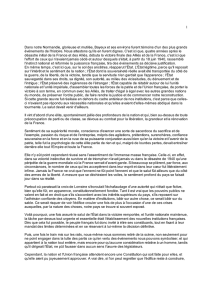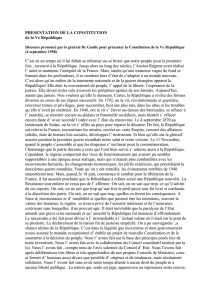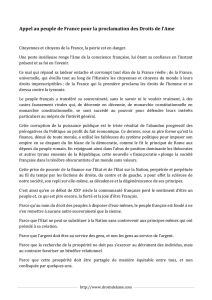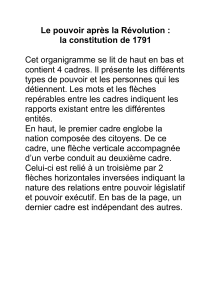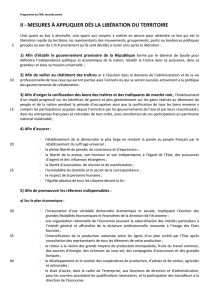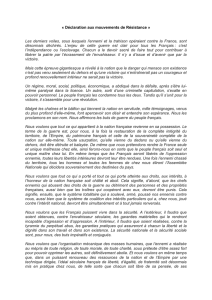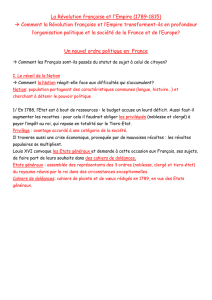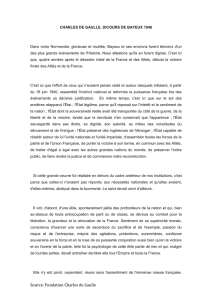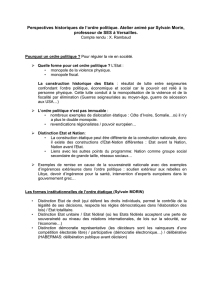Conclusion

1
Summary new book on the Batavian Revolution
La nation en discorde et l’aspiration à la paix
Plusieurs décennies durant, alors qu’éclatent en Occident les révolutions du 18e siècle et que
se construisent les nations modernes, Amérique, Hollande et France ont communiqué plus
intensément encore que sous les Lumières. C’est ce qui découle d’une étude pointilliste des
bouleversements subis par les trois pays pendant ces années tumultueuses. Bouleversements
divers et variés selon leur intensité, leur impact, les oppositions ou obstacles qu’ils
rencontrent et les mesures mises en œuvre, mais dont l’objectif apparaît sensiblement
similaire : reconstruire le gouvernement sur des bases plus équitables et plus rationnelles et,
partant, reconstituer des sociétés sur des fondements mieux appropriés avec l’esprit des
Lumières et des droits naturels de l’homme.
Après une période de flottement qui va dans le sens d’un fédéralisme ou d’une
décentralisation, l’Etat tend peu à peu à se raffermir au détriment des libertés locales et
provinciales, de sorte à fonctionner plus efficacement
1
. Devient alors manifeste la déception
vécue par les citoyens desdits Etats, qui ne se retrouvent plus dans ce qu’ils voient comme une
violation de leurs libertés, sauf à être eux-mêmes directement impliqués dans l’entreprise de
centralisation et d’uniformisation. Désordres ; séditions ; pétitions ; résistances en témoignent
éloquemment. L’étatisation devient un ferment de dissolution du lien social, alors qu’elle
visait justement à le resserrer. Car tout partait d’un bon sentiment et sous couvert d’utilité
publique ; de bien général ; d’humanité, de liberté et d’égalité. L’uniformisation se donne
pour conforme à la démocratie représentative et aux droits de l’homme, tout comme la
centralisation le serait à l’efficacité et à la raison. Ces mesures centripètes impliquent un
peuple homogène ou pour le moins uniforme. Et si le peuple est un, il est soumis aux mêmes
lois et doté des mêmes droits et il constitue ce que les hommes de l’époque nomment une
nation. Ou pour reprendre les termes du Federalist : « le gouvernement est institué de sorte …
à favoriser l’intérêt du peuple …si bien que dans tous les domaines il forme une nation . »: à
savoir « un peuple descendant des mêmes ancêtres ; parlant la même langue ; professant la
même religion ; attaché aux mêmes principes de gouvernement ; très similaire dans ses
manières et ses coutumes, et qui, ayant joint ses forces et ses armes, s’est battu côte à côte
pour la liberté générale et l’indépendance »
2
. Or, cette nation n’est pas toujours perceptible en
tant que telle et les législateurs américains, néerlandais ou français n’ont de cesse de vouloir
la former ; l’éclairer sur les changements en cours; lui conférer des traits concrets et lui
assigner un caractère républicain.
L’étatisation va donc de pair avec une volonté de « nationalisation » des citoyens dans
une perspective qui se veut démocratique, et même si les moyens pour parvenir à ces fins font
parfois bien peu de cas des libertés individuelles. Dans les fédérations, il va de soi que
l’entreprise est freinée par les forces centrifuges des provinces, des villes, des corporations ou
des sectes religieuses. L’Etat a beau légiférer, provinces ou Etats ne suivent pas à la lettre les
injonctions venues d’en haut. Aux Pays-Bas, notamment, villes et provinces se refusent
discrètement mais opiniâtrement à mettre en oeuvre les lois édictées à La Haye. Durant la
révolution, le corporatisme ne sera jamais aboli
3
; l’Eglise officielle et ses structures
caritatives jamais entièrement démantelées ; la justice jamais entièrement réformée et
1
Les désordres populaires ; les initiatives des sociétés révolutionnaires et les dangers extérieurs accentuent cette
ambition. La centralisation et l’étatisation sont aussi une voie vers le retour à l’ordre.
2
Le texte, plutôt étonnant dans un pays doté de la devise E Pluribus Unum, est de Jay. Federalist, no.2., p.5-6.
Il aurait tout aussi bien pu être écrit en France.
3
Il ne le sera réellement et définitivement qu’en 1818.

2
rationalisée. En Amérique, la codification du droit civil et du droit pénal est vouée à l’échec,
faute d’appui des Etats et des tribunaux. De même est paralysée la « nationalisation » de
l’enseignement primaire, tandis que les lois fédérales de 1798 ne sont pas forcément
appliquées dans tous les Etats. Inversement diverses réformes sont bel et bien acceptées et
introduites, mais progressivement. En vérité, c’est dans ce qui touche à la politique que
l’étatisation révolutionnaire a obtenu les plus grands succès : constitution écrite, démocratie
représentative, déclaration des droits de l’homme ou contrat social, justice humanisée et
équitable, tout cela s’est imposé plus ou moins fortement dans les trois pays ici impliqués et a
modifié partiellement les pratiques des gens ordinaires, en attendant de s’imprégner dans les
mentalités.
Du point de vue culturel, chaque nation a elle aussi connu des avancées diversifiées
mais réelles. Certes, seule la Hollande est parvenue à réformer et à moderniser son système
scolaire primaire et a offert ainsi à tous ses enfants des chances réelles. La France et
l’Amérique ont préféré se concentrer sur les universités et les sociétés ou académies
scientifiques, sans oublier les musées qui seraient autant d’écoles républicaines. La France de
façon centralisatrice ; l’Amérique de façon étatiste, avant que ne soit achevé le grand projet de
capitale politique à Washington. Des manuels n’en ont pas moins été écrits, qui devaient
enseigner aux enfants les beaux principes de leur révolution et « républicaniser » les
générations futures - comme on disait à l’époque. La langue a été épurée ; des manuels de
grammaire et d’orthographe ont été rédigés ; l’idiome courant s’est nationalisé, tandis que se
diffusaient des histoires destinées à remémorer à l’école le récit de l’épopée révolutionnaire.
Une esquisse d’uniformisation nationale s’est ainsi dessinée auprès des élites – en France et
en Amérique – et auprès des enfants – en Hollande.
Nationaliser le peuple dans son ensemble est une tout autre affaire. Les révolutions
débouchent en effet non sur l’union et la concorde si vivement souhaitées des législateurs,
mais sur la division et la discorde. Difficile alors de voir dans les factions qui se combattent
ou dans les ennemis intérieurs qui menacent la stabilité des nouveaux régimes un ferment de
cohésion sociale. Là, le tout qui s’appelle la nation, est introuvable. L’Amérique a certes eu la
chance de perdre ses loyalistes, qui soit s’exilent au Canada ou en Angleterre, soit se rallient
peu à peu au nouvel ordre républicain
4
. En France et aux Pays-Bas, en revanche, les ennemis
émigrés demeurent aux frontières et oeuvrent pendant longtemps à la chute de leurs
adversaires. La situation est donc plus risquée, d’autant que le continent est en proie à une
guerre qui se poursuivra jusqu’en 1815. Au lieu de la nationalisation espérée, c’est la
dissension qui domine. Mais, à la différence de la France, qui dans sa quête de l’unité situe le
conflit dans le registre de l’ennemi à abattre ou à convertir et dont le légicentrisme a tendance
à plier le collectif à la norme, la République batave, grâce à son héritage et à sa culture de la
dissension
5
, accepte en somme le désaccord et montre une aptitude au compromis. Seule la
période qui va de janvier à novembre 1798 fait dissonance dans le chœur consensuel cher aux
Hollandais. Durant ces quelques mois en effet se succèdent les lois d’exception ; les mesures
répressives contre les adversaires politiques et les arrestations. Que celles-ci ne mènent pas à
la suppression pure et simple de l’adversaire comme il en va en France durant la Terreur, peut
être interprété comme une conséquence de cette culture de la dissension, qui fait que celui qui
n’est pas du même avis n’est pas forcément perçu comme un ennemi, mais comme un
4
Sur la chance de l’Amérique qui n’a pas eu à subir « les contraintes de la naissance » et le « joug général de
l’autorité politique », M. Gauchet, La condition politique, op.cit., p.341 et p.383.
5
En anglais, je dirais « dissenting culture ». Disons que l’acceptation néerlandaise de la dissidence (religieuse,
tout d’abord) – et donc de la dissension - est à la base de sa culture. Aux Pays-Bas, ceux qui pensent
différemment ne sont pas vus comme des « ennemis substantiels » - à la Carl Schmitt – mais comme des gens
qui pensent autrement. Or, durant la révolution, on les a vus devenir pour le moins des « ennemis
occasionnels ».

3
dissident qui pense tout simplement autrement. A la différence de l’Amérique, qui
décidément tient compte de la diversité des opinions – E Pluribus Unum – et dont les fêtes et
cérémonies républicaines laissent transparaître sur le mode festif leur pluralité, voire leur
incompatibilité, la République batave a et aura du mal à accepter le retour du refoulé. Car,
c’est bien à un retour du refoulé qu’assistent les patriotes, stupéfaits des tumultes et des
querelles qui freinent leurs travaux. Ils croyaient le désaccord, voire le conflit définitivement
toléré ; les enjeux non incompatibles ; leurs compatriotes soucieux du bien général et pour ce
prêts à jeter du lest sur leurs opinions personnelles
6
. Or, que se passe-t-il ? D’un bout à l’autre
de la république, chacun poursuit sa marotte sans se soucier de celle d’autrui. La révolution ici
aussi a libéré la parole et démontré que les prises de position des acteurs étaient aussi diverses
que le sont les provinces ou les municipalités. Leurs représentants respectifs se donnent
chacun pour les mandataires du peuple, ce qui rend impossible toute tentative de
nationalisation. Seule, la violence d’un coup d’Etat a permis d’imposer une république une et
indivisible. Or, c’était là emprunter un itinéraire proche de celui des Français, que ne
pouvaient accepter tous ceux qui rêvaient de restituer à leur patrie sa respectabilité et par suite
son crédit et sa prospérité. De là le second coup d’Etat de juin 1798, qui dans un premier
temps a tendance à suivre les traces des prédécesseurs et met en place des lois répressives
elles aussi peu compatibles avec la culture de la dissension qui avait fait la gloire de la
république des Provinces-Unies. La concorde ne se rétablira que progressivement quand
divers patriotes véritables entreprennent de réconcilier les amis d’autrefois et les adversaires
d’hier. En 1801, l’emporte définitivement la tentation du compromis, quand Guillaume V
invite ses partisans à se rallier au nouveau régime et à travailler à la sauvegarde de la patrie.
Patriotes, orangistes et fédéralistes oeuvrent à nouveau de concert dans une patrie réconciliée,
mais déçue par une révolution ratée – en ce qu’elle a dévoilé ce qui couvait sous l’écorce
consensuelle et combien étaient fragiles les bases à l’origine de la nation
7
.
Si l’idée politique de nation s’impose définitivement durant les troubles
révolutionnaires, à la fois chez les Américains qui aspirent à former un seul et même peuple ;
chez les Français, avides de substituer au pouvoir monarchique celui de la nation Une et
Indivisible; et chez les Bataves, forts de leurs efforts ancestraux pour croire mieux faire
encore et consolider leur « chère petite patrie », l’Etat a donc eu beaucoup à faire afin de
s’imposer auprès de tous les citoyens. A la fin du 18e siècle et en dépit des tentatives
officielles, la « nationalisation » n’en est encore qu’à ses débuts. Sans doute une plus grande
stabilité dans le flot des événements auraient-elles accéléré l’entreprise, mais les révolutions
ne vont pas seulement de l’avant ; elles subissent des revers ou empruntent des chemins de
traverse. Il n’en reste pas moins que les succès remportés à la longue par l’Amérique et la
France ont accru leur sentiment national. Reprise économique, stabilité constitutionnelle, paix
relative, agrandissement du territoire et isolement bénéfique, tout cela a persuadé bien des
Américains de la supériorité de leur révolution et de leur grandiose destinée, en tant que
nation de l’avenir. Sous le Directoire, les succès remportés par les armées françaises ont
quelque peu voilé les infractions faites aux lois et les querelles intestines. Ils ont donné
naissance au mythe valorisant de la Grande Nation, libératrice des peuples opprimés et
garante de l’universalité des droits
8
. Aux Pays-Bas, la déception due aux dissensions
intestines et aux ingérences françaises n’a certes pas amplifié le sentiment d’appartenir à une
6
Et d’autant plus que le stadhouder, considéré depuis plus longtemps comme motif premier de la discorde,
s’était exilé.
7
Chantal Mouffe dirait qu’ils ont découvert la dimension antagoniste du politique, et ce à leur grand
désappointement. « Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism ? », Social Research, 66, 3, 1999.
8
La politique directoriale pourrait se lire comme une entreprise pour rendre à la France sa respectabilité et sa
gloire: notamment par sa politique de spoliation des chefs-d’œuvre de l’humanité. Voir le discours du directoire
exécutif du 14 brumaire an IV, Le Moniteur, 26, p.386.

4
nation spécifiquement exceptionnelle. Et seul l’enseignement primaire a pu amorcer son
entreprise de « nationalisation », ce qui, il est vrai, promettait à terme une génération de bons
patriotes et de vrais républicains. Pour le reste, la communauté nationale désagrégée ne s’est
sentie liée que par des sentiments négatifs : après 1800, elle s’est repliée sur soi et sur le foyer
domestique ou s’est tournée vers un passé dont elle pouvait se féliciter : le Siècle d’Or
9
. Le
patriotisme alors s’est orienté vers la petite patrie où seraient cultivées les vertus privées, dans
l’attente de la résurrection de la grande. Ce repli sur soi et cette mélancolie ne sont certes pas
l’apanage de tous les peuples déçus par la Révolution : ainsi, sur la rive droite du Rhin, Fichte
adopte dès 1806 un ton illuminé pour chanter la résurgence prochaine du grand peuple
allemand : la Teutsche Nation. A cette date, il est pourtant encore seul à y croire.
10
Si la nationalisation a été pour une grande part un échec et l’étatisation une réussite
certaine, mais limitée - puisqu’elle n’est pas parvenue à subtiliser toutes leurs prérogatives
aux Etats ou aux provinces -, les révolutions ont inventé et pratiqué durant plusieurs années
une culture républicaine et démocratique, qui laissera des traces dans l’imaginaire des
peuples. Que ce soit la participation populaire, perceptible dans les clubs et les sociétés ou
dans les assemblées primaires; que ce soient les élections fréquentes et tumultueuses ; la
presse et l’imprimé politiques ; les fêtes et les cérémonies ; les monuments et les musées ; les
manifestations et les insurrections : l’école de la révolution est un apprentissage à la fois
républicain et démocratique. Mais ces avancées sont-elles semblables d’un bord à l’autre de
l’Atlantique ?
Républicanisme ou constitutionnalisme ?
Alors que se raffermit la grande république américaine, dans les années 1800, c’est un
mouvement inverse qui se produit sur le continent – Suisse excepté, ce qui dit bien dans
quelle estime elle est tenue par les grandes puissances. La France donne le ton en 1804 quand
elle adopte une monarchie héréditaire et confère le titre d’empereur à Napoléon Bonaparte ; la
Hollande suit en 1806 quand, sur les instances du même Napoléon, est proclamé dans une des
plus anciennes républiques modernes le royaume de Hollande. Qu’en 1813, il ne soit
aucunement question de restaurer la république des Provinces-Unies suggère que le système
monarchique avait eu le temps de s’implanter et de séduire les esprits. Le républicanisme
batave était-il définitivement mort et enterré ? Et s’il l’était, quelle pouvait en être la raison ?
L’idée républicaine ne date pas de la révolution, mais la précède. En 1750, le marquis
d’Argenson se plaignait déjà du « républicanisme » qui hantait les esprits et qui discréditait le
« monarchisme »
11
. Dès lors, on a vu Européens et Américains défendre les principes qui en
auraient été à la base : liberté; égalité; vertu civique, amour de la patrie et souci du bien
général ; gouvernement des lois et non des hommes. Les Lumières en vérité étaient toutes
imprégnées d’un républicanisme classique, enrichi par l’apport des philosophes écossais, dont
on a dit l’impact chez des hommes comme Roederer et Sieyès
12
. Contre les abus constatés
9
N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland… Après Waterloo, il en ira autrement. Les Pays-Bas rejettent
en bloc toutes les institutions étrangères et se flattent de tout reconstruire, conformément au « génie national » -
ce qui ne veut pas dire que ne subsistent des emprunts étrangers. Voir M. van der Burg, ouvrage cité.
10
Sur les frustrations vécues dans le présent et le mythe de l’âge d’or à venir, M. Levinger & P.F. Lytle, « Myth
and Mobilisation : the triadic structure of nationalist rhetoric », Nations and Nationalism, 7, 2001, pp. 175-194.
11
R. Monnier, « Républicanisme et Révolution française », French Historical Studies, 26, 1, 2003 et K.M.
Baker, « Transformations of Classical Republicanism in Eighteenth Century France », The Journal of Modern
History, 73, 2001, pp. 32-53. Pour Baker, le langage républicain sous l’Ancien Régime est oppositionnel. Ce
n’est pas un modèle à imiter, mais un diagnostic critique. Cela se peut, mais la création de la république
américaine met fin à cet état de chose. Elle démontre qu’une république moderne est possible.
12
Rodgers, op.cit., p.36 et J. Isaac, « Republicanism vs. Liberalism : A reconsideration», op.cit., p. 359 et
article cité de Kloppenberg.

5
dans leur patrie respective, les acteurs de l’époque se plaisaient à revêtir la toge des Anciens.
Tout cela est désormais bien connu, de même que le discrédit qu’il en résultait pour les
monarchies et leurs cours princières, dont certains membres cultivaient du reste ces valeurs
républicaines ou plaidaient pour une politique méritocratique qui allait dans le même sens
13
.
Les révolutions ont poursuivi dans ce sens. On leur doit la création de nouvelles républiques :
en Amérique ; en France, en Italie, en Allemagne, tandis que la Suisse et la Hollande se
flattaient de moderniser les leurs. Dans les années 1790, il n’est pourtant pas certain que tous
savaient exactement ce qu’ils entendaient par le terme : était-ce une forme de gouvernement
ou un principe de légitimité politique
14
? Et quel rapport entretenait-il avec la démocratie ?
Madison avait réfléchi au problème et en 1787 il formule la distinction de la façon suivante :
dans une démocratie, le peuple s’assemble et exerce lui-même le pouvoir ; dans une
république, le peuple assemblé élit ses représentants qui exercent le pouvoir en son nom.
République devenait synonyme de démocratie représentative. Et les déclarations des Etats
rappelaient les conditions indispensables à la survie d’un gouvernement libre : justice,
modération, tempérance, économie, frugalité, industrie, c’en étaient là les vertus
inséparables
15
. En France, les avis différaient sur les détails, mais en général, la république
était perçue comme ayant un pouvoir collégial nommé ou élu – et par suite amovible; comme
étant garante des libertés civiles ; comme un gouvernement des lois, fondé sur les vertus
civiques et civiles et sur l’amour de la patrie en vue de l’intérêt public. La république des
Provinces-Unies qui connaissait ce régime depuis 1579 partageait pour une grande part cette
perception. Sa république idéale possédait un pouvoir polyarchique ; respectait les libertés ;
stimulait la modération ; la sobriété et la simplicité – toutes des vertus fondamentalement
républicaines, qui figurent du reste dans les premières constitutions américaines. Durant les
années lumières de sa révolution, la République batave invoque régulièrement ces vertus et
cherche à les ressusciter dans le cœur des citoyens. Elles resurgiront également en France à la
suite du 9 Thermidor. L’idée prédominante est bien entendu de créer une démocratie non pas
directe, mais représentative et d’œuvrer parallèlement à former les mœurs et à faire progresser
la civilisation.
Nos trois révolutions ont donc adopté le système républicain, mais l’ont renouvelé à
l’aune des avancées du siècle. En lieu et place d’un monarque ou d’une oligarchie héréditaire,
elles en sont venues à privilégier la représentation ; l’amovibilité et la séparation des pouvoirs
en place ; les collèges ou les comités ; la souveraineté populaire qui trouve à s’exprimer dans
ses assemblées primaires, ses conventions, ses sociétés fraternelles ou durant les élections. Là
où l’Amérique reliait vertu civique et vertus civiles ; participation politique et poursuite du
bonheur privé, les Pays-Bas tentaient de corriger leur républicanisme qui s’était corrompu et
détérioré, mais innovaient en centralisant les pouvoirs et ils n’en négligeaient pas pour autant
les mœurs et la civilité. La France se distancie de ces deux modèles en ce qu’elle a opté en
l’an II pour un républicanisme classique et célébré la seule vertu civique. A peine Robespierre
est-il tombé qu’elle renoue pourtant avec 1788-1789 pour défendre tout à la fois le patriotisme
et le commerce. Elle restitue aux Français leur double identité : de citoyen (domaine public) et
d’individu (domaine privé). Le Directoire poursuivra sur cette voie politique et morale
16
,
certes pas méconnue par les deux autres révolutions.
13
Voir par exemple, G. Wood, The Radicalism of the American Revolution, New York, 1991, pp. 98-103.
14
C’est ce qu’avoue encore en 1807 John Adams. Cité par Rodgers, op.cit., p.37.
15
Ce sont là les vertus prônées par la Pennsylvanie. Le Massachusetts y ajoutait la piété; la Virginie, la vertu.
16
L’idée d’une double identité est de J. Isaac – article cité. De la 4e sansculottide de l’an II à la fin du Directoire,
les discussions à la tribune sont légion sur l’urgence à mettre en place des institutions politiques et morales ; de
ranimer le commerce et l’industrie ; de raviver les arts utiles ; de rétablir le crédit public ; etc… mais aussi de
servir la république et la cause sacrée de la liberté et de l’égalité. Entre autres, Le Moniteur (vol. 22 à 29) et les
Proclamations ministérielles de Neufchâteau et de Quinette (AN F 21-527 et AN F 17-1232).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%