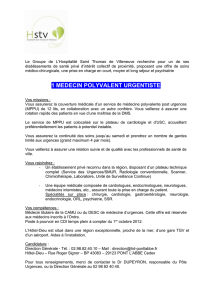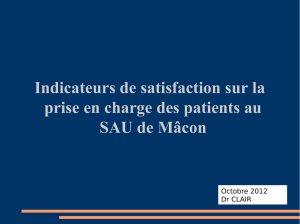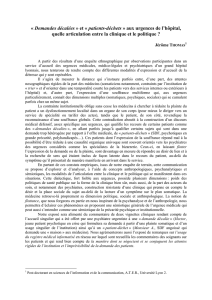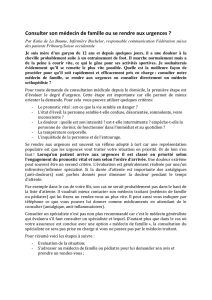Malaise aux urgences

Malaise aux urgences
Aux urgences de l'Hôtel-Dieu, à Paris, l'heure ne tourne pas comme ailleurs. Pas
moyen de savoir quand la journée commence ni quand elle finit. Les médecins
surmenés font grève vendredi 10 mars
Marion van Renterghem [email protected] Mis à jour le vendredi 10 mars
2000
QUOI qu'il arrive, Gilberte est déjà là. Aux urgences de l'Hôtel-Dieu, à Paris, Gilberte
est la patiente la plus assidue. La voilà, au petit matin, en train de dormir à poings
fermés sur un brancard. La revoilà, en fin d'après-midi, au centre d'un joyeux chahut
avec les infirmiers et les policiers rendus hilares par sa conversation ininterrompue.
Le lendemain matin, Gilberte est toujours là, dans la salle d'attente cette fois, assise
sagement, droite comme un « i », le sourire édenté, un gobelet de café à la main.
« Tout va bien, Gilberte ? », demande Martine, à l'accueil. Gilberte va très bien ce
matin. Comme d'habitude, la police l'a amenée là après l'avoir arrêtée en état d'ivresse
sur la voie publique. Une fois dégrisée, lavée, nourrie, souvent équipée de nouveaux
vêtements, elle repart dans la rue, sous le pont, c'est-à-dire chez elle. Six heures plus
tard, elle est de nouveau là. « Ça fait un moment que je ne suis pas venue, rectifie-t-
elle avec une grande courtoisie. J'aime voir leurs visages, bavarder avec eux. » « Elle
ne vient pas aux urgences, Gilberte, elle y habite, précise un médecin. C'était la
première patiente du Nouvel An. A minuit moins deux, elle était là. »
L'Hôtel-Dieu est en plein dans la ville : au centre de Paris, à deux pas des Halles, du
métro Châtelet, de la préfecture, du Palais de justice et de Notre-Dame. Au carrefour
des lignes de métro et de RER, l'hôpital n'est pas à proximité des seuls riverains des
quatre premiers arrondissements de Paris, mais aussi de l'ensemble des Franciliens.
Raymond Depardon les a filmés au plus près : aux urgences surgissent, pêle-mêle, les
passants en tout genre, riches et pauvres, célèbres et inconnus, habitants du quartier,
touristes, banlieusards, sans compter les détenus ou les gardés à vue envoyés là
parfois pour un examen plus approfondi par les urgences médico-judiciaires, situées
dans le local mitoyen, et que l'Hôtel-Dieu est le seul hôpital parisien à abriter. En tout,
cela fait plus de 40 000 consultations par an aux urgences médico-chirurgicales. «
Travailler aux urgences ? Disons que c'est une valeur, dit Lisette Mourot, cadre
supérieur infirmier. Au coeur de la cité, la mission de service public s'exerce de plein
fouet. Quels qu'ils soient, les patients sont appelés »monsieur« ou «madame». Déjà
ça, ça n'a pas de prix. »
Ici, à la différence des malades toujours au bord de l'agonie et des médecins survoltés
du feuilleton « Urgences », c'est à la fois le tout-venant médical et social. Les
urgences de l'Hôtel-Dieu sont un service « de proximité ». Ainsi en a-t-il été décidé à
la suite de la restructuration du dispositif hospitalier amorcée sous le gouvernement
d'Alain Juppé. Au transfert des hôpitaux parisiens vers la périphérie et à leur
spécialisation correspond désormais deux types de services d'urgences : les SAU
(service d'accueil des urgences), situés dans les grands centres hospitaliers, et les
urgences de proximité réservées aux hôpitaux qui, tel l'Hôtel-Dieu, sont dépourvus en
aval d'un plateau tec hnique de pointe (notamment en cardiologie, chirurgie
vasculaire, neurologie). On y accueille moins de cas graves, polytraumatisés de la

route ou malades atteints de pathologies sérieuses, que ne le font les SAU. Le Samu,
sauf exception, n'envoie pas les accidentés à l'Hôtel-Dieu. Les gens y viennent seuls,
emmenés par la police ou les pompiers.
8 h 30, réunion des « transmissions » : l'équipe de garde de nuit passe en revue,
devant celle de jour, l'ensemble des patients traités dans la nuit. Dans le couloir,
Gilberte, évidemment, est déjà là. Dans le petit bureau, les médecins de garde
énumèrent les cas : « allergie aux UV » « crise de palpitation d'un VIH en bithérapie,
a été pris à Cochin » « des vomissements, l'examen clinique n'a rien donné » « des
chutes à répétition, a été vu en chir, pas de problème » « un jeune qui s'est pris un
parapet en scooter ; Douleur thoracique, radio pulmonaire normale. C'était une
rupture de rate, il est passé au bloc immédiatement ». Le docteur Pierre Espinoza,
responsable du service, constate une fois de plus le manque de personnel, le manque
de temps. « Dimanche, on avait une hernie étranglée. On l'a réduite mais le patient est
reparti sans avoir été vu par le chirurgien. C'est moyen. »
Dans le couloir, ça râle. « C'est le nouvel électro, ou le vieux pourri ? Tu penses bien
qu'on ne nous a pas filé un nouveau... C'est un autre vieux, en attendant mieux. »
Marilyn Ardon, infirmière, déboule : « Suspicion de pneumo, je le prends tout de
suite Comme souvent, les six salles d'examen sont occupées. « Y en a marre, j'ai deux
personnes à installer, faut faire de la place. » On s'arrange. Les pompiers amènent une
femme grelottante. Elle s'est jetée dans la Seine, on la met au chaud. Un type hurle à
la mort. Colique néphrétique. On le met sous morphine. Quelques heures plus tard, il
fugue, réapparaît aux urgences de Lariboisière, apprend-on par téléphone. Une femme
se présente à l'accueil, d'un air calme, « très fatiguée », dit-elle. Une infirmière va
trouver le médecin. « Tu peux la prendre tout de suite ? Elle n'a pas l'air bien Le
médecin ausculte. La radio et le scanner confirment. On l'envoie en cancéro. « C'est
trop tard, dit le médecin en aparté . Une chance sur deux que dans un mois elle ne soit
plus là. »
AUX urgences, l'heure ne tourne pas comme ailleurs. L'agitation a son rythme à elle,
incessante, arbitraire, en boucle. Pas moyen de savoir quand la journée commence ni
quand elle finit. Si, peut-être : aux visages de la salle d'attente, on peut deviner que
minuit s'approche. Davantage de jeunes, arrêtés dans leur course à la sortie d'un dîner
: agression, chute de moto, accident en état d'ivresse, tentative de suicide. Un peu plus
de « toxicos » ou de sans-abri, de gardés à vue. Certains n'ont pas de papiers, ne sont
pas en état de dire leur nom. « On les appelle »10 février« ou »3 janvier « », dit
Marilyn.
C'est la nuit. D'une salle d'examen à l'autre, Joseph Dado, « chirurgien attaché »,
accumule les points de suture, toujours patient, toujours attentif, rassurant. Les
pompiers font irruption quasiment toutes les 10 minutes, en portant un brancard. « Ça
irait plus vite de compter le temps qu'on ne passe pas à l'Hôtel-Dieu », lance l'un
d'entre eux, basé à la caserne voisine.
Le malaise aux urgences n'est pas seulement du côté des patients. Delphine Cantin-
Bertaux est debout depuis trente-six heures. Comme tous les médecins dont c'est le
tour de garde. Arrivée dimanche à 8 heures, pour ne repartir que le lundi à 18 heures.

Sans dormir, sans s'arrêter, sans se plaindre. Dès le lendemain 8 heures, elle sera de
nouveau à la tâche, et pas plus d'une nuit pour récupérer. Avec son statut de «
médecin attaché » (hiérarchiquement supérieur à celui d'interne et inférieur à celui de
médecin praticien), elle travaille cinquante heures par semaine (tous ne sont pas si
actifs) pour 9 000 francs nets, traitement de base d'un médecin attaché.
Les gardes (4 à 5 par mois) permettent de l'améliorer un peu : 1 400 francs en
semaine, 2 800 francs le week-end. Aux urgences, une garde de nuit n'est pas
reposante. Contrairement aux autres services de l'hôpital, l'activité y est la même que
le jour : ininterrompue. « Je travaille en général 4 jours ici et 1 jour au Samu, dit son
confrère Jean-Luc Haïm, aussi passionné qu'elle. Après 24 heures de garde, ça
m'arrive de ne pas être au top de mes capacités. Il faudrait changer ce système. »
Aides-soignants et infirmiers ne comptent pas davantage leur temps. Ils ont
commencé un mouvement de grève en janvier. « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?
soupire Marilyn. On n'a aucun moyen de pression, on ne va pas laisser mourir les
gens. Tu as un infarc qui arrive, tu le soignes, c'est tout. » Tous se battent pour des
services d'urgences de qualité. Où les patients attendraient moins, où l'on aurait le
temps, les moyens, le matériel pour les soigner mieux. Il faut plus de praticiens
permanents. Mais aussi des chaises, des brancards, des électrocardiogrammes, tout
est déficient. Les 10,1 milliards de francs promis par le gouvernement sur trois ans,
dont environ le dixième aux urgences ? « Ce n'est pas encore clair », dit Jean-Luc
Haïm.
A compter du 10 mars, l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France
(Amuhf) organise grèves et manifestations pour dénoncer le non-respect du protocole
d'accord conclu avec le gouvernement en 1999. Celui-ci prévoyait notamment des
créations de postes de praticiens hospitaliers (ils ne sont que deux à l'Hôtel-Dieu,
outre une vingtaine de vacataires, une soixantaine de paramédicaux). Les urgentistes
veulent surtout s'assurer que les crédits seront bien orientés vers leurs services et non
vers ceux de spécialités jugées plus prestigieuses.
Car le malaise majeur, pour les urgences, est de ne pas encore être reconnu comme
un service à part entière. Les rapports Steg et Barrier, au début des années 90, ont
contribué à cette prise de conscience. Il reste du chemin à faire. « Les urgentistes
sont les parents pauvres du système universitaire et hospitalier, ce qui est aberrant,
déplore le professeur Arnaud Basdevant, président du comité consultatif médical
(CCM) à l'Hôtel-Dieu. Sur le plan de la santé publique, c'est aussi noble de soigner
une crise d'alcoolisme qu'un infarctus du myocarde. »
A l'image de l'évolution d'une société urbaine plus anxieuse, exigeant des réponses
immédiates à ses angoisses et à sa douleur, la fréquentation des urgences de l'Hôtel-
Dieu ne cesse d'augmenter depuis dix ans. Disparition du médecin de famille,
précarité sociale, désengagement par la plupart des généralistes de la médecine
d'urgence, contribuent à ce nouvel afflux : « Les gens savent qu'on est obligés
d'examiner tout le monde, quel que soit le cas, explique Pierre Espinoza. Outre le
ticket modérateur, ils ont tout à portée de main : spécialistes, résultats sa nguins,
scanner, radio... »

Les urgences sont victimes de leur succès. Aujourd'hui, par exemple, Marilyn est en
pétard. Les gens viennent pour un oui ou pour un non, pour des toussottements jugés
suspects, pour une angine qui traîne ou un mal de tête, munis de lettres de médecin
vieilles de quinze jours. « Tu parles d'une urgence ! Il y en a qui disent qu'ils
travaillent en face, à la préfecture, comme si c'était un passe-droit. » L'un d'entre eux
est reparti avec un pansement, pour une griffure de chat, un autre s'était coincé le
doigt. Nicole Marcel, la secrétaire, renseigne inlassablement les innombrables inquiets
qui téléphonent aux urgences. Telle cette femme qui appelle pour faire part de sa
constipation : « On m'a dit qu'il fallait acheter des pruneaux, pourriez-vous me dire
combien je dois en manger ? »
Engorgement dans la salle d'attente, grogne légitime. La hiérarchisation se fait en
fonction du degré d'urgence. « Il y a des douleurs qui font tilt, explique Marilyn. Au
thorax, ça peut être un infarctus, on le prend sur le champ Les autres n'en peuvent
plus d'attendre. Des heures. Au mieux, ils se plaignent. Très souvent, ils cognent.
Insultes et violences à l'égard du personnel médical sont monnaie courante. Une
femme ivre essaie de mordre tout ce qui passe, un autre envoie son poing à la figure
d'un infirmier. « Je lui mets sa perf et il me traite de con ; la prochaine fois il ira se
faire voir », lance un aide-soignant. La nuit, c'est pire, les effectifs sont réduits. Joseph
Dado, chirurgien attaché, se sent bien seul. Une des externes censée l'assister n'est pas
venue, les salles d'examen ne se libèrent pas assez vite, tout le monde s'impatiente. «
Je n'ai pas mangé ce midi, je ne mangerai pas ce soir, mais j'aimerais au moins que les
malades soient soignés. »
CE matin, Gilberte n'est pas là. Le docteur Espinoza fait la visite au « porte », ainsi
que l'on nomme l'unité d'hospitalisation de courte durée, soit 12 lits réservés aux
urgences et qui permettent de garder un patient moins de 24 heures. Au bout d'une
nuit, les malades rentrent chez eux ou sont réorientés vers d'autres services, d'autres
hôpitaux. Comme cette dame de 99 ans, arrivée aux urgences la veille pour des
chutes à répétition. « Pour un oui ou pour un non, je m'écroule, dit-elle. - Un
transfert en maison de retraite serait peut-être sage, dit Espinoza. - Mais je me plais
tellement dans mon p'tit bazar. C'est ça, la vieillesse, vous savez ? On va réfléchir
ensemble, d'accord ?conclut Espinoza. - D'accord, mais mon p'tit bazar, encore un
petit peu, hein ? Mes quatre assiettes, ma cafetière... »
Les gens écrivent beaucoup aux urgences. Des lettres d'insultes au directeur de
l'hôpital, pour avoir attendu trop longtemps ; des lettres de remerciements aux
médecins, infirmiers et aides-soignants, pour leur générosité fabuleuse. «
Transmettez leur mes remerciements, non seulement pour ce qu'ils m'ont fait, mais
surtout pour ce que j'y ai vu », écrit un malade de passage. Gilberte, très souvent,
chipe des fleurs au marché pour les leur donner.
Marion Van Renterghem
Le Monde daté du samedi 11 mars 2000
Copyright (C) 2000 Le Monde
1
/
4
100%