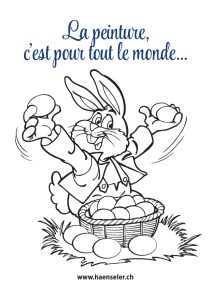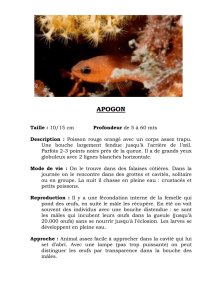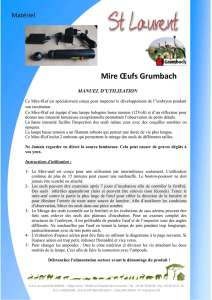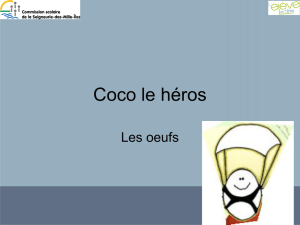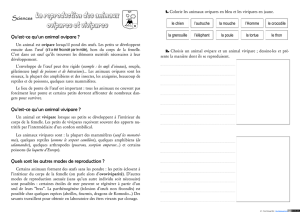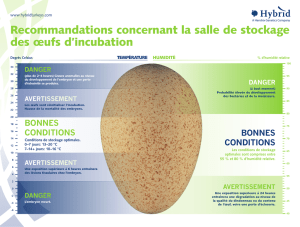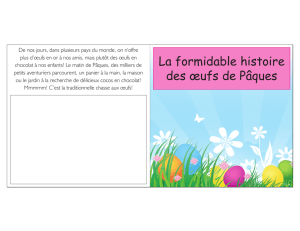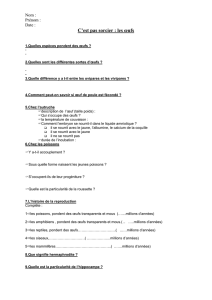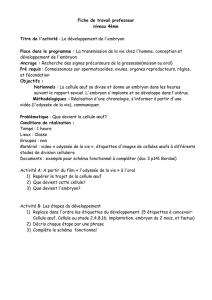CHAPITRE VI Page 203

< 203 >
CHAPITRE VI
Hérédité cytoplasmique.
Lorsqu'un spermatozoïde porteur d'un gène dominant connu pour son action sur le développement d'un
caractère embryonnaire, féconde un œuf, l'embryon qui se développe peut ne présenter que le caractère
récessif propre à la race de sa mère : comme exemple, citons la vitesse de division d'un œuf. On peut
expliquer ces résultats en disant que le cytoplasme ovulaire s'est formé sous l'influence des chromosomes
maternels en nombre double. D'un autre côté, il peut exister dans le cytoplasme de l'œuf certains
corpuscules qui se perpétuent et auxquels on peut rapporter le développement de certains caractères, tels
que les plastides chlorophylliennes. Nous rangerons ces deux phénomènes parmi les cas d'hérédité
cytoplasmique.
L'interprétation de l'hérédité mendélienne d'après une base chromosomiale n'exclut nullement la
possibilité de l'existence d'autres formes d'hérédité dépendant des autres constituants de la cellule. Bien
que le cytoplasme soit essentiel pour le développement de l'organisme et qu'il soit transmis par l' œuf à
chaque nouvelle génération, ses constituants ne se perpétuent pas eux- [eux-mêmes]
< 204 >
mêmes sans changements, comme le font les chromosomes, et ne sont, par conséquent, pas héréditaires. Il
y a cependant dans le cytoplasme certains éléments, comme les plastides (peut-être aussi les
chondriosomes), qui, de même que la chromatine, croissent et se divisent et ont donc le pouvoir de se
perpétuer indéfiniment eux-mêmes sans changements ; ces éléments peuvent non seulement élaborer des
produits inertes, tels que la graisse ou du pigment, mais aussi des enzymes actives qui, réagissant avec
d'autres produits du développement, peuvent déterminer les caractéristiques de la race. Des structures
comme la coquille et le jaune des œufs sont d'origine purement maternelle, mais comme elles n'ont pas le
pouvoir de s'accroître ni de se diviser, elles ne peuvent se perpétuer elles-mêmes indéfiniment, mais elles
peuvent néanmoins déterminer certaines caractéristiques de l’embryon ; ainsi, elles peuvent paraître
exercer une influence sur les caractères héréditaires de la génération à laquelle appartient l'embryon ; par
exemple, les femelles de certaines races de vers à soie ont des œufs blancs parce que la coquille est
blanche. Si ces œufs sont fécondes par les spermatozoïdes d'une autre race qui possède des œufs à
coloration verte dominante, les coquilles sont néanmoins blanches. Inversement, lorsque les œufs verts
d'une femelle de la race à œufs verts sont fécondes par des spermatozoïdes d'un male de la race à œufs
blancs, la couleur reste verte. Lorsque les papillons se développent aux dépens de l'une et l'autre de ces
deux sortes d'œufs hybrides, ils pondent seule- [seulement]
< 205 >
ment des œufs verts parce que le facteur pour le vert domine chez l'hybride et détermine la couleur de la
coquille des nouveaux œufs. Les œufs verts donnent naissance à des papillons dont les trois quarts
pondent des œufs verts et un quart des œufs blancs, montrant q'il s'agit ici d'un cas ordinaire d'hérédité
mendélienne, qui est pourtant dissimulé lorsqu'on considère les caractères du jeune embryon : en effet,
comme on l'a vu, ces caractères sont dus à des particularités existant dans les œufs avant la ponte. D'un
autre côté, la séreuse est une membrane cellulaire qui se développe autour de l'embryon et produit du
pigment. Vu à travers la coquille, le pigment donne à l'embryon une couleur définie qui, chez l'embryon
hybride, est caractéristique de la race maternelle. Comme le pigment de la séreuse n'existe pas dans l'œuf
mais se développe après la fécondation, l'hérédité paraît être ici déterminée par le caractère de l'œuf et non
par le spermatozoïde. Mais l'histoire génétique de ce caractère de l'embryon est apparemment la même

que celle de la couleur de la coquille ou du jaune et peut être, par conséquent, interprétée de la même
façon. Il doit donc exister dans l'œuf une certaine substance primitivement incolore et qui, plus tard,
produit du pigment à l'intérieur de la séreuse sans doute par réaction avec quelque chose qui s'y trouve. A
la génération suivante cependant, l'influence du père se révèle lorsque l'embryon F.2 fabrique les éléments
de la séreuse ; alors, en effet, le noyau du mâle P.1 a eu l'occasion de déterminer ce que ces élé-
[éléments]
< 206 >
ments deviendront : si c'est le facteur paternel qui est dominant, il détermine l’espèce de matériel que
contiendront les œufs et, par conséquent, la couleur de la séreuse chez cette nouvelle génération.
Un cas d'hérédité cytoplasmique a été décrit par Correns chez la belle-de-nuit Mirabilis jalapa. Il existe
une race dont les feuilles sont panachées de vert et de blanc, mais certaines branches peuvent avoir des
feuilles entièrement vertes et d'autres, des feuilles blanches. Si les fleurs des branches vertes sont
autofécondées, les jeunes plantes sont vertes. Si les fleurs des branches blanches sont autofécondées, les
descendants ont des feuilles blanches, et ces plantes périssent par manque de chlorophylle. Les
descendants des branches panachées peuvent être verts, panachés ou blancs.
Si l'on fait un croisement entre des fleurs nées sur des branches dissemblables, l'hérédité est purement
maternelle. Par exemple, si le pistil d'une fleur née sur une branche blanche est fécondé avec le pollen
provenant d'une plante vert pur, il se produit uniquement des descendants à feuilles blanches. Le
croisement réciproque c'est-à-dire la fécondation du pistil d'une fleur située sur une branche verte avec le
pollen provenant d'une fleur d'une branche blanche, donne uniquement des descendants verts et ceux-ci
restent verts à toutes les générations suivantes.
Correns fait observer que l'on peut interpréter ces résultats en supposant que le blanchiment est du à
une sorte de maladie qui est transmise par le cytoplasme de
< 207 >
l'œuf à la génération suivante. Comme le pollen n'apporte aucun cytoplasme, la maladie n'est pas
transmise par les mâles.
Baur constate que chez plusieurs autres plantes chez lesquelles existent des variétés à feuilles
panachées (Melandrium, Antirrhinum, etc.) l'hérédité est strictement mendélienne, car la génération F.l est
verte et la génération F.2 se compose de trois verts pour un panache. La coloration, dans ces cas, peut
dépendre d'un facteur chromosomial. Mais il existe un cas, chez Pélargonium, qui, selon Baur, ne peut
s'expliquer ni de l’une ni de l’autre des deux manières. Chez Pélargonium, il existe aussi des branches
panachées, des branches blanches et des branches vertes. Des fleurs venues sur des branches vertes
croisées avec d'autres venues sur des branches blanches donnent des plantes panachées quelle que soit la
façon dont ait été fait le croisement. Une fleur sur branche verte autofécondée donne naissance à une
plante à feuilles entièrement vertes. Si une fleur sur branche panachée est autofécondée, elle produit une
plante panachée ; enfin, si une fleur née sur branche blanche est autofécondée, elle donnera naissance à
une plante blanche.
Pour expliquer ce cas, Baur avance l'hypothèse suivante. La couleur verte de Pélargonium, comme
celle de toutes les plantes à fleurs, est due aux grains de chlorophylle ; ces grains se multiplient,
fournissant à toutes les cellules des générations successives leur part de grains de chlorophylle. Dans les
parties blanches, ces

< 208 >
grains sont déficients, en ce sens qu'ils ne produisent pas la couleur verte tout en gardant le pouvoir de se
multiplier. Si l'on admet maintenant que le pollen, aussi bien que l'œuf, peut transmettre quelques grains
de chlorophylle, les résultats peuvent s'expliquer. En effet, lors de la division des cellules, qui contiennent
à la fois des grains verts (normaux) et blancs (anormaux), il se produit à un certain moment une
distribution inégale des grains, et, dans les cas extrêmes, deux sortes de branches peuvent se produire,
l'une avec des grains verts et l'autre avec des grains blancs. L'hypothèse repose sur une transmission par le
cytoplasme du pollen aussi bien que par celui de l'œuf. Baur conclut en disant que tant que ce fait ne sera
pas établi, l'interprétation en restera douteuse.
> > > CHAPITRE VII Page 209
> > > RETOUR A LA TABLE DES MATIERES
1
/
3
100%