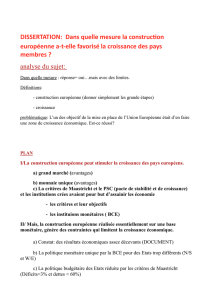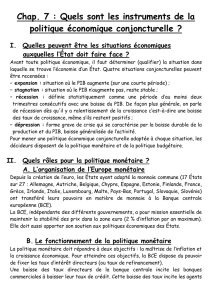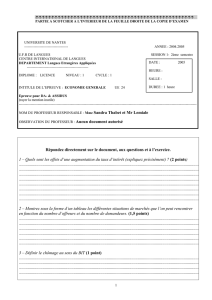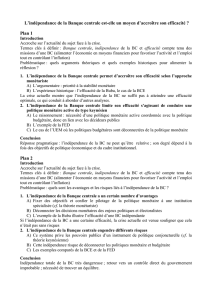Contribution à la Convention sur le futur de l`Europe

Contribution à la Convention sur le futur de
l’Europe
Une autre Europe pour une autre mondialisation
Résumé
La contribution d’ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et l’aide
aux citoyens) se fonde sur l’expérience des dernières années qui montre que la politique
européenne fonctionne de plus en plus comme un relais de la mondialisation libérale. Elle se
fonde aussi sur l’expérience et l’expertise de ses membres, qui travaillent et militent pour les
droits de nombreux groupes de femmes et d’hommes à travers l’Europe et le monde qui
vivent souvent dans des conditions difficiles, des conditions de discrimination ou d’exclusion.
Cette contribution représente les aspirations de millions de personnes dans le monde pour que
l’Europe devienne enfin un espace et un modèle de liberté, d’égalité dans la dignité et la
justice.
Pour atteindre ces objectifs, la Convention devra proposer un nouveau Traité pour corriger les
erreurs et contradictions contenues dans les Traités de Maastricht et d’Amsterdam, en
particulier :
- la rigidité résultant du Pacte de stabilité et de croissance, qui empêche de mettre en place
une politique de relance et une politique économique plus favorable à l'emploi ;
- l'article 86 du traité qui a été utilisé pour libéraliser tous les services publics en réseau ;
- l’article 133 du traité d’Amsterdam qui vise à privatiser les services publics et à préparer le
terrain pour l’Accord général sur le commerce des services pour accélérer leur remise en
cause ;
- la Charte dite des droits sociaux fondamentaux, mais qui ne définit aucun droit réel.
Le nouveau Traité devra assurer :
- le respect de la dignité de tout être humain, en améliorant la Charte des Droits fondamentaux
(droit au logement, droit au travail, droit à un revenu minimum), en adhérant à la Déclaration
des Droits de l’homme ratifiée par de nombreux pays membres et par le Conseil de l’Europe ;
- le bien-être de chaque individu, avec les priorités suivantes :
- égalité des genres (hommes et femmes),
- lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
- lutte contre toutes les formes de discrimination,
- droits des enfants, des familles et des personnes âgées,
- assurer un accès pour tous à l’éducation et la formation tout au long de l’existence,
- coordonner les politiques pour assurer un développement durable respectueux de
l’environnement et des espèces végétales et animales,
- protéger la santé de chacun et la santé publique.
- la participation de chaque personne aux décisions qui déterminent son futur :
- démocratie paritaire avec une représentation égale des genres en politique,
- reconnaissance et défense de la représentation des minorités,
- citoyenneté de résidence,
- reconnaissance de la multiculturalité,
- mise en place de mécanismes permettant l’expression de la démocratie participative,
- droit à l’information et garantie de transparence des mécanismes de décision.

- les possibilités de recours en cas de litige pour garantir la justice pour tous.
Le Traité devra aussi reconnaître que ces objectifs ne peuvent pas être atteints uniquement par
la voie marchande et que certaines matières nécessitent une approche collective : santé,
éducation, culture, environnement, patrimoine commun de l’humanité et accès aux biens et
services minimaux d'intérêt collectif.
L’ensemble de ces objectifs devrait aussi être intégré dans la politique de sécurité intérieure, à
tous les pays candidats, et à la politique étrangère de l’Union européenne, notamment en ce
qui concerne l’aide au développement.

1.- L’UE, entité économique et politique
sans légitimité démocratique
Une insatisfaction croissante et partagée des opinions publiques
Dans l’Europe que nous voulons, l’action du pouvoir contribuera-t-elle à corriger les
inégalités économiques et sociales, à redistribuer équitablement une partie des richesses
produites ? Contribuera-t-elle à développer l’égalité des chances, la protection sociale ? A
développer les solidarités intra et intergénérationnelles, l’égalité entre les genres ? A
privilégier la lutte contre la criminalité financière et non à prendre des mesures répressives
contre les plus défavorisés ? A préserver la nature en favorisant un développement durable ?
Aujourd’hui la mondialisation, cela ne marche pas, cela ne marche pas pour les pauvres du
monde, dans l’Union et en dehors de l’Union. Le problème n’est pas la mondialisation, mais
la façon dont elle a été gérée et dont elle pourrait encore être gérée dans l’avenir. En
particulier par les institutions européennes, économiques et autres, et par les institutions
internationales qui contribuent à fixer les règles du jeu ; en effet celles-ci ont trop souvent
géré en fonction des intérêts privés au sein des pays développés et parfois aussi au sein de
certains pays sous développés ou émergents. Le ressentiment qui en résulte se retourne contre
ces institutions et les pays ou les groupes d’intérêts qui les ont instrumentalisées à leur profit.
Bien sûr, les missions de l'Union ne sauraient être examinées de manière isolée. Si l'on veut
que l'Union puisse agir efficacement et répondre aux attentes de ses citoyens, il convient
d'établir un lien entre missions, compétences et instruments, en précisant pour chaque mission
et pour chaque objectif la répartition de compétences la plus appropriée et le choix des
instruments les plus performants. Encore faut-il définir les objectifs de la performance d’une
manière explicite et ne pas les détourner de leurs objectifs initiaux.
Dans un premier temps, il convient de définir les valeurs communes de l’Union et ses
objectifs. En suite, à partir des différentes missions qui sont confiées à l'Union, de définir les
objectifs concrets, préciser l'attribution des compétences, ainsi que les instruments les plus
adéquats pour remplir ces missions.
De la dérive économique à la confusion institutionnelle
Après la seconde guerre mondiale, au plus fort du rayonnement de l’image des Etats-Unis
dans le monde et de la fascination pour l’American way of life, Jean Monnet et les “ pères
fondateurs ” de la Communauté européenne projetaient la construction à terme des “ Etats-
Unis d’Europe ”, dans une perspective fédérale[1]. Ils vont, de fait, adopter des structures
dotées d’un pouvoir propre, mais circonscrit, institutionnalisant des solidarités économiques
liées aux besoins de la reconstruction d’un continent dévasté : la CECA (Communauté
européenne du charbon et de l’acier, 1951) [2] et, plus tard, l’EURATOM (Communauté
européenne de l’énergie atomique, 1957).
Le contexte de la guerre froide et le rejet en 1954, par l’Assemblée nationale française, du
traité signé en 1952 et instituant une Communauté européenne de défense (CED) mettent fin
aux ambitions politiques initiales. Le 25 mars 1957, les traités de Rome créent la
Communauté économique européenne (CEE) et l’EURATOM. Privilégiant une approche
purement économique, le traité CEE prévoit à terme l’instauration d’un marché commun. Il

pose en même temps les bases de ce qu’on va appeler le “ triangle institutionnel ” : la
Commission européenne, dont les membres sont nommés par les gouvernements des Etats
membres, et qui reçoit la mission de “ proposer ” des actes législatifs communautaires ; le
Conseil des ministres, qui décide ; l’Assemblée de Strasbourg, dont les membres sont, à
l’origine, désignés par les Parlements nationaux, et qui dispose d’une compétence consultative
qui va s’élargir au cours de l’histoire. A ce triangle, il faut ajouter la Cour de justice des
Communautés européennes, chargée de juger le contentieux né des décisions de ces
différentes instances en interprétant les traités et le droit communautaires.
L’Acte unique européen de 1986 officialise et adjoint à cette architecture le Conseil européen,
créé en 1974, qui réunit les chefs d’Etat ou de gouvernement, assistés de leurs ministres des
affaires étrangères, ainsi que le président de la Commission. Ce Conseil européen définit les
orientations générales ainsi que la politique étrangère et de sécurité de l’Union, débat de la
situation de l’emploi et adopte des recommandations de politique économique.
Dans l’ensemble, le postulat des pères fondateurs, selon lequel le développement des
solidarités économiques ferait naître une Europe politique fédérale a été en partie invalidé.
D’un côté, l’intergouvernemental a durablement prédominé. De l’autre, le marché et une
monnaie unique se sont imposés comme formes d’unification fédérale non démocratique,
progressant dans le secret de décisions gouvernementales, et au détriment d’une véritable
citoyenneté européenne.
La séparation entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif, propre à toutes les grandes
démocraties, est d’autant plus confuse au sein du triangle institutionnel initial qu’elle se
superpose d’abord à une distinction entre des instances supranationales (la Commission, le
Parlement, la Cour de justice) et une instance intergouvernementale (le Conseil des ministres)
et que, ensuite, les pouvoirs de ces différents organes vont évoluer au fil du temps.
Le Conseil des ministres se réunit à huis clos – la possibilité de débats publics et la publicité
de ses votes et de ses délibérations étant prévues dans certains cas – avec des hauts
fonctionnaires et, selon son ordre du jour, avec les ministres concernés. La Commission est “
invitée ” à participer aux sessions, de même que la Banque centrale, à moins que le Conseil
n’en décide autrement. Les décisions sont prises par les ministres à l’unanimité ou à la
majorité qualifiée. Le vote à la majorité qualifiée attribue à chaque Etat un nombre de voix
déterminé par les traités, ceux-ci fixant également les procédures de vote selon les questions.
En 1986, l’Acte unique a appliqué ce vote à la majorité qualifiée à toutes les questions
relatives à la mise en place du grand marché ? Avec des exceptions importantes toutefois :
pour toutes les questions concernant la fiscalité, la libre circulation des personnes et certains
droits des travailleurs salariés, le vote à l’unanimité est exigé. A côté de ces compétences
législatives, le Conseil détient aussi des compétences exécutives. Il peut élaborer des
règlements d’application, il propose un budget (désormais adopté en co-décision avec le
Parlement) et décide éventuellement de négociations extérieures pour lesquelles il mandate la
Commission.
La Commission a des pouvoirs importants, même s’ils restent tributaires en dernière analyse
de l’aval du Conseil (sauf en matière de concurrence où elle dispose de pouvoirs propres).
Alors que les ministres siégeant au Conseil changent souvent et ne se réunissent
qu’occasionnellement, les membres de la Commission, désignés pour 5 ans par les
gouvernements, siègent en permanence. La Commission est dotée :

- d’un pouvoir d’initiative : elle est chargée de formuler les propositions de textes législatifs et
réglementaires européens, sauf dans des cas limitativement énumérés. Elle peut suggérer une
révision des traités, des négociations avec des Etats tiers, etc. Le Conseil ne peut décider que
s’il est saisi d’une proposition de la Commission, sauf, notamment, en matière d’Union
économique et monétaire, où la Banque centrale dispose d’un pouvoir d’initiative ;
- d’un pouvoir d’exécution et de gestion des politiques communes, notamment en élaborant
des règlements et des directives ;
- d’un pouvoir de contrôle : elle est la “ gardienne des traités ” et surveille l’application du
droit communautaire. Elle peut déférer à la Cour de justice des Etats qu’elle juge en infraction
par rapport à ce droit communautaire.
Entre 1985 et 1995, Jacques Delors, président de la Commission, s’est appuyé sur François
Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. Sous sa présidence, la Commission est passée, dans
les faits, d’un pouvoir d’expertise et de proposition “ technique ” à un pouvoir de proposition
pleinement politique, sans devenir pour autant assimilable à un exécutif responsable. Elle
s’est ainsi identifiée à l’incarnation d’une sorte d’“ intérêt général européen ”, par opposition
aux intérêts nationaux défendus par les procédures intergouvernementales. Cette évolution de
son rôle est intervenue dans le contexte économique spécifique du néolibéralisme triomphant
des années 1980 : le recours systématique au marché s’est imposé comme médiation exclusive
pour exprimer un “ intérêt général ” communautaire. Dans cette perspective, les pouvoirs
accrus de la Commission au service de la concurrence et de la déréglementation sont
cohérents avec son renoncement à une politique économique interventionniste privilégiant des
priorités sociales.
Ce pouvoir politique de la Commission – entériné par les gouvernements nationaux – s’est
concrétisé notamment avec l’élaboration de l’Acte unique européen, qui reprend le Livre
blanc de la Commission sur l’achèvement du marché intérieur, signé en 1986 et prévoyant un
marché unique au 1er janvier 1993. Il se poursuit avec la préparation des textes du traité de
Maastricht, signé en 1992, qui organise la mise en place d’une monnaie unique, administrée
par une Banque centrale européenne indépendante. Autres exemples : les pouvoirs de la
Commission en matière de fusion ou en matière de concurrence, celle-ci étant invoquée pour
imposer un démantèlement des services publics. En novembre 2001, les négociations qui ont
précédé la conférence ministérielle de l’OMC à Doha se sont réduites, pour l’essentiel, à un
face à face entre Pascal Lamy (commissaire européen chargé du commerce extérieur) et son
homologue américain Robert Zoellick, certes dûment mandatés - l’un par le conseil des
ministres chargés du commerce, et l’autre par le président des Etats-Unis -, mais loin de tout
débat public. De leur côté, les gouvernements des Etats membres ont utilisé cette montée en
puissance de la Commission pour en faire un “ bouc émissaire ” lorsqu’ils transposent en droit
national les directives qu’elle a certes élaborées, mais qu’ils ont votées, cherchant ainsi à se
défausser de leurs responsabilités propres.
On assiste également à une montée en puissance relative du Parlement européen depuis son
élection pour un mandat de 5 ans, à partir de 1979, au suffrage universel direct. Jusqu’au traité
de Maastricht, ce Parlement n’avait essentiellement que des pouvoirs consultatifs et de
contrôle. Ses membres peuvent maintenant contraindre la Commission à démissionner s’ils
adoptent une motion de censure à la majorité des deux tiers. Le Parlement dispose cependant
de pouvoirs budgétaires non négligeables, puisqu’il a été doté, en 1970 et en 1975, d’un
pouvoir d’amendement, d’adoption et de refus en matière budgétaire. L’Acte unique a
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%