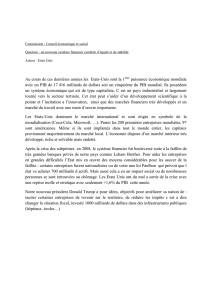De nouveaux indicateurs face au PIB

De nouveaux indicateurs face au PIB
Par Jean Gadrey
Alternatives Economiques - n°270 - Juin 2008
IDH, BIP 40, PIB verts..., de nouveaux indicateurs tentent
de battre en brèche l'omniprésence du PIB. Un reflet des
préoccupations sociales et écologiques croissantes.
Pour "aller chercher la croissance avec les dents", une
promesse de campagne, Nicolas Sarkozy avait nommé,
dès juin 2007, la commission "pour la libération de la
croissance française", présidée par Jacques Attali. Ce
dernier, après avoir chanté tout l'été le refrain du "5% par
an", se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue, et se
mit à en rabattre nettement sur ce chiffre. Le seul record
de croissance qu'il pulvérisa fut celui du nombre de
propositions contenues dans un rapport : 317.
Avant même la remise, le 23 janvier 2008, de son opus
final, le président de la République, constatant que la
croissance et le pouvoir d'achat étaient insensibles à ses
discours enflammés, créait une surprise en nommant une
autre commission, présidée par Joseph Stiglitz. Son
objectif : la remise en cause des indicateurs de
croissance, jugés inadaptés à la mesure du progrès.
Une interprétation possible de cet apparent revirement est
la suivante : quand on réalise que l'on ne pourra pas tenir
un objectif chiffré, il est tentant de changer de
thermomètre, en espérant que le nouveau fournira des
évaluations moins déplorables de l'écart entre les
intentions et les résultats. Cette interprétation n'est pas
fausse (1), mais elle est insuffisante. Des réseaux de
chercheurs et d'acteurs de la société civile militent depuis
des années pour une "reconsidération de la richesse" et
de ses indicateurs, en France et dans le monde.
Pourquoi, comment et à quels indicateurs peut-on alors
penser ? Ces questions, qui engagent l'avenir, sont bien
plus importantes que les spéculations sur les
contradictions des discours politiques à courte vue.
1. Pourquoi ?
Plus que jamais peut-être, les grands indicateurs
macroéconomiques issus des comptes nationaux, au
premier rang desquels on trouve le produit intérieur brut
(PIB) et sa croissance, tiennent le haut du pavé. Aussi
bien dans les jugements concernant le progrès des
nations et leurs classements, que dans des compétitions
politiques où les principaux candidats se présentent
comme ceux qui vont assurer la croissance la plus forte.
Pourtant, dans le même temps, on assiste à une
explosion d'initiatives, du local à l'international, visant à
remettre ces indicateurs à leur place et à construire et à
utiliser des indicateurs alternatifs; selon les cas, ils font
référence au développement humain, au bien-être, à la
santé sociale, au développement écologiquement
durable, etc.
Cette exigence reflète la recherche d'autres fins, justifiées
par d'autres valeurs que l'expansion continue de la sphère
économique marchande et monétaire, couverte par le
PIB. La dynamique actuelle des nouveaux indicateurs,
dans sa diversité, "indique" d'abord des inquiétudes et
des critiques sociales et écologiques. Elle remet en
question la "société de croissance" (pour reprendre
l'expression de Serge Latouche) ou la "société
économique" (une société dans laquelle l'économie
domine la vision du progrès) qui a véritablement pris son
essor après la Seconde Guerre mondiale.
De telles remises en cause ont certes déjà existé par
le passé, en particulier dans les années 70, mais elles
furent balayées dans la décennie suivante. Il y a fort à
parier que le mouvement actuel, autrement puissant et qui
atteint désormais de grandes institutions internationales,
ne connaîtra pas le même sort. Ne serait-ce que parce
qu'il voit pour la première fois se rejoindre la critique
sociale et la critique écologique sur les dégâts de la
croissance telle que nous la connaissons depuis des
décennies. Il existe une autre raison : les dégâts en
question ont pris des proportions sans commune mesure
avec ceux que cherchaient à mesurer les experts des
années 70. Dans ce contexte, la décision du président de
la République de nommer la commission Stiglitz doit
d'abord être interprétée, au-delà de ses aspects
politiciens, comme la reconnaissance embarrassée de
l'influence d'un mouvement de contestation de la "religion
de la croissance".
Personne ne demande l'abandon des comptes
nationaux actuels, indispensables pour certaines
analyses, par exemple pour les évaluations du
partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits.
La critique du PIB est en réalité la critique de ses usages
erronés et de l'assimilation de la croissance au progrès.
Mais cette critique doit être menée pour pouvoir construire
des comptes alternatifs. Le PIB est la somme des valeurs
ajoutées de toutes les unités de production de l'économie
monétaire. C'est donc une grandeur fort utile. Mais si l'on
réalise que, en termes de contenu réel, ces valeurs
ajoutées sont de plus en plus "empoisonnées" et de plus
en plus menaçantes pour les générations futures, on doit
se demander ce qu'elles ajoutent vraiment, au-delà de
leur montant monétaire ou en volume.
Même l'objectif social d'un partage plus équitable des
richesses est conditionné par la question : de quelles
richesses parle-t-on ? Un partage équitable, y compris
en songeant aux générations futures, des principaux
ingrédients du bien-être, au-delà de ses composantes
monétaires, un accès universel à des biens communs et à
des droits fondamentaux, voilà le genre de finalités que
de nouveaux indicateurs doivent aider à préciser.
2. Comment faire ?
C'est à cette question que travaille un collectif constitué
depuis peu et baptisé Fair : Forum pour d'autres
indicateurs de richesse. Il a reçu un appui officiel de la
commission Stiglitz le 22 avril 2008, à l'occasion d'une
rencontre à l'Assemblée nationale. Des textes sont en
ligne sur le site de l'Idies, l'Institut pour le développement
de l'information économique et sociale (voir "Pour en
savoir plus").
Retenons trois intentions.
La première est d'ordre éthique. Elle consiste à affirmer
que la recherche d'autres indicateurs tient à la volonté
d'accorder une priorité à d'autres fins que l'expansion de
l'économie marchande et monétaire.
La seconde relève du politique : on ne peut pas confier à
des groupes d'experts, dont les contributions sont
évidemment nécessaires, le soin de dire quelles sont les
fins à considérer et comment les prendre en compte. La
participation de la société et la délibération politique sont
indispensables (voir encadré).
La troisième intention est qu'il faut tirer la leçon des
expériences existantes, en très grand nombre, c'est-à-dire
emprunter une démarche qui parte d'expériences de
terrain à discuter et partager.

Indicateur : la conception d'Amartya Sen
"Pour s'entendre sur des choix d'évaluation sociale (par
exemple dans le cas d'études sur la pauvreté), il est
nécessaire d'établir un consensus raisonné sur les poids
ou, au moins, sur une gamme de poids. Il s'agit là d'un
exercice de "choix social", qui exige un débat public et un
processus démocratique de compréhension et
d'acceptation", dans La liberté au prisme des capacités,
par Jean de Munck et Bénédicte Zimmermann (dir.), éd.
de l'EHESS, 2008, p. 59.
Ainsi que l'exprime Dominique Méda dans une tribune
publiée par Le Monde : "Si de nombreux économistes - et
les institutions publiques dans lesquelles ils exercent - se
sont le plus souvent déclarés réticents à la mise en place
de tels indicateurs, c'est parce qu'ils se heurtaient à la
question de savoir qui peut décider légitimement des
critères à prendre en considération pour déterminer ce
qu'est une "bonne" société ou pour qualifier ses
évolutions." Pourquoi par exemple ne pas recourir,
comme le suggère Patrick Viveret, un autre avocat de
cette réorientation, à des "conférences de citoyens",
parmi d'autres modalités de réflexion collective associant
des spécialistes des indicateurs et des porteurs
d'expertise citoyenne, dont des membres d'associations
et d'organisations non gouvernementales (ONG) ?
3. Quels indicateurs ?
Il est évidemment impossible, vu ce qui précède, de
répondre seul à une telle question. Mais on peut
contribuer à nourrir les débats en faisant un bilan réflexif
des indicateurs synthétiques existants. A savoir tous ceux
qui, fondés sur l'idée que les progrès à mesurer sont
multidimensionnels, n'en restent pas à des tableaux de
bord de multiples variables jugées essentielles (exemple :
des tableaux de bord du développement régional ou des
inégalités en France), mais s'appuient sur un effort
d'agrégation ou de moyenne conventionnelle de ces
variables en vue d'obtenir un chiffre de synthèse.
L'exemple le plus connu est l'IDH, l'indicateur de
développement humain. Il intègre trois variables : le PIB
par habitant, l'espérance de vie et un indice de niveau
d'instruction. Pourquoi les privilégier dans ce premier
bilan ? Pour trois raisons.
- La première est que la plupart des initiatives existantes
pour "remettre le PIB à sa place" utilisent ce type
d'indicateurs.
- La seconde est qu'il y a bien longtemps qu'existent des
tableaux de bord multicritères sociaux ou
environnementaux. Ils sont indispensables aux experts et
aux décideurs, mais ils n'ont jamais été suffisants pour
contrer la domination politique et médiatique du PIB. En
raison justement de leur éclatement et de leur complexité
face à un chiffre agrégé ayant un demi-siècle d'exercice
du pouvoir d'influence. Pour ne pas être en situation de
concurrence déloyale, les nouveaux indicateurs doivent
posséder le type de visibilité et de simplicité (apparente)
du PIB. Ils doivent eux aussi, comme le dit Bernard
Perret, devenir des "institutions".
- La troisième raison est pédagogique : l'expérience des
débats publics montre que les indicateurs synthétiques
ont un fort pouvoir d'attraction. Mais si la démocratie
fonctionne -on en revient à cette condition dans tous les
cas-, cette force n'est pas un obstacle à une délibération
informée sur leur construction, l'examen détaillé de leurs
composantes, leurs limites, etc.
Parmi les indicateurs synthétiques les plus connus, il
y a au départ deux grandes familles sous l'angle des
valeurs privilégiées.
- Les premiers s'intéressent en priorité aux dimensions
humaines et sociales : développement humain, santé ou
cohésion sociale... En France, le BIP 40, baromètre des
inégalités et de la pauvreté, qui intègre près de 60
variables, en fait partie.
- Les indicateurs de la deuxième famille expriment en
priorité des préoccupations écologiques. Exemple :
l'empreinte écologique, un indicateur qui mesure, en
hectares, la surface nécessaire à une population pour
répondre à sa consommation de ressources naturelles et
d'espace et à ses besoins d'absorption de déchets et
d'émissions.
Les sociétés ont un égal besoin d'indicateurs de ces
deux familles. Soit en les associant dans des indicateurs
mixtes (de bien-être durable, par exemple), soit en
disposant de mesures distinctes du progrès social et de
l'évolution des pressions humaines sur la nature. Des
choix stratégiques sont donc à mettre en débat.
4. Des méthodes concurrentes ou complémentaires
Les méthodes permettant de construire des indicateurs
synthétiques sont diverses.
- Certaines (l'IDH, le BIP 40) consistent à faire une
moyenne, simple ou pondérée, des diverses variables
retenues, après avoir "noté" chacune d'elles sur une
échelle commune, par exemple entre 0 et 1, ou 0 et 10.
- D'autres reposent sur la recherche d'une unité commune
de mesure, permettant de rendre commensurables des
variables qui ne le sont pas, de sorte que l'agrégation
prend alors la forme d'une somme.
La pratique la plus fréquente est celle du recours à la
monétarisation, qui est la méthode de construction du PIB
lui-même. On essaie alors d'évaluer, en équivalent
monnaie, aussi bien des contributions non monétaires au
bien-être, comme le bénévolat ou le travail domestique,
que des dommages environnementaux (comme les
émissions de CO2), voire l'évolution des inégalités ou du
chômage. C'est la méthode des "PIB verts", qui sont en
réalité des PIB corrigés par des facteurs sociaux et
environnementaux monétarisés.
Les indicateurs fondés sur la seconde méthode exigent
des conventions très délicates à construire. C'est
pourquoi les experts et les comptables nationaux sont
souvent réticents, mais les choses évoluent. Ils font aussi
l'objet de critiques de gauche ou écologistes, qui
dénoncent la monétarisation de tout, ou qui se méfient,
non sans raison, de leur opacité.
Les indicateurs basés sur les premières méthodes sont
plus faciles à interpréter et moins dépendants de
méthodes économiques de monétarisation, bien qu'ils
exigent eux aussi des conventions fortes (quelles
variables choisir ? comment les pondérer ?).
Mais l'intérêt potentiel des indicateurs monétarisés est
qu'on peut directement les confronter au PIB et dire, par
exemple, que les taux de croissance de l'économie
chinoise (ou de l'économie américaine...) devraient être
réduits d'un certain nombre de points si l'on tenait compte
des dommages collatéraux (les externalités négatives) sur
l'environnement ou de l'explosion des inégalités.
A côté de ces deux méthodes, il faut citer celle,
originale mais critiquée, de l'empreinte écologique.
Elle rend commensurables des pressions

environnementales hétérogènes en les convertissant en
superficies de la planète requises. C'est sur cette base
que l'on peut estimer que, si tous les habitants du monde
avaient le mode de consommation des Français, il
faudrait trois planètes pour y faire face, en tout cas sur la
base des technologies actuelles, polluantes et
dévoreuses de ressources naturelles. Citons aussi
l'indicateur de bien-être économique des Canadiens
Osberg et Sharpe, qui combine les deux méthodes de
monétarisation et de moyenne de plusieurs dimensions
du bien-être durable.
Enfin, on assiste actuellement à la montée en
puissance médiatique d'indicateurs de "bien-être
subjectif" ou de "satisfaction de vie". Ils sont obtenus
sur la base d'enquêtes où l'on pose aux gens la question :
"Etes-vous globalement satisfaits de la vie que vous
menez ?". Les réponses se situent sur une échelle (de 1 à
4, ou de 1 à 10), qui permettent ainsi des comparaisons
internationales ou des comparaisons dans le temps, bien
qu'avec d'énormes difficultés d'interprétation des données
(2). On peut aussi évaluer des inégalités de satisfaction
selon les groupes sociaux ou le revenu, selon le sexe,
selon les activités, etc.
Il y a donc matière à de beaux débats. L'essentiel
réside moins dans la confrontation technique des options
-qui a son importance- que dans la façon d'élargir le
cercle des parties prenantes. De nouveaux indicateurs ne
deviendront en effet des instruments efficaces pour
promouvoir d'autres fins que s'ils gagnent en légitimité
voire en "popularité".
Notes
(1) On assiste actuellement (voir le blog de jean Gadrey sur
www.alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/) à une
manœuvre semblable pour la mesure de la pauvreté, depuis
que Martin Hirsch a réalisé qu'il n'atteindrait pas son objectif (la
réduction d'un tiers du nombre de pauvres d'ici à 2012) s'il
conservait la mesure actuelle, pourtant utilisée partout en
Europe (voir page 36).
(2) Voir "Croissance, bien-être et développement durable",
Alternatives Economiques n° 266, févier 2008, ainsi que "La
croissance fait-elle le bonheur?", L'état de l'économie 2006,
hors-série n° 68 d'Alternatives Economiques, 2e trimestre 2006.
En savoir +
Le site de l'Idies : www.idies.org/index.php ?category/FAIR
Le site du réseau Pekea : http ://fr.pekea-fr.org/ ?p=8
L'empreinte écologique :
www.wwf.fr/s_informer/nos_missions/modes_de_vie_durabl
es/empreinte_ecologique
Qu'est-ce que la richesse ?, par Dominique Méda, éd.
Aubier, 1999, et éd. Flammarion, 2000 (réédition en mai
2008, avec une nouvelle préface, sous le titre Au-delà du
PIB).
Reconsidérer la richesse, par Patrick Viveret, éd. de l'Aube,
2005.
Les nouveaux indicateurs de richesse, par Jean Gadrey et
Florence Jany-Catrice, 2e éd. actualisée, éd. La
Découverte, 2007.
Le développement a-t-il un avenir ?, Attac, par Jean-Marie
Harribey (dir.), éd. Mille et une nuits, 2004.
"Indicateurs sociaux, état des lieux et perspectives", par
Bernard Perret, rapport pour le Cerc, 2002,
www.cerc.gouv.fr/doctrav/2002-01.pdf
Note de veille n° 91 du Centre d'analyse stratégique, février
2008, www.strategie.gouv.fr/article.php3 ?id_article=788
1
/
3
100%