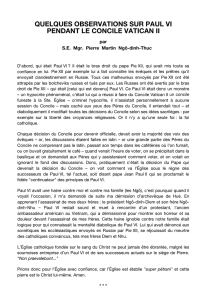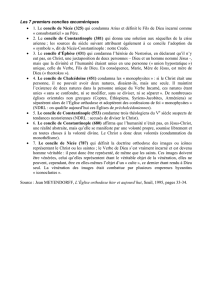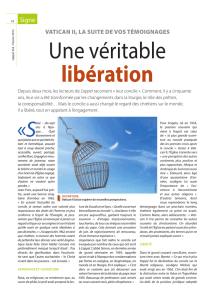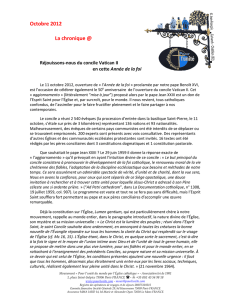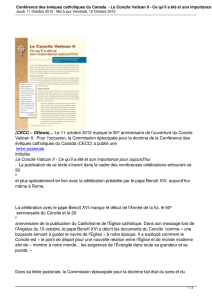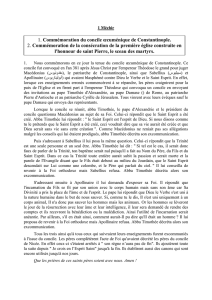Nicole Lemaitre

1
ReSET 2008-2009:
Nicole Lemaitre (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
La Réforme catholique : genèse, programme, modalités
d’application
Nous avons vu que l’idée de réforme est présente dans l’Église
depuis le début du XIVe siècle. Nous verrons premièrement qu’elle
est fondée au XVIe siècle sur un cléricalisme rénové, mais surtout
sur le concile de Trente, dont nous examinerons, deuxièmement les
principales conclusions. Nous verrons troisièmement les difficultés
de mise en application de ce concile et le rôle, considérable, de la
papauté à cet égard.
I Un cléricalisme rénové
On a beaucoup critiqué le clergé paillard, cumulard et trop
souvent absent de la fin du Moyen Age. Or il ne faut pas se laisser
prendre à ces critiques. Les paroisses marchaient fort bien sans
leur curé titulaire, car celui-ci devait obligatoirement se payer un
remplaçant, qui était un prêtre du pays, plus proche des fidèles. Le
problème réside dans l’image de la charge d’âme, rapportée au
Christ. Pour ce vieil idéal pastoral, né au VIIe siècle, et diffusé
encore dans les écrits du pape Grégoire le Grand, la charge
pastorale est “ l’art des arts ” et rien ne peut dépasser ce service
dans l’Église : la fonction de pasteur, qu’il soit curé, évêque ou
abbé, est un chemin de perfection. La priorité du concile est
d’imposer la résidence à ceux qui ont charge d’âmes. Le pasteur
doit en effet résider avec ses ouailles pour faire son métier, car on
ne peut donner un troupeau à un mercenaire. Le pasteur est
totalement assimilé au Bon Pasteur, c’est à dire au Christ lui-même,
il est responsable sur son propre salut du salut de ses fidèles.
Mais cet idéal se heurte depuis des siècles à une réalité
matérielle, qui est celle des revenus du clergé. Depuis l’époque
féodale, tout curé dispose d’un bénéfice (charge avec revenu). Mais
beaucoup de bénéfices ne permettent pas aux curés et évêques de
vivre correctement (certains tendent donc à accumuler les
bénéfices et sont donc absents) et surtout ce système ne permet
pas de former le clergé à sa tâche. Le problème de l’ignorance du
clergé est un thème récurrent depuis deux siècles. Or il y a

2
consensus pour estimer qu’on ne peut admettre à une telle charge
sans un examen sérieux des capacités du candidat à enseigner, à
administrer les sacrements, à vivre dans la piété.
II. Le concile de Trente
De 1545 à 1563, l’Église catholique a vécu un événement
exceptionnel qui l’a profondément transformée et dont les effets se
ressentent encore aujourd’hui. Cette réunion, par sa date, par sa
durée (18 ans) par ses décisions pose cependant problème à
l’historien : pourquoi une réunion si tardive, pourquoi cette
importance de son temps, pourquoi ses décisions ont-elles tenu si
longtemps ?
Luther voulait un concile, les humanistes également, mais le
pape Clément VII n’en voulait pas car le concile précédant, Latran
V, s’était achevé en 1517, parce que l’Europe était en guerre et
parce qu’il avait peur d’y perdre son pouvoir. Il faut attendre 1534
(pape Paul III) pour que la papauté s’intéresse au concile. Mais des
problèmes divers, logistiques et diplomatiques en particulier :
l’empereur Charles Quint était hostile au concile car il menait sa
propre politique de réconciliation, font que le concile n’a pu se
réunir qu’en 1545.Tout au long de sa réunion, la conjoncture restera
fragile. Le poids postérieur de ce concile masque des difficultés
sans nombre.
Le concile n’a jamais réuni les foules. Il commence avec 34
mitres et 42 théologiens (4% des prélats pouvant y siéger), mais
même au meilleur moment, en 1563, en 1562-1563, seuls 276
évêques et 17 abbés sont passés, sur environ 700 évêques en
fonction. Le fait est cependant ordinaire, compte tenu de la difficulté
des relations à l’époque préindustrielle.
La vraie menace pour le concile tenait pourtant aux
événements politiques, qui ont provoqué deux interruptions, entre
mars 1547 et mai 1551, en raison de la peste et de la mésentente
entre le pape et l’empereur, surtout après la paix d’Augsbourg. Si
depuis le dernier concile l’autorité du pape sur le concile a été
rétablie, la méfiance reste grande pourtant, aussi le pape ne
participe-il au concile que par légats interposés. Ces derniers, dont
plusieurs deviendront papes, ont su arbitrer entre les groupes
nationaux. Ils avaient en général l’appui du clergé italien, proche du
pape en raison de son pouvoir, mais c’était bien différent avec le
clergé espagnol, qui se distinguait par sa haute culture théologique.

3
Le clergé français était gallican, c’est-à-dire attaché aux privilèges
nationaux de la France et hostile à l’intrusion de la papauté dans
ses affaires. Le clergé allemand était enclin au compromis avec les
protestants. Pour tous, le Saint-Siège était responsable du
désastre, mais ils n’étaient pas d’accord entre eux.
La papauté a réussi à maîtriser la procédure du concile par
l’intermédiaire de ses légats, qui présidaient et mettaient donc les
questions à l’ordre du jour. Dès le début, il est décidé que le vote
n’appartiendra qu’aux évêques et supérieurs d’ordre (ni les
théologiens, ni les laïcs). Les sujets sont d’abord discutés en
congrégation particulière, une libre discussion entre les théologiens
et les canonistes, en présence des pères. Puis les pères se
réunissent en congrégation générale. Ils discutent librement et
élaborent des textes successifs. Lorsque l’accord le plus large
possible est obtenu, le vote est conduit lors d’une session
solennelle. Le but de cette procédure est la recherche du
consensus le plus large possible et non d’une majorité, c’est
pourquoi certaines questions, très discutées, ne feront jamais l’objet
d’un décret.
La discussion est menée le plus souvent sur catalogue
d’erreurs, elle est donc orientée vers la controverse. Elle débouche
à la fois sur des décisions doctrinales et sur des décisions pratiques
; le concile a travaillé les deux aspects en parallèle de la première à
la dernière session, c’est la preuve d’un équilibre relatif du concile
par rapport au pape. En dépit de quelques ambiguïtés, le concile a
eu un succès certain. Le catholicisme s’y exprime par des vérités
nettes contre les positions protestantes, mais il crée aussi ses
propres réponses aux angoisses du moment.
1 Les décisions : Une définition moderne des dogmes
Le concile commence donc par définir des dogmes, des vérités
dont on peut vérifier l’enseignement et la connaissance. Il faut
rappeler qu’un dogme, du grec “ sembler bon, paraître juste ”
exprime pour les catholiques une vérité considérée comme
irréformable. Il est la parole de Dieu exprimée dans des mots
humains (on peut donc changer les mots, à condition de ne pas en
changer le fondement). Ces réponses dépendent largement des
protestants car les discussions suivent des catalogues d’erreurs
tirées des oeuvres de Luther, Melanchthon, Calvin, erreurs qui sont
anathématisées, c’est à dire vouées au diable. La formule est

4
choquante pour nous, mais la violence est identique de l’autre côté.
Chemin faisant, les catholiques trouvent aussi des solutions
originales.
Un fait ne trompe pas, comme dans la Réforme protestante, les
textes de l’Écriture sont placés à la base des travaux du concile,
dès la 4e session, le 8 avril 1546, très tôt après l’ouverture, ce qui
est la preuve d’un consensus. Avant de s’occuper des dogmes, le
concile a donc voulu s’occuper de leur fondement, définir les
sources qui permettent de construire la foi. Le légat Marcel Cervini
pose qu’il y a trois sources : les livres saints ; les paroles du Christ
gardées en mémoire dans les communautés, l’action du Saint
Esprit qui interprète les Ecritures en permanence. Les deux
premières questions seront seules traitées par le concile, mais elles
font l’essentiel de l’originalité catholique : l’Evangile est transmis par
écrit et par oral ; il vient de plusieurs sources mais toutes sous
l’inspiration de l’Esprit Saint et conservées par l’Église au moyen
d’une succession continue.
Le concile donne la liste des livres qui sont acceptés, en fait
ceux qui avaient été admis au concile de Florence, en 1439, à la
suite des discussions avec les grecs et lors de la réunion des
Arméniens. Le concile se révèle un bon disciple de la méthode
humaniste : établir une opinion sur les textes eux-mêmes et non
pas sur des constructions logiques. A partir de ce point de départ
scripturaire, liturgique ou patristique, les dogmes en cause dans
l’explosion réformée sont repris par les théologiens. On examine
d’abord la question du péché originel.
Le concile reprend les décisions du concile d’Orange (529),
fondées sur une exégèse parmi d’autres de Rm 5,12, pour dire que
le péché originel s’est transmis à toute la race d’Adam. Pour les
pères de Trente, si les hommes ont perdu en Adam la sainteté
automatique qu’ils étaient sur le point d’acquérir, les forces de la
nature sont amoindries et non perdues. Il suffit de les réveiller avec
l’aide du Christ. Le concile reprend à cet égard, sans le dire, la
position d’Érasme, qui avait rompu justement sur ce point avec
Luther, lors de la querelle du serf et du libre arbitre, en 1523-1524.
Le complément naturel de ces positions du concile est le décret
sur la Justification, voté quelques mois plus tard, le 13 janvier 1547.
Pour les protestants, la foi sauve sans les oeuvres. Mais les
catholiques rechignent à admettre que l’homme est sauvé en
dehors de lui-même. Le concile pourtant est divisé. Le légat

5
Seripando, par exemple, est favorable au salut par la foi seule,
prôné par les protestants. Le chapitre 5 insiste sur le fait que si
dans la justification Dieu a l’initiative, l’homme ne reste pas inactif ;
il répond librement en acceptant et en recevant l’inspiration de Dieu,
la grâce toujours offerte. Il vit ainsi selon l’Esprit et se libère en se
tournant vers Dieu. Contre Luther, les chapitres 9 à 11 affirment
que la justification est “ le début d’un renouvellement de jour en
jour, qui fait que celui qui est juste sera encore justifié ”. Le juste est
donc imparfait mais ami de Dieu. Le concile affirme ainsi la valeur
du temps, la capacité de l’homme à progresser. Mieux même,
l’homme accomplit des oeuvres méritoires avec l’aide du Christ, qui
accompagne ses efforts en lui communiquant sa propre force. Le
concile reconnaît donc une valeur aux actes humains, il insiste sur
l’entraînement nécessaire, sur la pédagogie de Dieu.
2 Un souci pastoral dans la définition des pratiques
Deux jours après le vote du décret sur la justification, la
question des sacrements est mise au programme. Les experts
théologiens consultés dressent à partir des oeuvres des grands
auteurs protestants une liste de 35 erreurs, dont la moitié sur la
notion même de sacrement. Le décret condamne donc tout ce qui
dans les recherches récentes allait contre les usages catholiques
romains.
Les protestants avaient choisi de ne conserver que les
sacrements formellement attestés dans la Bible. Les pères
conciliaires décident de conserver le septenaire servant de base à
la catéchèse et mis en valeur par les grands auteurs de la
scolastique, Pierre Lombard et Thomas d’Aquin. La définition du
sacrement suit celle de saint Augustin : signe visible d’une réalité
(la grâce) invisible, qui conserve à la fois l’idée de mystère, issue de
la traduction du grec et celle de rite symbolique.
Une suite de canons dresse une plate-forme systématique des
sacrements. Un premier décret est voté sur l’Eucharistie. Face aux
protestants, les pères conciliaires sont soucieux de défendre la
Présence réelle du Christ dans le pain et le vin et de dire comment
cette présence est assurée. Pour les catholiques, le Christ est
présent tout entier dans le pain et tout entier dans le vin. Pour
expliquer les modalités de la transformation au cours de la
consécration, le concile utilise le mot de transsubstantiation, que la
scholastique avait créé pour dire le passage d’une substance à une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%