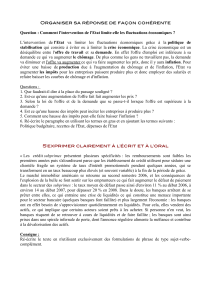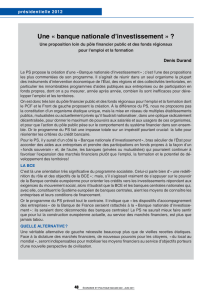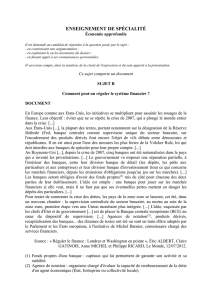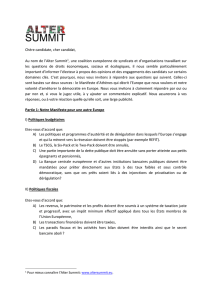imedia 9330

Est-il encore temps d'éviter la dépression
mondiale ?
Par Jean-Hervé Lorenzi LE MONDE du 21.03.08
ça y est, on y est. Sans même réellement s'en apercevoir,
on est en train de franchir les étapes qui nous mènent à une
vraie crise financière. Et pourtant, on ne peut pas dire que
les banques centrales aient été inactives : baisse des taux
d'intérêt, mise à disposition de masses énormes de liquidités
pour que les besoins de financement des banques et donc
de l'économie continuent à être couverts.
Le problème est que les banques centrales se heurtent à
deux difficultés majeures. La première, c'est que tout le
monde, quasiment sans exception, manque et de lucidité et
de franchise, si bien que beaucoup d'acteurs font comme si
de rien n'était. Et puis, le système financier mondial n'est pas
confronté exclusivement à un problème de liquidités mais
surtout à un problème de fonds propres des banques.
Pour schématiser : le système bancaire est obligé de
reprendre – en les dépréciant parce qu'ils risquent fort de ne
pas être remboursés – une large partie des crédits qu'il avait
"titrisés", c'est-à-dire revendus à des entreprises spécialisées
qui les plaçaient sur les marchés sous forme de valeurs
mobilières; et cette contrainte va l'amener à resserrer sa
politique de crédit.
A grande crise, grands moyens
Tout cela conduit à défendre l'idée suivante : si l'on veut
éviter le pire, c'est-à-dire une vraie phase de dépression
économique aux Etats-Unis et en Europe, il faut employer les
grands moyens. Les grands moyens, c'est très facile à
concevoir sur le papier et très compliqué à mettre en œuvre
dans la réalité.
Cela consisterait à autoriser le système bancaire à étaler
dans le temps ses reprises et ses dépréciations. Cela
consisterait également à créer de grands instruments
vraisemblablement publics qui récupéreraient une large
partie de ces fameux actifs dépréciés et qui les
cantonneraient en se donnant ainsi le temps et les moyens
de mutualiser les pertes et de les étaler sur une longue
période. Ce ne serait pas la première fois que l'on
procéderait ainsi. Toute crise financière suppose à un
moment de prendre en charge collectivement les pertes.
Reste que plus l'on attend, plus cela coûte cher.
Mais analysons tout cela de plus près. Comme l'économiste
américain Barry Eichengreen le soulignait récemment, il y a
une sorte de nostalgie des temps passés, quand les banques
jouaient un simple rôle d'intermédiation en prêtant de
manière tout à fait raisonnable à des ménages et à des
entreprises, et cela, dans le cadre de bilans parfaitement
transparents et ajustés. Il suffirait donc de revenir au temps
heureux où la titrisation n'existait pas, ou alors, autre version
de la même approche, d'établir une régulation forte et
définitive du système bancaire qui nous ramène à la période
bénie des années 1960. Et c'est sûrement là l'une des
tentations les plus fortes qu'ont aujourd'hui les autorités
financières américaines et européennes.
Un mode de financement global
En réalité, le problème est beaucoup plus complexe, car la
titrisation fait désormais partie d'un mode de financement
global de l'économie mondiale dont elle n'est qu'un élément
parmi d'autres et qui a dans l'ensemble joué un rôle positif.
En fait, la titrisation n'est en aucune manière un objet isolé.
Elle va de pair avec la déréglementation des marchés
financiers, qui a stimulé la création de nouveaux produits et
permis aux établissements autrefois spécialisés d'exercer
tous les métiers de la finance; elle participe d'un
environnement de dématérialisation totale des flux de
capitaux à l'échelle mondiale; enfin, elle résulte des
nouvelles formes de régulation bancaire : les normes
"prudentielles", définies à l'échelon international pour assurer
la solidité des établissements de crédit, les obligent à avoir
assez de fonds propres pour couvrir une certaine proportion
des sommes qu'ils prêtent. Or, en "titrisant" leurs créances,
les banques les faisaient sortir de leur bilan et n'avaient pas
à augmenter leurs fonds propres en proportion.
Cela a eu pour résultat l'explosion des titrisations : elles ont
augmenté de 150% en dix ans. Notamment, pour les asset
based securities (titres basés sur des actifs), la variété la
plus répandue de titrisations, les encours ont plus que
doublé, passant de 1072 milliards de dollars en 2000 à 2238
milliards en 2007. Les chiffres évoqués ici concernent les
Etats-Unis, mais se retrouvent à un degré moindre, très
significatif cependant, en Europe. Ce qui est stupéfiant, c'est
l'accélération du mouvement à partir de 2001, associé à la
détérioration rapide du déficit commercial américain.
Faut-il pour autant le vouer aux gémonies, ce mouvement,
comme cela pourrait être le cas ? Bien sûr que non. Le fait
que les banques puissent sortir de leur bilan une partie des
crédits a joué un rôle majeur dans cette économie de
l'endettement porteuse de croissance mondiale. Jamais le
déficit commercial américain n'eut été financé si l'on n'avait
utilisé cette capacité de disperser les créances bancaires un
peu partout à travers le monde. Jamais de nombreux
financements, certes risqués, mais créateurs de valeur
n'eussent pu avoir lieu si l'on n'avait eu cette capacité de
décomposer et de répartir le risque. En réalité, il ne pouvait y
avoir des transferts massifs d'épargne, constituée dans
certaines parties du monde et investie ailleurs, sans cette
innovation financière, ce qui est la version favorable de la
mondialisation.
Ne nous trompons pas, ce moment de l'histoire financière
mondiale ne s'arrêtera pas de sitôt, du moins tant que les
niveaux de développement respectifs des grandes zones
mondiales et leurs évolutions démographiques rendront
nécessaires et souhaitables ces flux financiers. La question
n'est donc pas de remettre en cause ces mécanismes mais
de constater qu'ils ont été utilisés de manière excessive.
L'emballement de tout un système
Ces mécanismes de titrisation ont été détournés de leur
véritable objectif, qui consistait à subdiviser un type de risque
– les crédits immobiliers – pour répondre à une logique
fondamentale du système bancaire : avoir en permanence
une bonne gestion actif/passif (c'est-à-dire un équilibre entre
le montant des engagements et les capitaux propres). Le
mot-clé est l'excès : dans les cinq dernières années, on a
assisté à l'emballement d'un système incontrôlé. On a
beaucoup parlé de l'incroyable extension du crédit aux Etats-
Unis, mais le mécanisme concerne aussi l'explosion des
fusions-acquisitions : ces cinq dernières années ont été la
période de toutes les folies, marquée par les dérives de la
titrisation sous toutes ses formes.
En réalité, la titrisation a échappé aux directions financières
des banques pour passer subrepticement sous le contrôle
des salles de marché à la recherche de très forts rendements
espérés. Rappelons-le, la titrisation consiste à sortir des
actifs du patrimoine d'une institution, en les cédant sous
forme de valeurs mobilières. Un véhicule ad hoc est créé –
un Special Investment Vehicle (SIV), également appelé
"conduit" – auquel les actifs sont cédés. Ce véhicule émet les
titres et perçoit les flux de trésorerie générés par les actifs
sous-jacents et les reverse aux investisseurs (paiement des
intérêts et remboursement des titres).
En observant les mécanismes mis en œuvre, on s'aperçoit
que les banques sont très souvent intervenues à tous les
niveaux des opérations. Non seulement elles cédaient leurs

créances, mais elles créaient parfois les entités qui les leur
rachetaient (les SIV) et, dans ce cas, en montaient le
financement; et ce sont elles aussi qui organisaient les
émissions d'obligations correspondant à ces mêmes
créances. C'est cette imbrication qui rend l'écheveau si
difficile à dénouer.
Dans les faits, la titrisation a péché de deux manières.
D'abord parce qu'on a exagéré le refinancement des dettes à
long terme par des actifs à court terme, mais surtout parce
qu'on a créé des conduits qui "titrisaient la titrisation" : ces
produits dérivés comportaient des palettes de risques très
diversifiés et étaient financés par l'endettement. C'est là la
principale dérive du système : rajouter un endettement qui a
pour seul objectif d'améliorer le rendement. La logique même
du rôle du banquier prêteur est transgressée. Risques sur
risques n'a jamais conduit à un financement sain d'une
économie mondiale en pleine ébullition.
Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. L'une des sources
des difficultés présentes et à venir est le fait que les banques
de financement et d'investissement ne se sont absolument
pas préparées à l'existence sérieuse d'un marché secondaire
où s'échangent des titres fondés sur des créances. Il n'y a en
fait aujourd'hui aucun des instruments qui permettraient le
bon fonctionnement de ce marché. On est placé dans une
situation absurde, et extrêmement dangereuse, où
l'investisseur est censé conserver ses titres jusqu'à
l'extinction de la créance, alors qu'un marché, pour bien
fonctionner, doit être animé et liquide.
Le résultat de ces excès, de ces risques inutiles, de ces
erreurs de conception, ne s'est pas fait attendre. Un monde
sans liquidités organisées fait peur et crée ce qui est le cœur
de toute crise financière, c'est-à-dire la perte de confiance.
Celle-ci a touché toutes les formes de titrisations bien au-
delà du premier choc de l'été 2007 et de la crise des
subprimes. Les cours des émissions ont fortement baissé
pour la raison simple que personne n'est capable d'évaluer
les risques de ces titrisations, donc de formuler un prix
raisonnable, d'autant que tous ces produits ne peuvent être
réellement négociés sur le marché. Là se trouve, pour une
large part, l'origine des formidables pertes des grandes
banques américaines.
Jusqu'où tout cela ira-t-il ?
A une évolution cyclique classique de l'immobilier, qui aurait
simplement ralenti la croissance américaine, britannique et
espagnole, est venu se surajouter un dérèglement financier
dont les conséquences pourraient être beaucoup plus graves
et qui touche au premier chef les principaux bénéficiaires des
cinq dernières années, les banques et les grands fonds
spéculatifs. C'est ce qui explique que les primes de risques
des banques se soient nettement plus dégradées que celles
des sociétés industrielles. Mais les primes de risque ont
augmenté, tous marchés et secteurs confondus, et
continueront à le faire car elles intègrent désormais une
perspective de récession macro-économique, et donc des
taux de défaut supérieurs à ceux qui sont constatés
aujourd'hui.
Jusqu'où tout cela pourrait-il aller ? Malheureusement on ne
peut écarter une crise bancaire majeure, qui entraînera deux
phénomènes : la réorganisation très rapide et violente des
bilans des entreprises financières et le ralentissement, si ce
n'est la disparition, de la titrisation. L'un et l'autre ont des
implications très fortes, qui peuvent conduire à un relatif
assèchement du crédit et donc au renchérissement de son
coût. C'est sur ces deux points que doivent porter les efforts
d'analyse et de réaction des autorités financières mondiales.
Faut-il le rappeler une nouvelle fois ? La titrisation est
essentielle dans le fonctionnement d'une économie de crédit
qui, elle, permet à l'économie mondiale de se développer.
Dire cela, c'est rappeler que le choc sera double puisque les
banques, non seulement y perdent un instrument de crédit
mais par ailleurs, ayant à conserver ou à reprendre
l'essentiel de ces titres dépréciés dans leur bilan, vont avoir
des besoins massifs de fonds propres et des politiques de
crédit évidemment beaucoup plus restrictives. Parler de cela
au futur est d'ailleurs inapproprié car ce scénario d'une crise
est déjà en train de se mettre en place.
Ainsi à la crise immobilière, qui en elle-même n'a rien de
gravissime, d'autant qu'elle touche moins l'Europe que les
Etats-Unis, s'ajoutent les éléments d'une crise financière
systémique et mondiale, fondée sur un bouleversement des
conditions de crédits bancaires et une baisse du prix des
actifs, qu'il s'agisse des actions ou de l'immobilier. Chaque
jour qui passe nous apporte la confirmation des risques
encourus.
La tâche des banques centrales
Le pire n'est jamais sûr et rien n'interdit d'imaginer, comme
ce fut déjà le cas dans des circonstances analogues, des
politiques imaginatives et audacieuses. Mais le temps
presse. Le principal atout que nous ayons aujourd'hui pour
sortir de cette situation est la réactivité des banques
centrales.
Deux remarques sur ce sujet. Leur efficacité repose sur leur
crédibilité et cette exigence permet d'exonérer la Banque
centrale européenne (BCE) d'un procès à charge trop
rapidement mené, notamment en France. Les banques
centrales ont eu globalement trois mérites : travailler de
manière coopérative, injecter des liquidités et suivre de très
près l'état de leur système financier. La Réserve fédérale
américaine (FED) et la Bank of England ont ajouté à cela une
politique très active des taux directeurs. La BCE fera de
même dans les mois à venir, si elle porte son regard au-delà
de l'augmentation de la masse monétaire et des indicateurs
de hausse des prix.
Certes, les risques d'inflation en Europe peuvent inquiéter,
mais ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. La BCE a
surtout à éviter une glissade brutale du dollar. Tout le monde
est conscient de la hiérarchie des problèmes et c'est la
raison pour laquelle le moment est venu de baisser les taux
directeurs de la BCE même si ce n'est en rien une solution
miracle.
A ces remarques-là près, le diagnostic des banques
centrales a été rapide, juste et suivi d'effet. Dans une crise
du marché interbancaire, elles ont su éviter aux Etats-Unis la
faillite des banques hypothécaires et permettre à des
grandes banques, en véritable danger, de réintégrer, sans
risque de liquidités, une partie de leurs produits titrisés.

Il faut sauver le système financier malgré lui
Par Daniel Cohen, professeur d'économie à l'Ecole normale
supérieure et à Paris-I, et éditorialiste au "Monde
Propos recueillis par Alain Faujas LE MONDE du 19.03.08
Avant de devenir professeur d'économie à l'Ecole normale
supérieure et à Paris-I, Daniel Cohen a étudié, notamment à
Harvard (Etats-Unis), les problèmes de dette dans les pays
en développement et les crises financières internationales.
M. Cohen, éditorialiste au "Monde", explique la difficulté de
résoudre celle qui est actuellement à l'œuvre.
Pourquoi assiste-t-on à une aggravation de la crise
financière depuis deux jours ?
La cause immédiate en est le rachat par JPMorgan de la
banque d'affaires Bear Stearns quasiment pour un "franc
symbolique". Personne n'imaginait que la situation était
grave au point que le paralytique doive racheter l'aveugle! En
tout cas, cela met en lumière le fait que la Réserve fédérale
américaine [Fed] n'a pas les outils adaptés pour faire face.
La crise s'est installée en trois temps. Premier temps, tout le
monde a cru que l'affaire des subprimes américains avait
déclenché une crise de liquidité.
Deuxième temps, derrière les notes triple A des agences de
notation, on a découvert des actifs vraiment insolvables et
des maquillages qui représentent autant d'escroqueries
morales et financières. De quelques dizaines de milliards de
dollars, les dégâts sont passés à 200 ou 300 milliards de
dollars [127 ou 190 milliards d'euros] dans les comptes des
établissements ayant acheté ces subprimes. La crise est
devenue une crise de solvabilité.
Troisième temps, l'ensemble du marché hypothécaire
américain est maintenant touché, car les prêts à risque ne
sont plus les seuls concernés.
Sous l'effet de la baisse des taux, les actifs avaient pris de la
valeur et généré des plus-values immobilières, déclenchant
un phénomène de bulle et de richesse qui poussait la
consommation.
Désormais le système américain fonctionne en sens inverse,
c'est-à-dire que les ménages constatent que leur dette
excède le prix de leur maison; ils rendent les clés à leur
banque et stoppent leurs remboursements. Et le château de
cartes s'effondre.
Une aversion au risque s'installe. Les banques ne se font
plus confiance entre elles. Le coût du financement se durcit,
parce que le crédit devient plus difficile à obtenir et non parce
que les taux augmentent. La défiance engendre la défiance
et le système financier s'installe dans un cercle vicieux.
Pourquoi les banques centrales ne sont-elles pas
parvenues à l'éviter ?
Dans la phase un de la crise, elles ont injecté des liquidités.
Dans la phase deux, la Fed a baissé ses taux, ce qui permet
une recapitalisation des établissements, mais trop lente.
Voici que, comme lors de la crise de 1929, la Fed ressort des
instruments non bancaires et s'autorise même à prendre en
pension des actifs risqués! En fait, la bonne solution
consisterait à faire ce que l'on a fait en France avec le Crédit
lyonnais. On a séparé le bon grain de l'ivraie, les vrais actifs
des insolvables, avant de recapitaliser.
Mais il est inconcevable de recapitaliser la totalité du
système financier malade : cela nécessiterait des sommes
considérables.
Quelle thérapeutique serait efficace ?
Restaurer la solvabilité des ménages est inadapté et les
banques centrales font la preuve qu'elles n'ont pas les
moyens de traiter le problème. Il faut donc faire sauter les
barrières intellectuelles.
Le G7 doit s'interroger pour savoir s'il faut laisser mourir les
banques ou les sauver, si c'est à la puissance publique de
recapitaliser les banques et comment. Il faut que le G7 ait le
culot de créer un fond public de réserve pour se porter au
secours des établissements en difficulté.
Sinon, il faudra reconnaître que les seuls sauveurs possibles
sont les fonds souverains et qu'on est passé à une nouvelle
étape de la mondialisation qui ne concerne plus la
libéralisation du textile par exemple, mais la libéralisation des
liquidités. S'interdire de réfléchir à ces solutions atypiques
conduirait à laisser la crise s'aggraver, car le système ne
pourra s'en tirer seul.
A quelles réformes les banques doivent-elles
s'astreindre pour éviter la répétition de cette crise ?
On savait depuis la crise de 1929 qu'il n'était pas une bonne
chose que les banques d'affaires soient mariées avec les
banques de dépôt. Les aléas des investissements à risque
peuvent polluer les prêts aux entreprises et aux particuliers.
N'est-il pas paradoxal de vivre aujourd'hui une crise
financière, alors que l'économie réelle mondiale est en bonne
santé ? Il faut donc sauver le système financier contre lui-
même et revenir à une séparation entre banques d'affaires et
banques de dépôt.
La possible baisse des taux de la Fed vous semble-t-elle
inutile ?
Elle laisse entière la menace de stagflation qui pèse sur
l'économie américaine. Car l'inflation par les cours des
matières premières semble devoir se poursuivre, alors que le
refroidissement est à l'œuvre.
Normalement, le ralentissement de l'économie des Etats-
Unis devrait faire baisser ces produits de base. Si tel n'était
pas le cas, cela prouverait que la banque centrale a perdu sa
crédibilité auprès des marchés, et ce serait vraiment très,
très grave pour tour le monde.

Le rôle des croyances collectives
dans la crise financière
Par Didier Marteau, professeur à l'ESCP
et conseiller Aon France
LE MONDE ECONOMIE du 19.03.08
La crise des subprimes a toutes les dimensions d'une
prophétie auto-réalisatrice. Comment expliquer autrement
qu'un choc sur un compartiment particulier du marché
hypothécaire américain se soit transformé en quelques
semaines en une crise financière majeure affectant le
marché international du crédit, des actions et des taux
d'intérêt ?
Le marché des subprimes ne représente après tout que 12 %
du marché hypothécaire américain, soit 1 200 milliards de
dollars (780 milliards d'euros), sur lesquels un défaut de 20
% des emprunteurs, associé à un taux de recouvrement de
60 % (car, en cas de non-remboursement du prêt, les
banques vendent la maison hypothéquée), n'entraîne qu'une
perte de 96 milliards, soit un montant proche des provisions
annoncées par l'ensemble des banques pour l'année 2008
(un peu plus de 120 milliards).
Une telle perte est donc clairement supportable à l'échelle
mondiale (une variation de 1 % de l'indice Dow Jones, dont
la capitalisation boursière est de 20 000 milliards de dollars -
13 011 milliards d'euros -, représente 200 milliards de
dollar)... tant qu'elle ne remet pas en cause la représentation
de la valeur de l'ensemble des actifs par les agents
économiques !
Or la véritable origine de la crise que nous traversons est
précisément là, dans une révision en cascade de la
valorisation des actifs détenus en portefeuille, valorisation
très fragile, car soumise aux rumeurs, aux humeurs, aux
publications d'indicateurs économiques et aux fragiles
évaluations des agences de notation...
Le prix de marché d'un actif, qu'il s'agisse d'un crédit, d'une
action ou d'une obligation, n'est en effet que la traduction, à
un instant donné, d'une croyance collective dans l'estimation
de sa valeur. Et les variations de ce prix ne sont que
l'expression de la modification de la croyance collective.
L'économiste John Maynard Keynes avait eu le premier cette
intuition essentielle pour comprendre la crise, lorsqu'il
comparaît les marchés financiers à un concours de beauté
(beauty contest) : celui qui veut voter pour la femme qui va
être élue ne doit pas voter pour la plus belle, mais pour celle
qui va être choisie par les membres du jury...
Ainsi peut-on comprendre la défiance collective à l'égard de
la valorisation des portefeuilles de crédits lors de l'annonce,
en juin 2007, de la fermeture de deux fonds hypothécaires
par Bear Stearns. Sans connaître le détail de l'opération, les
opérateurs ont anticipé un mouvement de panique du
marché, contre lequel ils se sont protégés en cédant une
partie de leur portefeuille, déclenchant ainsi le mouvement
redouté... Le doute a alors été jeté sur la valorisation de
l'ensemble des portefeuilles de crédits hypothécaires,
amplifié par l'opacité associée aux mécanismes de titrisation.
Les crédits subprimes octroyés par les banques sont en effet
à 80 % cédés à des structures dédiées (special purpose
vehicle) qui, pour les financer, émettent des obligations
(residential mortgage backed securities) achetées par des
investisseurs à la recherche de rendements élevés ou de
diversification de leur portefeuille. Ces obligations sont elles-
mêmes négociables et achetées par d'autres structures,
appelées CDO (collateralized debt obligations), qui émettent
à leur tour des obligations. Ces dernières obligations sont
également négociables et achetées par des structures
appelées CDO2, le mécanisme pouvant se reproduire à
l'infini.
Les opérateurs de marché ne connaissant pas l'identité des
porteurs de risque, parmi lesquels des banques, des
compagnies d'assurances, des fonds, voire des entreprises,
ont commencé début août à ne plus engager d'opérations de
prêt interbancaire, asséchant le marché monétaire et
obligeant les banques centrales à intervenir pour apporter la
liquidité bancaire indispensable au fonctionnement de
l'activité de crédit et, de manière générale, au
fonctionnement de l'économie.
La crise du marché monétaire n'est donc que l'expression
d'une crise de confiance déclenchée par une révision de la
croyance collective dans la valorisation des actifs de crédit
détenus par les banques. Elle ne serait probablement pas
produite si les crédits avaient été conservés dans le
portefeuille des émetteurs primaires.
L'incertitude sur l'identité des banques exposées au risque
subprime s'est traduite parallèlement par une crise des
valeurs bancaires, dont le cours de marché a chuté en plein
mois d'août 2007, sous l'effet autoréalisateur de ventes dont
le seul motif est l'anticipation de la vente par les autres
acteurs du marché. Les croyances collectives se sont alors
effondrées, l'hypothèse soudaine d'une sous-évaluation
générale du risque de crédit, y compris à l'égard des
entreprises, déclenchant une chute d'une exceptionnelle
amplitude du marché des actions (- 18 % entre octobre 2007
et février 2008).
On assiste alors au retour sur la scène théorique de la thèse
de l'effet richesse, développée par l'économiste italo-
américain Franco Modigliani, selon laquelle une révision à la
baisse du patrimoine entraîne une réduction des dépenses
de consommation et donc de la croissance économique. La
"croyance" dans ce modèle, ajoutée à la crainte du spectre
de la crise de 1929, porte elle-même le germe de
comportements auto-réalisateurs, incitant les agents
économiques à réduire leurs dépenses de consommation.
La crise que nous traversons est donc plus grave qu'une
crise des subprimes, car elle touche l'ensemble des marchés
et interroge tous les acteurs de la chaîne de l'évaluation -
opérateurs de marché, analystes-crédit, agences de notation,
cabinets d'audit, voire instances comptables : la mise en
application des nouvelles normes internationales
d'information financière IFRS (International Financial
Reporting Standards), en étendant l'évaluation des positions
financières au prix de marché, a amplifié inévitablement la
volatilité des résultats et des cours.
Ce diagnostic plaide aussi pour une autre régulation de la
crise, une régulation par la parole, ne reposant pas
exclusivement sur la baisse des taux d'intérêt directeurs des
banques centrales, mais sur un discours pédagogique et
crédible de retour à la confiance, nouvelle matière première
de l'économie.

Subprimes, marchés, inflation :
retour sur un enchaînement
Par Claire Gatinois et Anne Michel
LE MONDE du 21.03.08
A l'été 2007, lorsque deux fonds spéculatifs de la banque
américaine Bear Stearns menacent de faire faillite, personne
à Wall Street ne se doute que sept mois plus tard, la finance
mondiale sera plongée dans l'une des plus graves crises de
son histoire. Une crise dont Alan Greenspan, l'ancien
gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed), dit
aujourd'hui qu'elle "sera la plus grave depuis la fin de la
seconde guerre mondiale". Comment en est-on arrivé là ?
L'étincelle des subprimes. Les fonds spéculatifs de Bear
Stearns ont plongé à cause de crédits "subprimes", des
produits dérivés de prêts immobiliers à risque dans lesquels
ils avaient massivement investi. Des millions de ménages
américains modestes ont souscrit ces emprunts à taux
variables, gagés sur la valeur des biens immobiliers pour un
montant total de 1 200 milliards de dollars. Ces prêts ont été
accordés par des sociétés de crédit hypothécaire avides de
profits, peu regardantes sur la solvabilité des ménages.
Lorsque les prix de l'immobilier se sont effondrés et que les
taux d'intérêt ont grimpé, ces ménages ont été étranglés par
les dettes. Entre-temps, les crédits subprimes ont été
transformés (titrisés) en produits financiers complexes
rachetés par les banques du monde entier. Le risque, que
l'on croyait disparu, s'est ainsi retrouvé disséminé un peu
partout. Après les fonds de Bear Stearns, les grands noms
de la finance internationale, comme Merrill Lynch ou Morgan
Stanley, sont ainsi touchés.
L'embrasement des banques. La crainte des subprimes se
transforme en psychose. Les banques se soupçonnent les
unes les autres de camoufler des subprimes. Les
investisseurs redoutent qu'un établissement majeur ne soit
gravement touché. Le nom de Citigroup, première banque
des Etats-Unis, circule.
Ces soupçons seront confirmés, et même au-delà : Citigroup
annoncera au total 21 milliards de dollars de dépréciation
d'actifs. D'autres banques aussi prestigieuses seront aussi
touchées. La facture des subprimes s'élève à ce jour à 150
milliards de dollars. Jusqu'où ira-t-on ? Le 14 mars, Bear
Stearns est menacée de faillite. La Réserve fédérale décide
d'intervenir, en facilitant son rachat par l'un de ses
concurrents, JP Morgan, pour seulement 236 millions de
dollars.
La panique des marchés. Depuis l'apparition des
subprimes, les investisseurs sont de plus en plus nerveux.
Sur les marchés interbancaires, les banques refusent de se
prêter de l'argent. Certaines, comme la britannique Northern
Rock en septembre, se retrouvent asphyxiées. Cette
défiance se reflète sur les marchés d'actions, où les
investisseurs redoutent la contagion aux banques
européennes et asiatiques. Ils cèdent à la panique le 21
janvier, à l'annonce de nouvelles dépréciations. Les
principales places boursières d'Europe et d'Asie plongent. La
Bourse de New York, fermée, échappe au pire. Et le krach
est évité grâce à l'action des autorités monétaires, de la
Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale
européenne (BCE) principalement. Elles injectent
massivement les liquidités qui font défaut aux banques. La
Fed, en complément, réduit drastiquement ses taux
directeurs de 0,75 point. Elle ira plus loin pour relancer
l'économie américaine et rassurer les marchés. Au total, les
taux américains passeront de 5,25 % avant l'été 2007 à 2,25
% fin mars 2008.
Cependant, l'action de la Réserve fédérale américaine
contribue à faire plonger le dollar sans juguler tout à fait la
défiance envers les banques. Et si le marché d'actions
surnage, les investisseurs lui préfèrent les matières
premières (pétrole, or, blé...) considérées comme des
valeurs refuges. Leurs prix flambent.
La crise dépasse alors clairement le cadre financier,
l'envolée de ces prix affecte directement les industriels et les
consommateurs tout en stimulant l'inflation. La hausse des
prix, que l'on croyait disparue de nos économies, fait ainsi un
retour inattendu, dépassant 3 % de part et d'autre de
l'Atlantique. Les revendications salariales pointent,
notamment en Allemagne. La spirale inflationniste se met en
place.
La contagion à l'économie "réelle". Si la sphère financière
est l'épicentre de cette crise, elle est aussi le poumon de
l'économie. Les banques, affectées par les pertes des
subprimes, resserrent les vannes du crédit pour les ménages
et les entreprises. Aux Etats-Unis où la population vit à crédit
(le taux d'épargne y est négatif), le phénomène est
dramatique. "Les Etats-Unis sont déjà en récession", estime
ainsi l'homme d'affaires milliardaire Warren Buffett. En
Europe, les déboires de l'économie américaine, l'un des
principaux débouchés pour les exportations, grippent une
croissance déjà molle sans faire taire l'inflation. La
stagflation, cauchemar des économistes et des banques
centrales, menace.
Les pays émergents bousculés. Dans un premier temps,
les pays émergents ont résisté. Les économistes évoquaient
alors la théorie du "découplage", soit l'indépendance de ces
économies par rapport à celle des Etats-Unis. Mais depuis
début 2008, la crise est si grave qu'elle chahute aussi ces
marchés, même si leur croissance en 2008 restera nettement
supérieure à celle des pays occidentaux.
Comment sortir de la crise ? La solution pourrait être
radicale, bouleversant même le modèle capitaliste américain.
"Si la crise dure et s'approfondit, les solutions passeront
forcément par l'Etat, qu'il s'agisse de créer un fonds de
défaisance ou de procéder à des nationalisations provisoires
de banques en difficulté", estime Jean-Louis Mourier,
économiste chez Aurel Leven.
LEXIQUE
SUBPRIME.
Crédit hypothécaire accordé aux Etats-Unis par des
établissements spécialisés, non régulés, à des ménages
modestes, sans considération de leur capacité à rembourser.
TITRISATION.
Montage financier permettant à un établissement financier de
transférer le risque de non-remboursement d'un crédit en le
transformant en produit financier complexe vendu sur le
marché.
CRISE DE LIQUIDITÉS.
Phénomène de défiance extrême conduisant les
établissements financiers à ne plus se prêter de l'argent
entre eux.
STAGFLATION.
Combinaison d'inflation et de croissance molle. Le
phénomène, apparu dans les années 1970 après le premier
choc pétrolier, menace de nouveau les économies
occidentales.
1
/
5
100%