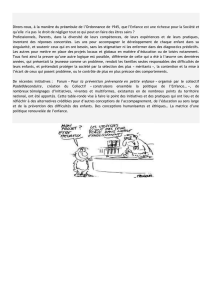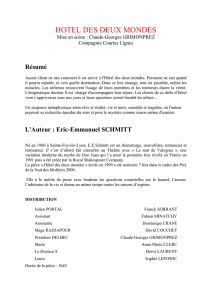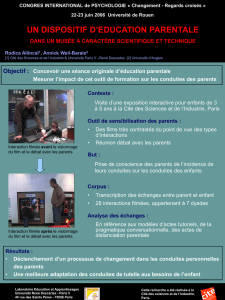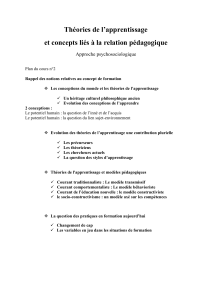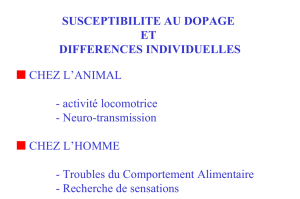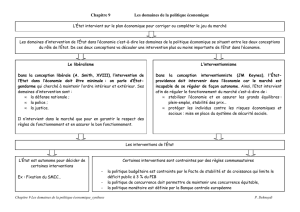Cours du 4 novembre: schématisation progressive

1
Transaction sociale – schématisation progressive
I. POSE DU PROBLEME
1. Point de départ anecdotique mettant en scène une situation
d'incertitude bloquant la prise de décision, l'action.
Possibilités: points de départ intra-individuel / inter-individuel (dont
inter-groupal).
Moment envisagé comme celui de l'émergence du "dilemme"
--> première configuration d'une opposition (souvent "terre-à-terre")
A B
T
(notre exemple) rester technicien devenir musicien professionnel
Nous abordons la problématique de la construction sociale de la
connaissance en partant d'une situation d'incertitude qui émerge
phénoménologiquement à la conscience d'une personne (elle s'énonce la
plupart du temps sous une forme anecdotique) et prend schématiquement
deux formes:
- celle d’un dilemme intérieur qui renvoie à la co-présence, au niveau
intra-personnel, de points de vue antagonistes;
- celle de la rencontre d’un point de vue antagoniste porté par autrui, qui
représente une alternative potentielle au point de vue de la personne et
renvoie à la confrontation interpersonnelle.
Dans les deux cas, la personne se trouve face à un conflit sociocognitif
qui la pousse à construire du sens à propos des objets engagés dans le
dilemme ainsi qu'à déterminer, à partir des significations construites, des
critères d'évaluation de ces objets; critères qui soient susceptibles de
générer des arguments qui orientent prises de position et conduites.

2
II. TRAVAIL D'ANALYSE
A. Un système de tensions
1. Mise en évidence d'un système de tensions qui sous-tend les termes
de l'alternative: qu'est-ce qui fonde le dilemme, c'est-à-dire la valeur de A
et de B?
A B
T
(notre exemple) raison désir
responsabilité épanouissement perso.
repli ouverture
centration sur la famille sur soi
sécurité prise de risque
reproduction changement
... ...
Partant de la tension entre les termes d'une alternative —soit, ici, A et
B—, le travail consiste donc tout d'abord à mettre en lumière les systèmes
de tensions qui sous-tendent A et B.
Les termes de l'alternative —devenir musicien ou rester technicien—,
telles les pointes d'un iceberg, reposent chacune sur un ensemble de
représentations inter-reliées.
Ces représentations engagent à l'évidence des critères relatifs au "bien"
et au "juste". Ces critères fonctionnent à leur tour comme supports
argumentatifs des décisions et conduites effectives.

3
2. Mise en évidence des mondes qui traduisent chaque système de
représentations (réf. Boltanski & Thévenot ; Habermas)
Le modèle théorique que nous développons pose donc l'hypothèse
générale suivante: les termes de l'alternative sont construits sur des
conceptions différentes de la réciprocité des droits et devoirs qui
organisent la socialité (mondes sociaux); ces conceptions mettent en
oeuvre des critères différents de jugement de la pertinence des conduites
singulières (mondes subjectifs); ces conceptions et ces critères enfin sont
traduits par des objets qui les appareillent.
L’apport de Boltanski et Thévenot nous aide dans la mesure où ils
développent justement ces différents mondes. Les mondes domestique, de
l’inspiration, marchand, de l’opinion, industriel et civil présentent en effet
chacun leurs propres logiques concernant : ce qui est juste en matière de
collaboration (monde social), les qualités permettant de qualifier les
conduites singulières (monde subjectif), et les objets (monde matériel).
NB : notre « subjectivité » est donc sociale !
Questions-clefs:
a) Les mondes sociaux: dans les systèmes de coopération concernés,
quelles sont les conceptions contrastées des droits et devoirs, les
conceptions de la collaboration, du bien commun?
b) Les mondes subjectifs: à partir de ces conceptions, quels sont les
critères contrastés qui nous permettent de juger notre action et celle
d'autrui ; les critères de jugement qui, liés à ces conceptions, organisent
nos jugements quant à la pertinence d'une action individuelle?
c) Les mondes matériels: quels sont les "objets" qui manifestent les
valeurs respectives de chaque terme du dilemme ; qui les légitimisent?
Réflexion sur la légitimité sociale de A et de B: sont-ils de même valence
ou l'un est-il socialement dominant? Y a-t-il, entre les deux systèmes en
affrontement, une dissymétrie? Réflexion sur l'appareillage des
conventions.

4
La première démarche d'analyse porte donc la personne concernée à
travailler ses positions –et celles d’autrui– en termes de représentations, et
à considérer l’ancrage de ces positions dans un système de représentations
qui les sous-tend. Mais elle se complète par une deuxième démarche qui
consiste à reconstituer l'origine sociale des systèmes d'oppositions, en
considérant à la fois leur ancrage dans la micro-historicité individuelle et
dans l'Histoire collective. Il s'agit pour la personne de reconstruire, en
relation aux autruis significatifs qui interviennent dans son histoire de vie,
la façon dont ces systèmes de représentations se sont forgés.
NB: Ces autruis significatifs peuvent être des personnes directement
rencontrées ou des personnes indirectement rencontrées (grands ancêtres,
héros, par exemple ; mais aussi auteurs de livres marquants, etc.).
B. L'origine sociale des systèmes en tension
Un second volet du travail, articulé au premier, est par conséquent
nécessaire pour saisir les mouvements de la personne vers l’objet, c’est-à-
dire la construction d’un champ de représentation qui réduise l’incertitude
ou encore la façon dont la personne développe un rapport d’actorialité au
monde. Une troisième démarche, donc, consiste alors essentiellement à
étudier ces mouvements, qui peuvent prendre la forme de l’absence
(blocage devant l’alternative), celle de la fuite, celle du va-et-vient entre
les termes de l’alternative, celle de la résistance, celle de l’attraction vers
l'un de ces termes ou encore celle de la dialectique.
1. Mise en évidence des origines sociales de ces fondements et valeurs:
qui a déposé en nous ces systèmes de valeurs organisateurs des prises de
position A et B?

5
A B
T
x
x
x
x
x
xxx
x
x
MAIS...
2. Nécessité de séquences temporelles
- A et B n'apparaissent pas nécessairement simultanément;
- l'entrée en scène des "autruis significatifs" n'est pas concommittante (NB:
autruis concrets/"abstraits").
3. Trajectoire de la personne porteuse du dilemme
On aborde ici la question de l'agentisation/actorialisation. On peut
envisager: le blocage de l'action; le mouvement en va-et-vient; le deuil
impossible de l'un des termes de l'alternative; l'abandon d'un des systèmes
de valeurs; la production d'un compromis; la création d'un produit
transactionnel.
Le repérage des mouvements de la personne, inscrits dans les changements
de son rapport à l’objet, entraîne à organiser la réflexion par séquences
temporelles. Celles-ci permettent d’aborder l’éventualité d’une absence de
contemporanéité entre les options A et B ainsi qu'avec les systèmes
conventionnels de représentations qui fondent ces options, ainsi que de
hiérarchiser, dans le temps, les autruis significatifs dont l’intervention
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%