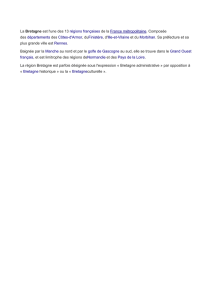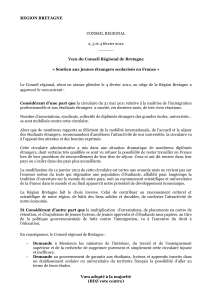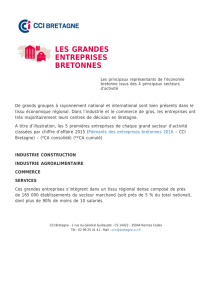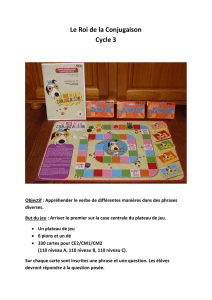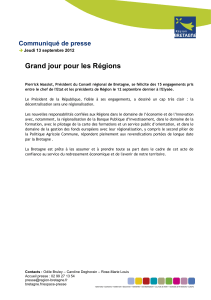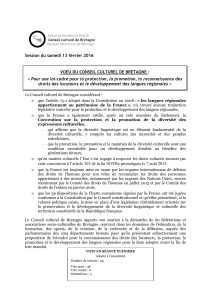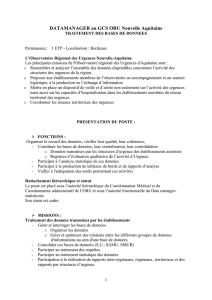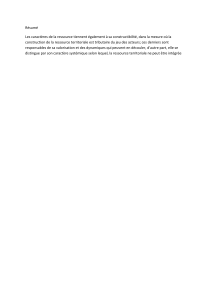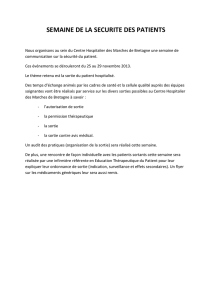Synthèse du Forum “ Les territoires de santé ”

Assises Régionales : “ Quelle offre de soins pour la Bretagne en 2010 ?”
Synthèse du Forum “ Les territoires de santé ” -
9 sept 2004 – Quimper
Animateurs : Alain Even, président de la section prospective du conseil économique et social de Bretagne
Laurent TARDIF, chargé de mission à l’ARH de Bretagne
Rapporteur : Dr Jean PASCAL, médecin de santé publique du CHU de Nantes
1ère partie : principaux résultats du rapport “ Territoires et Santé en Bretagne ”
Postulat : “ Parler de territoire, ce n’est pas limiter la discussion à des périmètres, mais avant tout réfléchir au
contenu des services qui doivent être disponibles dans les espaces ainsi définis, à la manière de les organiser,
de mobiliser les acteurs… ”
La base de construction des niveaux de territoires repose sur la notion “ d’accessibilité ” : perçue en terme de
Trajet et de Trajectoire de soins. Ainsi 3 niveaux de territoires, lieux de l’organisation graduée des soins,
émergent :
Première proximité : quelques minutes autour du domicile pour accéder aux services (médecin
généraliste, pharmacien…)
Moyenne proximité : déplacements compatibles avec la vie de tous les jours, de moins de 20 minutes
(cabinets dentaires, médecines de spécialités courantes, soins de suite, médecine gériatrique…)
Aires de recrutements d’établissements ou de professionnels pour des pathologies ne relevant pas
des 2 premiers, construites par des flux
Chaque niveau est caractérisé par 3 grandes fonctions :
Croisement de la demande et de l’offre
Concertation et partenariat
Expression citoyenne et politique
Il s’agit de tenir compte et d’optimiser les bénéfices d’une organisation territoriale définie par les acteurs de
la Région Bretagne, en essayant de croiser :
Les espaces territoriaux existants : “ territoires sanitaires ” et “ territoires administrativo-politiques ”,
Les espaces territoriaux administrés : intercommunalité, pays, département, région
Les espaces de concertation effectifs : conseils de quartier, conseils de développement des
agglomérations et pays, CESR, conseil général et régional …
Les espaces d’échanges et de production : les “ projets médicaux de territoires ” à l’échelon du
secteur sanitaire et les “ projets territoriaux de santé ” à l’échelon de l’intercommunalité et du pays
intégrés dans les projets de développement global.
Ainsi l’aire géographique des 3 niveaux territoriaux pourrait être la suivante :
Niveau 1 = intercommunalité (118 ECPI : communautés de communes, agglomérations et urbaines)
Niveau 2 = territoires de proximité (au nombre de 21)
Niveau 3 = secteurs sanitaires (au nombre de 8), région et inter-région

Les territoires de proximité (niveau 2) :
Ces territoires sont un découpage des secteurs sanitaires selon les limites des zones d’emploi INSEE
(1990). Ils correspondent donc à des bassins de vie des populations tels que dessinés par les
navettes domicile travail.
Leurs limites géographiques ne résultent pas de l’observation des flux hospitaliers, mais cette dernière a
confirmé à posteriori la pertinence de l’approche par zones d’emploi.
Les zones d’emploi présentant plusieurs aires d’attractions des services hospitaliers ont été subdivisées
selon les flux observés.
Remarquons que pour 15 de ces 21 territoires de proximité la superposition avec les Pays est
parfaite ou presque parfaite.
Les principaux écarts entre les pays et les territoires ainsi définis sont localisés autour de la métropole
rennaise ou dans le pays du Centre Ouest Bretagne.
Toutefois des solutions et aménagements négociés devront être trouvés concernant :
Le “ Centre Ouest Bretagne ” avec son bassin de proximité “ Carhaix ” : quelle articulation avec
l’agglomération brestoise ?
Le secteur 8 (Pontivy-Loudéac) : à conserver, mais redéfinir ses missions et relations territoriales,
Le secteur 5 (Rennes) : être vigilant sur les conséquences du risque de métropolisation des services,
Le bassin hospitalier de Morlaix et secteur 1 (Brest) : à conserver, mais préciser ses relations
territoriales
Le bassin de Quimperlé et le secteur 3 (Lorient) : à conserver, mais problème entre intercommunalité
(secteur 2 de Quimper) et secteur sanitaire d’attractivité (secteur 3)
2ème partie : principaux enseignements issus du débat
La majorité des interventions a validé l’approche contenue dans le rapport. Quelques avis ont mis en garde sur le
danger qu’il y aurait à considérer les pays à devenir des espaces d’organisation des soins.
Le Pays est un acteur territorial de santé stratégique
o C’est un vrai espace de débat de proximité qui croise le mieux la rencontre et l’expression entre
citoyens, élus et professionnels de santé.
o C’est un réel espace de réflexion, de production et d’action au plus près de la réalité des besoins
locaux à travers le conseil de développement et par l’implication des acteurs à travers la construction du
projet territorial de santé.
o Il est le meilleur niveau pour impliquer plus avant les élus, notamment en terme de participation à la
réflexion en matière de projets ou programmes de santé et à son appropriation, point de départ à une
nécessaire implication et représentation plus large de l’élu à l’échelon du secteur et de la région. A noter
que cette participation de l’élu doit être accompagnée au vu de la difficulté à comprendre ce champ
d’action qu’est la santé et en particulier le soin, comme cela peut être observé pour le citoyen.
o Le projet territorial de santé du pays est l’outil central qui devrait concrétiser la pertinence et la
viabilité du choix de ce territoire de santé. Toutefois, sa mise en œuvre doit être clairement initiée et
accompagnée, notamment par l’identification d’un leader ou chef de projet.
o Les projets des établissements ou de services devraient être construits en lien avec le projet
territorial de santé dans lequel ils s’inscrivent et inversement.
o Il faut tenir compte des disparités entre pays en matière d’attractivité des professionnels du soin,
l’hôpital restant un élément structurant, mais pas le seul. Un des moyens est d’arriver à pouvoir leur
proposer une complémentarité d’activité entre ville et hôpital.

o Il est nécessaire de penser aux moyens à mettre en œuvre pour rendre efficiente l’articulation entre
Pays, Secteur et Région. Si le “ projet médical de territoire ” produit à l’échelon du secteur sanitaire
devrait intégrer les “ projets territoriaux de santé ” produits par les pays correspondants, d’autres
moyens doivent être proposés.
Le secteur sanitaire, tel qu’anciennement défini par la carte sanitaire, doit être maintenu :
o Certes, des aménagements doivent être réalisés, tenant compte notamment des remarques
contenues dans le rapport “ Territoires et Santé en Bretagne ”.
o La conférence sanitaire de secteur est stratégique dans ce dispositif. En effet, ce devrait être l’outil
de régulation de l’offre territoriale ; l’ARH devrait largement s’appuyer sur ses propositions ou
recommandations. C’est le lieu privilégié d’échanges en matière de planification de l’offre et de
l’organisation des soins : il devrait tenir compte du résultat des projets territoriaux de santé et être garant
d’une homogénéité de réponse et de réduction des écarts entre pays.
o A noter que chaque conférence de secteur devrait associer les élus, d’une part, dans sa composition,
outil de concertation, et, d’autre part, dans ses prises de positions, outil de régulation. C’est un des
moyens d’aider les élus à participer plus avant dans le processus d’appropriation des problèmes de
santé et de réponses effectives à apporter qui dépassent le seul secteur des soins.
o Le projet médical de territoire (déclinaison du SROS) doit nécessairement intégrer le résultat de la
production des différents projets territoriaux de santé (élaboré par les pays). C’est un moyen
nécessaire de réponse à l’articulation efficiente entre échelons territoriaux.
La participation du citoyen et de l’élu
o Elle doit se poursuivre, même si elle reste difficile, tout en tenant compte des enseignements de la
participation citoyenne telle qu’initiée dans les conférences de santé et surtout déroulée au cours des
états généraux de la santé…
o Elle doit être de principe effective au moins dans tous les Pays, en les associant notamment aux
projets territoriaux de santé.
o La difficulté de la place de l’élu dans le dispositif a été précédemment évoquée. Sa participation
princeps doit être induite aux différents niveaux territoriaux (le pays représentant le 1er niveau
d’accroche) et par leur participation aux projets de territoires de santé et/ou médicaux si nous voulons
concrétiser en Bretagne l’intégration de la dimension santé dans les politiques publiques.
Des articulations territoriales doivent être pensées et des modèles de coopération proposés
o Ente Pays et secteur : ceci a été évoqué précédemment.
o Avec l’échelon départemental et son conseil général : au minimum en associant de principe l’élu aux
conférences sanitaires de secteur.
Il faut noter que les territoires de l’action sociale ne sont pas nécessairement superposables aux
territoires de santé tel que proposé dans le rapport “ Territoires et Santé en Bretagne ”.
o Avec les secteurs psychiatriques : certains découpages doivent peut-être être proposés.
Niveaux territoriaux et hôpital
o Chaque échelon territorial devrait présenter “ un panier minimal de services ”, en particulier de soins
médico-techniques hospitaliers (MCO, SSR…), qu’il reste à déterminer.
o L’hôpital reste toujours la structure de référence en matière d’offre de soins, c’est lui qui structure
l’offre de soins de proximité, et qui reste l’élément majeur d’attractivité pour les professionnels du
soin (médicaux et paramédicaux)…

Cette notion d’attractivité est majeure au vu de l’évolution de la démographie médicale et du
comportement des praticiens. Toute régulation territoriale de l’offre doit nécessairement intégrer une
nouvelle dimension dictant le choix des praticiens : “ la qualité de vie ”.
o A noter qu’il ne s’agit pas de définir initialement les différents échelons territoriaux en fonction
des activités de soins. Mais il semble nécessaire sur la base des niveaux des territoires, tels que
proposés dans le rapport, de définir, dans un second temps, l’offre de soins minimale dont ils
devraient être dotés, tout en tenant compte des disparités territoriales (densité de population,
caractéristiques socio-économiques, infrastructures routières, attractivité …) notamment entre pays, afin
de réduire les écarts potentiels de prise en charge.
o Ainsi, les questions suivantes émergent : Quelle prise en charge minimale devrait être proposée sur
chacun des niveaux de territoires ? Quelles devraient être la nature et la répartition des équipements
hospitaliers dans un territoire ? Quelles missions devraient être dévolues à l’hôpital dans ce territoire ?
o A l’échelon intercommunal et/ou de pays, quelles doivent être les missions et donc les
compétences à affecter à l’hôpital de proximité, ce dernier se différenciant de l’hôpital local ?
L’hôpital conservant son rôle structurant, chaque pays devrait-il être doté d’un hôpital de proximité ?
Encore faudrait-il définir ce qu’est un hôpital de proximité ?
Autres niveaux territoriaux : la région et l’inter-région, qu’en est-il ?

Assises Régionales : “ Quelle offre de soins pour la Bretagne en 2010 ?”
Synthèse du Forum “ L’Hôpital Local et l’Offre de Soins de Proximité ” -
23 sept 2004 – Saint Brieuc
Animateurs : Philippe FORT, Directeur de la DDASS des Côtes D’Armor
Joanny ALLOMBERT, Directeur de l’hôpital local d’Antrain
Rapporteur : DDASS des Côtes D’Armor
Le forum a été replacé dans son contexte : l’élaboration du SROS III en référence à l’ordonnance du
04 septembre 2003 relative à la modernisation des institutions sanitaires.
Sur le plan du calendrier, le SROS doit être arrêté pour septembre 2005.
Dans un objectif de démarche concertée, les résultats attendus du forum visent :
- Le partage des enjeux
- Une analyse commune
- La formulation de principes d’organisation et de recommandations concrètes.
Le Directeur d’hôpital local, animateur du forum dégage les enseignements suivants de son
expérience de terrain :
L’hôpital local a une image qui ne correspond pas à la réalité vécue ;
C’est un acteur important du maillage du territoire ;
- La prise en charge des personnes âgées constitue une activité majeure de ce type d’établissement.
- Les missions sont définies par la circulaire du 28 mai 2003 qui symbolise la reconnaissance de ce
type de structure.;
- Les soins dispensés correspondent à des soins de proximité et ne s’appuient pas sur la disponibilité
d’un plateau technique ;
- La prise en charge médicale repose sur l’intervention de médecins libéraux ;
- L’hôpital local assure l’interface entre le sanitaire, le médico-social et la ville et constitue un relais
local ;
- Les moyens sont souvent limités et dégagent de faibles capacités d’investissements ;
- La coopération et les complémentarités constituent des orientations à privilégier ;
- La motivation et l’implication des médecins sont déterminants ;
- Les prises en charge impliquent une compétence en gériatrie ;
- La problématique des frontières, qu’elle soit géographique ou qu’elle porte sur
l’articulation sanitaire – médico-sociale, est centrale ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%