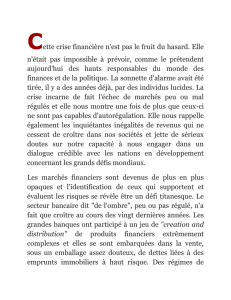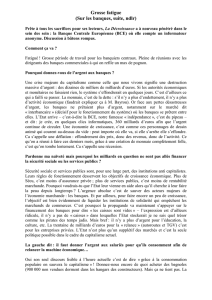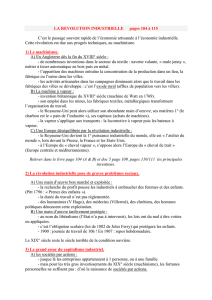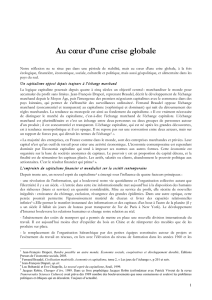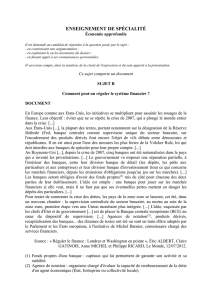imedia 9330

Les débats de l'Obs :
Demain, le krach ?
http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2265/articles/a371662-.html
SEMAINE DU JEUDI 03 Avril 2008
Le chef de file de l'Ecole d'Economie de Paris et le héraut du
libéralisme divergent sur la nature de la crise actuelle du
capitalisme et les solutions possibles par Daniel Cohen et Guy
Sorman
Le Nouvel Observateur. - Alors, en 2008, assiste-t-on à une
crise du capitalisme ou à celle du capitalisme financier ?
Guy Sorman. - On a tendance, en France, à opposer les «bons»
et les «méchants», le «bon» capitalisme industriel, produisant
des objets réels, des voitures, des produits sidérurgiques..., et le
«méchant», financier, virtuel. Tous les deux participent pourtant
au même système. L'un et l'autre sont structurés par des
entreprises en recherche de profit dont le succès dépend de leur
capacité d'innovation. L'idée qu'il existe un bon capitalisme
industriel qui puisse se passer d'un capitalisme financier relève
de la démagogie car, pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait
crédit. Plus de croissance suppose plus de crédit, donc plus
d'innovation financière et plus de prise de risque, car les
«pannes» du capitalisme financier, plus complexe, plus
mondialisé, donc soustrait dans une certaine mesure à la
réglementation et à la concurrence, sont plus nombreuses. Mais il
y a complémentarité, non opposition entre ces deux faces du
capitalisme.
N. O. - A quoi attribuez-vous sa crise ?
G. Sorman. - L'origine est américaine. Les Etats-Unis bénéficient
avec le dollar d'un avantage gigantesque. La puissance de
l'économie américaine incite traditionnellement épargnants et
investisseurs à placer leur argent dans les banques et les places
financières de ce pays. Fortes de cette tendance, les banques
américaines se sont endettées sans limites. Aujourd'hui, le
système financier américain est piégé par sa propre suprématie.
Disposant d'un cash illimité, il a négligé les contrôles : contrôles
internes, qui ne sont plus à la mesure de la sophistication des
placements; contrôles externes, puisque le marché est désormais
mondial. Les banques ont pris des risques inconsidérés, créant
une bulle spéculative qui, comme toutes les bulles, hier celle des
tulipes hollandaises comme récemment celle d'internet, finit par
éclater...
N. O. - Signant ainsi l'échec d'un libéralisme débridé ?
G. Sorman. - Ce capitalisme financier a énormément innové pour
nourrir la croissance. Sans lui, la croissance aux Etats-Unis, en
Europe mais aussi en Chine, en Inde ou au Brésil aurait été plus
lente. Mais plus l'innovation est forte, plus le risque est grand. La
répartition des risques sur une population de plus en plus vaste a
permis le décollage de nombreux pays. Ce bénéfice se paie
aujourd'hui, pour l'économie réelle, d'une crise à la hauteur des
risques qui ont été pris.
D. Cohen. - Je ne vois pas les choses comme ça. Je crois que
nous sommes au coeur d'une crise majeure. Peut-être pas de
l'ampleur de la crise de 1929, car l'expérience d'une crise permet
d'éviter sa répétition, mais comparable à la crise japonaise des
années 1990, qui a cassé le ressort de la croissance de ce pays
pendant dix ans. Depuis le milieu des années 1980, les marchés
financiers gouvernent le monde, on redécouvre aujourd'hui qu'ils
ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes. Les années
1980-1990 ont entretenu l'illusion que les marchés étaient par
nature les mieux à même d'apprécier les risques qu'ils prenaient
au point qu'on a demandé aux institutions financières d'évaluer
elles-mêmes les risques destinés à calculer leurs ratios
prudentiels. De même, les nouvelles normes comptables
internationales obligent les entreprises cotées à inscrire à leur
bilan les actifs à leur valeur du marché, alors que celle-ci est
notoirement instable. On prend aujourd'hui la mesure de cette
fiction. En réalité, les marchés financiers sont de toute éternité
soumis à une instabilité récurrente, et il est extrêmement
dangereux de les laisser s'autoréguler.
N. O. - Quelles sont les causes de cette instabilité ?
D. Cohen. - Les marchés financiers fonctionnent d'abord j sur un
registre mimétique : si tout le monde vend, je ! vends, si tout le
monde achète, j'achète. Keynes remarquait déjà que la fonction
des marchés n'est pas de dire si une entreprise est bonne, mais
de dire ce que l'on pense que les autres en penseront. Les
marchés impriment aux entreprises leur stratégie, mais sont eux-
mêmes habités par des vagues d'irrationalité collectives qui
amplifient les phénomènes de mode : dès lors, en voulant
anticiper la «mode» de demain, chacun a d'une certaine façon
tendance à l'amplifier. Comme le dit très bien le chercheur André
Orléan, un investisseur avisé qui voudrait déjouer ces modes a
plusieurs fois le temps de faire faillite avant que les marchés ne
reviennent à la raison. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la
gouvernance mondiale. Deuxième facteur d'instabilité :
l'asymétrie des modes de rémunération des acteurs de cette
finance mondiale. En cas de succès, l'opérateur touche une
rémunération proportionnelle au gain qu'il a réalisé pour son
établissement financier. En cas d'échec, en revanche, la sanction
ne sera pas proportionnée aux pertes : il perdra ses bonus, sa
carrière sera peut-être brisée, mais il y aura toujours une limite.
Voyez Jérôme Kerviel à la Société générale. Jouer 10 ou 100
milliards peut multiplier les gains par 10, mais la sanction eût été
la même dans l'un ou l'autre cas. Les banquiers le disent eux-
mêmes en d'autres termes : quand il y a des gains, c'est pour les
banques d'affaires, et lorsqu'il y a des pertes, c'est pour les
banques de dépôt. Conséquence de cette asymétrie : quelles que
soient les réglementations, les marchés financiers sont toujours
au taquet, au plus près du risque, pour profiter de cet effet de
levier.
Pour éviter cette course au risque extrême et la contamination de
tout le secteur financier, le législateur américain avait séparé
banque de dépôt et banque d'investissement au lendemain de la
crise de 1929. La distinction, même si elle apparaît archaïque à
certains, entre économie réelle (les entreprises avec leur bilan,
leurs projets d'investissements, leur croissance), qui est
excellente à l'heure de la mondialisation, et économie financière,
qui est sortie de son lit et menace d'étouffer le crédit (le crédit
crunch) , devrait être rétablie. L'autre priorité : en finir avec cette
situation où ce sont les marchés financiers qui autoévaluent les
risques qu'ils font prendre à eux-mêmes et au reste de la société.
Cela pose le problème des agences de notation [NDLR : dont la
fonction est de «noter» les produits financiers]. Il faut noter les
notateurs, qui arguent de leur liberté d'opinion lorsqu'ils se sont
manifestement trompés. Il n'y a donc pas d'analogie entre cette
crise et celle de la bulle internet de 2000.
G. Sorman. - Le mécanisme est pourtant le même.
D. Cohen. - Il est totalement différent. La bulle internet est à
l'image de celles qui ont salué les chemins de fer et l'électricité :
on a cru en un nouvel eldorado et on s'est trompé, non sur le
fond mais sur l'ampleur des gains. Cette fois, c'est le système
financier qui joue avec lui-même, qui s'est mis en péril pour faire
jouer l'effet de levier maximum. Pis, les autorités monétaires ne
disposent pas des instruments pour résoudre la crise. Car que
peuvent-elles faire ? Refinancer les banques en injectant des
liquidités le temps que les gens reprennent confiance ? Elles l'ont
fait. Sans résultat : on est passé d'une crise de liquidités très
courte à une crise de solvabilité. Mais derrière la crise des «sub-
primes» (crédits immobiliers à risque), c'est toute l'infrastructure
du crédit hypothécaire qui est en train de s'écrouler. Si les prix de
l'immobilier s'effondrent et reviennent à leur niveau d'il y a dix
ans, entraînant dans leur chute les produits financiers dérivés, ce
sont non pas 200 à 300 milliards mais dix fois plus qu'il faudra
trouver pour les recapitaliser. Hors de portée des banques
centrales.
Evidemment, on peut toujours, comme au Japon dans les années
1990, pratiquer des taux très bas, très longtemps, pour permettre
aux banques de se refinancer, disons en dix ans, mais avec la
hausse des matières premières ce laxisme des banques
centrales attisera l'inflation. Restent les fonds souverains, ces
fonds étrangers disposant de liquidités colossales : ils ont les

moyens, eux, de recapitaliser les banques. Actuellement, c'est le
seul instrument de politique publique.
G. Sorman. - La crise actuelle ne doit pas faire oublier les
services rendus par le capitalisme financier. Ce système n'est
pas endogame. L'argent créé ne sert pas uniquement à enrichir
les traders. A partir du moment où personne ne croit plus depuis
trente ans à l'autorégulation du monde économique et
spécifiquement du système financier - il y a toujours un tiers
arbitre -, nous sommes confrontés à deux problèmes, celui de la
sanction interne et celui de la sanction externe. L'exemple de la
Société générale illustre de façon caricaturale la carence de la
première. Quant à la sanction externe, elle pose le problème
d'une réglementation adaptée au niveau de sophistication des
nouveaux instruments financiers. Là aussi beaucoup reste à faire,
comme l'a montré l'affaire Enron, entreprise longtemps citée en
exemple malgré ses excès. La crise est-elle pour autant
incontrôlable ? L'expérience peut nous permettre d'éviter les
erreurs des années 1930. Que le rachat des banques en faillite
ait commencé est une très bonne chose. Y aura-t-il une seconde
phase, intervention massive du gouvernement américain,
recapitalisation des banques... et mutualisation des pertes ? C'est
déjà arrivé dans le monde industriel : rappelez-vous le sauvetage
de Chrysler. Le problème n'est pas de rester dans je ne sais
quelle pureté idéologique, mais de sortir de cette impasse. Les
fonds souverains ? Leur intervention est inéluctable. Impossible
de laisser impunément s'accumuler de gigantesques masses de
cash dans certains pays si nous voulons une poursuite de la
croissance. Il y aura nécessairement redistribution des cartes. Au
lieu de s'en inquiéter au motif qu'Arabes ou Chinois
s'empareraient de nos banques et de nos industries, pourquoi ne
pas saluer l'arrivée de nouveaux acteurs économiques qui,
comme les autres, obéiront à la logique économique mondiale ?
Je pense qu'on s achemine vers une consolidation.
D. Cohen. - La consolidation a certainement commencé. Le
rachat de Bear Stearns par JP Morgan pour quasiment un dollar
symbolique l'illustre. Mais l'effondrement du système financier lui-
même - le risque actuel - est plus grave qu'une crise de
solvabilité limitée à un secteur ou à une banque en particulier. A
partir du moment où le système perd ses repères, perd confiance
en lui, il fabrique une crise qui, se nourrissant d'elle-même, se
propage à l'ensemble de l'économie. Ce qui se passe aujourd'hui
est à une autre échelle, l'unité de compte est le trillion (NDLR : 1
trillion = 1000 milliards). En se propageant, la crise affecte tous
les fronts, immobilier, monétaire avec la chute du dollar et la
relance de l'inflation due à la flambée des matières premières.
Peut-être allons-nous cumuler la stagflation des années 1970 et
la récession japonaise des années 1990 ? Une recapitalisation
par les fonds souverains au nom de la logique du marché ? Je
trouve inquiétant que notre intelligence collective soit
subordonnée à la question de savoir si, pondérant avantages et
inconvénients à six mois des JO, la Chine va racheter telle ou
telle banque; extravagant que la solution de nos problèmes
dépende du calcul en opportunité d'une poignée d'Etats assis sur
une rente pétrolière; alarmant que les pays occidentaux soient
incapables d'imaginer une alternative comme s'ils n'osaient plus
concevoir de recapitalisation de leurs banques par la puissance
publique de peur d'être taxés de soviétisme.
G. Sorman. - En Grande-Bretagne, l'Etat vient pourtant
d'intervenir avec la «nationalisation» de fait de Northern Rock.
Pourquoi pas aux Etats-Unis ?
D. Cohen. - Il a d'abord été question de créer une caisse de
mutualisation des risques liés aux «subprimes», abondée par les
banques; il y a eu ensuite l'injection d'une centaine de milliards à
destination des ménages. Depuis dix mois on parle, on parle,
sans arriver à une solution. A six mois de la fin de son mandat,
l'administration Bush a du mal à accepter l'idée d'une intervention
publique. La rumeur veut pourtant qu'un plan de rachat de la
dette en détresse soit envisagé. Première estimation de son coût
: 2 000 milliards !
G. Sorman. - Dans un vrai régime libéral, les banques qui ont
péché devraient disparaître. Dans notre économie mixte, on
hésite de peur que la purge ne tue les malades. Résultat : le
crédit crunch. Les thérapies douces retardent la sortie de crise.
D. Cohen. - Pour faire mon mea culpa, je pensais aussi au début
que nous étions dans une crise des «subprimes» et que les
spéculateurs devaient payer, sans que l'Etat intervienne. Et puis
on est passé d'un scénario à un autre, un scénario où, comme en
1929, la vague de croissance portée par l'innovation
technologique risque d'être cassée pendant dix ou quinze ans par
l'emballement de la sphère financière. La crise de 1929 avait
délégitimé les marchés financiers. La révolution financière des
années 1980 peut nous faire replonger dans une crise du même
type avec non pas les mêmes mécanismes mais la même
logique. Ben Bernanke, le patron de la Réserve fédérale et
ancien professeur d'économie, a très bien décrit cette
propagation dans sa thèse : effondrement des prix de
l'immobilier, multiplication des faillites bancaires annonçant la
chute de la production industrielle - et non l'inverse - et
inadaptation de la baisse des taux d'intérêt à une situation où
plus personne ne prête. Avec sous les yeux ce qu'il a décrit, il
doit aujourd'hui être désespéré de ne pas disposer d'outils
adaptés pour faire face.
G. Sorman. - Je souhaite surtout que les gouvernements actuels
ne réagissent pas comme les responsables l'avaient fait à
l'époque, par le protectionnisme et la cartellisation, qui avaient
encore prolongé la crise.
D. Cohen. - Il n'y aura pas de protectionnisme, pour une raison
très simple : à 1,50 euro, le dollar est une puissante incitation
pour les Européens à délocaliser leurs activités vers les Etats-
Unis, qui ont précisément besoin de se recapitaliser. Une
monnaie sous-évaluée est la meilleure réponse au
protectionnisme. Le risque protectionniste est chez nous, aussi
longtemps que l'euro restera surévalué.
G. Sorman. - On peut répéter qu'une idée est fausse, montrer
qu'elle l'est expérimentalement, mais on ne peut empêcher
qu'elle revienne et ait un impact politique. Lorsque les deux
candidats démocrates américains rivalisent de protectionnisme
dans leurs discours, tout peut arriver...
Guy Sorman
Essayiste et écrivain, Guy Sorman vit à New York. Il est l'auteur
de nombreux ouvrages, dont «la Solution libérale», «Made in
USA. Regards sur la civilisation américaine», «l'Année du Coq.
Chinois et rebelles», chez Fayard. Il publie chez le même éditeur
«L'économie ne ment pas».
Daniel Cohen
Professeur à l'Ecole normale supérieure, Daniel Cohen est vice-
président de l'Ecole d'Economie de Paris et directeur du
Cepremap. Il est l'auteur, entre autres, de ««Trois Leçons sur la
société postindustrielle» (Seuil). Il vient de diriger avec Philippe
Askenazy «27 Questions d'économie contemporaine» (Albin
Michel).
Jean-Gabriel Fredet
Le Nouvel Observateur
1
/
2
100%