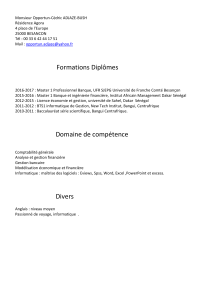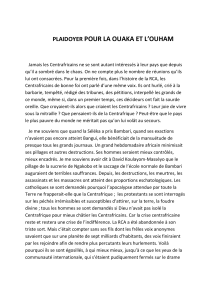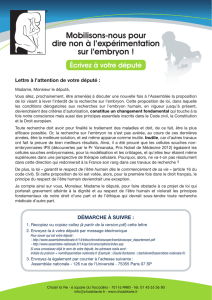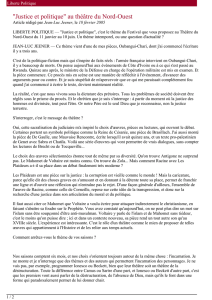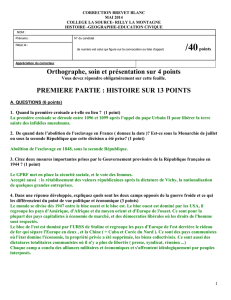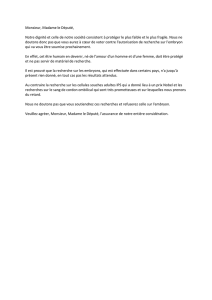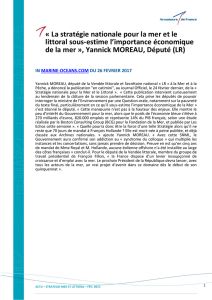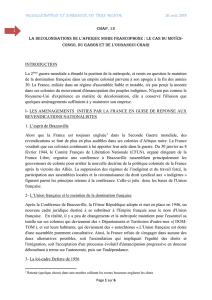4e étape et fin - Les Amis de la Centrafrique

Vingt-unième partie : l’Abbé B. Boganda. De l’autel de Dieu
à la tribune de l’Assemblée française : une ascension
fulgurante.
21 - 1 La candidature et l’élection de l’abbé.
En effet, l’élite intellectuelle faisait encore cruellement défaut en Oubangui-Chari
et au Tchad pour occuper à cette époque des postes administratifs et politiques
importants. Les quelques rares cadres et agents oubanguiens appelés « évolués »
qui étaient pour la plupart des auxiliaires administratifs évitaient de prendre des
risques en se portant candidats aux élections législatives. Toutefois, certains rares
cadres subalternes africains tels que Yetina, Indo, Gandji de Kobokassi, etc.
connaissant parfaitement les tenants et les aboutissants de l’aventure politique dans
chaque colonie, se réservaient de s’y lancer.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ( 1939-1945 ), lorsqu’il fallait
mettre en place une Assemblée constituante en vue de l’élaboration de la
Constitution de la IVe République française, c’était le Lt-Colonel Guy Baucheron
de Boissoudy qui, plébiscité par toute la communauté européenne, devait siéger en
lieu et place des Oubanguiens et Tchadiens. Tandis que Maurice Bayrou
représentait les Gabonais et Congolais à cette Constituante.
Toutefois, ayant été rassurés par la nouvelle Constitution instituant la liberté
politique et syndicale dans les départements d’outre-mer, les Oubanguiens
commencèrent à prendre conscience de la politique de la chaise vide à l’Assemblée
parlementaire. Ils résolurent de saisir au bond l’opportunité offerte par ce texte
organique et d’y envoyer un représentant de l’Oubangui-Chari afin de faire des
plaidoyers en faveur du peuple colonisé longtemps opprimé et asservi.
Cette fois-ci, ceux-ci se concertèrent et prirent la résolution d’empêcher le
Lt-Colonel de Boissoudy, un baroudeur de Bir-Hakeim ( Libye ) ayant déjà
participé, il y a sept mois, à l’Assemblée constituante de représenter le territoire de
l’Oubangui-Chari au 2ème collège de l’Assemblée française. Ils décidèrent de
soutenir la candidature de l’abbé Boganda aux élections législatives du 10
novembre 1946. Toutefois, ils avaient du mal à convaincre le prélat qui avait choisi
par vocation la voie de la prêtrise. Il tergiversait et se posait souvent la question de

savoir comment pourrait-il passer de l’autel de Dieu à la tribune de la dite
assemblée et ne pas trahir sa foi. Finalement, il mit fin à sa réticence grâce à son
parrain, le Monseigneur Grandin, qui lui conseillait vivement de se présenter à ces
élections contre Jean-Baptiste Songomali, agent comptable à la COTONAF et
Tarquin, un instituteur d’origine antillaise affecté à Bambari en 1946 comme chef
de secteur scolaire ; celui-ci, cumulativement avec ses fonctions enseignait à
l’école primaire supérieure ( EPS ). Rassuré que sa candidature devait être
soutenue par l’Eglise afin de barrer la route à l’avancée fulgurante du « péril jaune,
du communisme et du panarabisme » qui menaçait dangereusement le continent
africain sous la bannière de la SFIO ( Section française de l’Internationale ouvrière
) et du RDA ( Rassemblement démocratique africain ) fondé en Afrique de l’Ouest
par Félix Houphouêt Boigny, Modibo Kéita, etc. Or ce jeune parti avait aussi une
coloration politique d'obédience socialo-communiste. Les sections, animées par
leurs représentants, Songomali et Tarquin, commençaient à s’implanter solidement
en Oubangui-Chari.
Dans toutes les églises, Mgr Grandin se mit à vanter le mérite et la ferme
détermination du jeune abbé qui se montrait foncièrement anti-communiste.
Pressenti député du 2ème collège de l’Oubangui-Chari à l’Assemblée française, lui
seul était capable de faire face à ces dangers imminents qui planaient sur le pays.
Toutes les congrégations religieuses se mobilisèrent en faveur de Boganda. Aux
élections législatives du 10 novembre 1946, il fut opposé aux trois autres candidats
dont Songomali et Tarquin qui devaient se présenter sous l’étiquette socialiste, et
François-Joseph Reste ( ** né en 1897 et parachuté en Oubangui-Chari en fin
de carrière, Reste était un ancien gouverneur général des colonies à la
retraite. Elu à la 1ère Assemblée constituante par le premier collège de la
Côte-d’Ivoire, il s’était fait battre à la 2ème constituante ).
Sur 22.949 électeurs oubanguiens ayant voté, soit un taux de participation de 70%,
Boganda fut brillamment élu face à ses challengers avec 10.846 voix contre 5.190
à Tarquin, 4 801 à Jean-Baptiste Songomalé et enfin 1.607 à François-Joseph
Reste. Pour la première fois et sans grande difficulté, un député noir, en la
personne de l’abbé Boganda, fut élu au suffrage universel direct et secret en
Oubangui-Chari. Boganda devint ainsi le premier député oubanguien dont le nom
devait incarner dans ce petit pays très enclavé, peu de temps après son élection
jusqu’à sa disparition tragique le 29 mars 1959, le grand combat politique pour
l’indépendance.
A la proclamation des résultats, la nouvelle de la défaite des autres candidats était
bien accueillie par Mgr Grandin et toute la communauté ecclésiastique qui

s’inquiétaient de la progression significative du socialisme, du communisme et du
panarabisme en Oubangui-Chari.
Par ailleurs, le candidat malheureux, Songomalé, après sa défaite fut réconforté par
son élection à la tête du secrétariat général du syndicat du CGT-FO (
Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière ) des employés des sociétés
commerciales et industrielles.
Elu à l’Assemblée française, haut lieu des libertés d’expressions et d’opinions
politiques, Boganda espérait faire entendre sa voix aux états généraux de la
colonisation de l’Oubangui-Chari et surtout aux Français de la France sur la
méthode du système colonial dans son pays. Le 9 décembre 1946, il foulait pour la
première fois le sol français afin d’assister à l’ouverture de la session
parlementaire. Au lendemain de son arrivée à Paris, il trouva dans l’administration
une meilleure mentalité des agents et fonctionnaires, un bon esprit de travail et de
compréhension. A cet effet, il établit tout de suite la différence entre les Français
de la France métropolitaine, courtois, affables et respectueux des droits et de la
dignité humaine, et ceux vivant en Oubangui-Chari, discourtois, racistes, injustes
et brutaux.
Le 17 décembre, le jeune député oubanguien, toujours dans sa soutane de prêtre,
fut désigné membre de la Commission des territoires d’Outre-mer et de surcroît le
rapporteur ( ** En Afrique de l’Ouest, la Haute-Volta aujourd’hui appelée
Burkina Faso, constituait en 1919, une colonie française au même titre que les
autres ; elle fut annulée et partagée en 1932 entre la Côte-d’Ivoire, le Niger et
le Soudan ( l’actuel Mali ). Comme l’association voltaïque demandait avec
insistance la reconstitution de cette colonie, une commission fut mise en place
pour en étudier la problématique. A l’issue du débat B. Boganda en fut
plébiscité le rapporteur. La Haute-Volta fut en effet reconstituée ).
21 - 2 Adhésion de Boganda au M.R.P ( Mouvement républicain
populaire ).
A l’Assemblée parlementaire, lorsqu’un député n’était affilié à aucun parti
politique, ses interventions et remarques, même les plus pertinentes, étaient
rarement suivies avec une attention soutenue par ses pairs. Or Boganda était élu
député de l’Oubangui-Chari sous l’étiquette d’indépendant. Comme il
n’appartenait à aucun parti politique français, lorsqu’il prenait la parole à la tribune

de l’Assemblée, c’était avec une attention peu soutenue que ses pairs suivaient ses
déclarations. Au contraire, ceux-ci ne prenaient jamais au sérieux ses diatribes
contre le système colonial en Oubangui-Chari. Toutes ses déclarations n’avaient
aucun écho dans les médias français.
Le médecin Louis-Paul Aujoulat, député du premier collège du Cameroun, l’un des
rares parlementaires de peau blanche dont le tempérament aurait été façonné
probablement par sa formation, prêtait de temps en temps une oreille attentive aux
révélations de son collègue Boganda et s’apitoyait parfois sur le sort des peuples
opprimés de l’Oubangui-Chari. Celui-ci conseilla à Boganda d’adhérer au MRP (
Mouvement Républicain Populaire ) dirigé par Georges Bidault, principal parti
politique français d’obédience démocrate-chrétienne dont les membres étaient en
majorité composés d’anciens résistants à l’occupation allemande et dont certains
avaient même participé aux différents gouvernements de la IVe République.
Le jeune député de l’Oubangui-Chari, en adhérant en 1947 à ce parti, espérait
obtenir sans faille et sans hésitation le soutien des autres membres de l’Assemblée
dans la lutte implacable qu’il voulait mener contre le colonialisme, le racisme,
l’injustice et l’oppression dans son pays. Il estimait que l’idéal du MRP dont il
avait pris connaissance dès son arrivée à Paris répondait parfaitement à sa
conviction politique et à son aspiration chrétienne.
Jouissant désormais de la « double casquette », député à l’Assemblée nationale et
militant du MRP, Boganda se montrait grand avocat des peuples de
l’Oubangui-Chari. Dans l’espoir de se faire entendre et comprendre dans les
milieux français de la métropole sur les atrocités et les brutalités commises sur les
pauvres paysans, il devait multiplier dans le 5ème Arrondissement de Paris, à
Meaux, Grenoble, Strasbourg et Lille des conférences portant sur les pratiques
odieuses et dégradantes du système colonial en Oubangui-Chari attestées par le
non respect de la dignité humaine et de la liberté, l’injustice, le racisme, les
arrestations arbitraires, les assassinats, etc. Saisissant l’occasion, il réclama la
stricte application de la loi du 11 Avril 1946 abolissant le travail forcé et le code de
l’indigénat, sources des mauvais traitements dont était souvent victime la
population oubanguienne. En outre, il exigeait du gouvernement français, les droits
et l’égalité de tous les « Blancs et Noirs » devant la loi sur la terre de
l’Oubangui-chari. D’où l’expression « zo kwé zo » ; traduite littéralement en
français elle donna : « toute personne est une personne ».
Travailleur infatigable, assidu et ponctuel à l’Assemblée française, il participait
activement à tous les travaux de la commission ; il avait déposé plusieurs

propositions de loi en faveur de son pays, l’Oubangui-Chari. A la tribune du
Parlement, il faisait des déclarations que ses pairs, notamment ceux du premier
collège dont l’objectif essentiel était de défendre les intérêts des colons, jugeaient
souvent excessives, calomnieuses et incendiaires qui les mettaient mal à l’aise.
Dans son article intitulé « B. Boganda , un acteur important de la décolonisation en
Afrique centrale » ( ** paru chez l’Harmattan en 1994, p. 207, Pierre Soumille (
** Maître de conférences né en 1926 et mort le 1er novembre 2003 était en
coopération française en RCA. Plein d’altruisme, il avait enseigné sans
discontinuité pendant dix ans ( 1978-1988 ) au département d’Histoire à
l’Université de Bangui. Avec sa charmante et gentille épouse Geneviève, il
recevait de temps en temps chez lui, rue Joseph Rigaud à Aix-En-Provence,
tous les étudiants centrafricains en histoire qui vivaient dans cette ville
universitaire ) révéla que le député Boganda était intervenu en cours d’année 1947
sur plusieurs thèmes variés.
Le 14 février, il a dû intervenir au sujet des pensions des anciens combattants
oubanguiens appelés à cette époque « tirailleurs sénégalais de l’Oubangui-Chari ».
En effet, ceux-ci ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que leurs compagnons
d’armes européens. Or, ils avaient participé aux mêmes effets et connu ensemble
les affres de la guerre, partagé les mêmes souffrances et les mêmes victoires. Cette
injustice irritait le député oubanguien qui ne saurait y rester insensible.
Il dénonça le 5 mars l’inobservation de la loi du 11 avril 1946 portant l’abolition
du travail forcé qui réduisait au rang des bêtes de somme les peuples colonisés. En
dépit de cette loi, le travail forcé et inhumain se poursuivait ostensiblement encore
en Oubangui-Chari. En effet, tous les colons européens qui vivaient dans le pays
prétextaient que les peuples colonisés ne pouvaient travailler que grâce à la
chicotte qu’on devait leur appliquer quotidiennement pour obtenir des rendements
meilleurs. Ainsi donc, les sévices et les abus commis sur les populations doublaient
d’intensité.
Le 29 mai puis le 11 juin, le député Boganda intervint encore à la tribune à propos
du code de travail qui n’a jamais été respecté par tous les employeurs oeuvrant en
Oubangui-Chari puis au sujet des finances.
Le 9 décembre, il aborda le crucial problème de racisme en Oubangui-Chari car
lui-même étant l’élu du peuple, il a été expulsé en 1947 à deux reprises de l’hôtel
« Pendéré » ( ** la gérante, épouse du propriétaire de cet hôtel était très belle
si bien que les ouvriers qui y travaillaient utilisaient fréquemment
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
1
/
136
100%