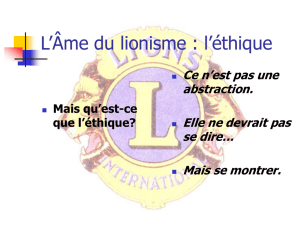Cours de Sociologie de l`éthique (A.S. Lamine)

- 1 -
Cours de Sociologie de l’éthique (A.S. Lamine) – Citations
DURKHEIM
De la division du travail social (1893)
« La division du travail varie en raison directe du volume et de la densité des sociétés. […] Pour
que les fonctions se spécialisent davantage, il faut qu’il y ait plus de coopérateurs et qu’ils soient assez
rapprochés pour pouvoir coopérer » (p. 244).
[la division du travail contribue à la solidarité sociale, et donc à l’ordre moral] « puisque la division
du travail devient la source éminente de la solidarité sociale, elle devient du même coup la base de l’ordre
moral » (p. 396).
« Nous pouvons donc dire d'une manière générale que la caractéristique des règles morales est
qu'elles énoncent les conditions fondamentales de la solidarité sociale » (p. 393).
« l'homme n'est un être moral que parce qu'il vit en société, puisque la moralité consiste à être soli-
daire d'un groupe et varie comme cette solidarité » (p. 394).
Le suicide (1898)
« des actes moraux comme le suicide […] dépendent de forces extérieures aux individus […qui] ne
peuvent être que morales [et…] sociales ». [Il faut concevoir ces forces] « comme un ensemble d’énergies
qui nous déterminent à agir du dehors » (p. 349). « Ce sont les tendances de la collectivité qui, en péné-
trant les individus, les déterminent à se tuer. […] Tout dépend de l’intensité avec laquelle les causes sui-
cidogènes ont agi sur l’individu » (p 336-337).
« Quand nous suivons une coutume, quand nous nous conformons à une pratique morale, c’est dans
la nature de cette pratique, dans les caractères propres de cette coutume, dans les sentiments qu’elle nous
inspirent que se trouvent les raisons de notre docilité » (p. 116).
L’Education morale (1902-1903),
« Pour agir moralement, il ne suffit pas, surtout il ne suffit plus de respecter la discipline, d'être at-
taché à un groupe ; il faut encore que, soit en déférant à la règle, soit en nous dévouant à un idéal collec-
tif, nous ayons conscience, la conscience la plus claire et la plus complète possible, des raisons de notre
conduite. Car c'est cette conscience qui confère à notre acte cette autonomie que la conscience publique
exige désormais de tout être vraiment et pleinement moral. Nous pouvons donc dire que le troisième élé-
ment de la morale, c'est l'intelligence de la morale. La moralité ne consiste plus simplement à accomplir,
même intentionnellement, certains actes déterminés ; il faut encore que la règle qui prescrit ces actes soit
librement voulue, c'est-à-dire librement acceptée, et cette acceptation libre n'est autre chose qu'une ac-
ceptation éclairée. ».
ISAMBERT
De la religion à l’éthique (Cerf, 1992, ch. 16, « les avatars du fait moral », p. 357-393)
[La difficulté soulevée par les travaux de Durkheim est aussi celle de toute sociologie de l’éthique
et même plus largement de toute sociologie abordant le fait moral. On est devant un dilemme]. « L’objet
est-il la morale, l’éthique comme ensemble de normes et de valeurs, saisis sur le plan culturel, au milieu
des autres ensembles de normes et de valeurs, et sans qu’il soit aisé de préciser sa spécificité ; ou bien
est-il l’acte moral avec sa spécificité formelle, mais renvoyant à une détermination du sujet, sans qu’il soit
possible d’en préciser son caractère social. » (p. 361).
PARSONS
The social system (1955)
« It is inherent in an action system that action is […] “normatively oriented” » (p. 36) « Il est inhé-
rent au système même de l’action que l’action soit “normativement orientée” ».
« L’élément du système symbolique commun qui sert de critère ou de norme pour opérer un choix
entre des orientations contradictoires qui s’ouvrent intrinsèquement au cœur d’une situation s’appelle une
valeur » (p. 12).
Les normes sont des « modèles d’orientation de valeurs [et…] constituent une fraction cruciale de
la tradition culturelle en vigueur dans le système social » (p. 37).
Parsons, Les sociétés et leur évolution comparée (1966)

- 2 -
« je tends à croire à une détermination culturelle plutôt qu’à une détermination sociale. De même,
je crois qu’au sein d’un système social les éléments normatifs sont plus importants que les intérêts maté-
riels des groupes en présence pour expliquer le changement social ».(p. 147).
BOURDIEU
Raisons Pratiques (Points Seuils, 1994),
« Un fondement paradoxal de la morale »
« Point de départ possible d’une réflexion sur la morale : l’existence, universellement attestée, de
stratégies de second degré, métadiscursives ou métapratiques, par lesquelles les agents visent à repro-
duire les apparences de la conformité (en acte ou en intention) à une règle universelle lors même que leur
pratique est en contradiction avec la règle ou qu’elle n’a pas pour principe l’obéissance pure à la règle.
[… ] Si ces tromperies qui ne trompent personne sont si facilement acceptées par les groupes, c’est
qu’elles enferment une déclaration indubitable de respect pour la règle du groupe, c’est–à–dire pour le
principe formel universel (puisque applicable à tout membre du groupe) qui est constitutif de l’existence
du groupe. » (p. 233),
« Ainsi les groupes récompensent-ils universellement les conduites qu’ils tiennent pour universelles
en réalité ou, à tout le moins, en intention, donc conformes à la vertu ; et ils accordent une ferveur parti-
culière aux hommages réels, et même fictifs, à l’idéal de désintéressement, à la subordination du moi au
nous, au sacrifice de l’intérêt particulier, qui définit très précisément le passage à l’ordre éthique. On
peut donc tenir pour une loi anthropologique universelle qu’il y a du profit (symbolique et parfois maté-
riel) à se soumettre à l’universel, à se donner (au moins) les apparences de la vertu, à se plier, extérieu-
rement, à la règle officielle. » (pp. 234-235).
« Un acte désintéressé est-il possible »
« Le fait qu’on obtienne des profits d’universel en rendant hommage, fût-ce hypocritement à
l’universel en habillant d’universel une conduite déterminée en fait par l’intérêt particulier […] est sans
doute un des grands moteurs de la vertu et de la raison dans l’histoire. » (pp. 164-165).
WEBER
Economie et Société (tome 1), Paris, Plon, Pocket-Agora, 1995.
« Nous entendons par “activité”, un comportement humain […] quand et pour autant que l’agent ou
les agents lui communiquent un sens subjectif » (p. 28). « Pour elle [la sociologie], un critère “éthique”
consiste en ce qu’il applique une sorte de norme spécifique de croyance rationnelle en valeur (wertratio-
nal), considérée comme norme, à l’activité humaine ; celle-ci revendiquant le prédicat du “bien moral”,
comme l’activité qui revendique le prédicat du beau se mesure par là aux critères esthétiques » (p. 71).
Le Savant et le politique, Paris, Plon 10/18, 1963
www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales
« Il est indispensable que nous nous rendions clairement compte du fait suivant : toute activité
orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement
opposées. Elle peut s'orienter selon l'éthique de la responsabilité (verantwortungsethish) ou selon l'éthique
de la conviction (gesinnungsethish). Cela ne veut pas dire que l'éthique de conviction est identique à l'ab-
sence de responsabilité et l'éthique de responsabilité à l'absence de conviction. Il n'en est évidemment pas
question. Toutefois, il y a une opposition abyssale entre l'attitude de celui qui agit selon les maximes de
l'éthique de conviction - dans un langage religieux nous dirions : “Le chrétien fait son devoir et en ce qui
concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu” - et l'attitude de celui qui agit selon l'éthique de res-
ponsabilité qui dit : “nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes” » (p. 206).
« L'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité ne sont pas contradictoires, mais elles se com-
plètent l'une l'autre, et constituent ensemble l'homme authentique, c'est-à-dire un homme qui peut pré-
tendre à la “vocation politique” » (Le métier et la vocation d’homme politique, p. 219).
1
/
2
100%