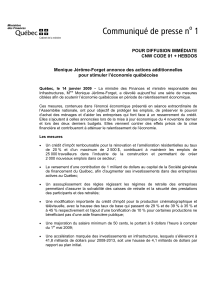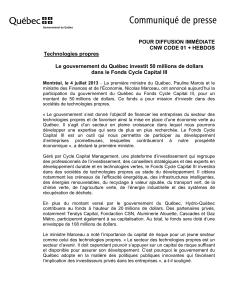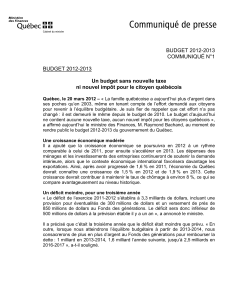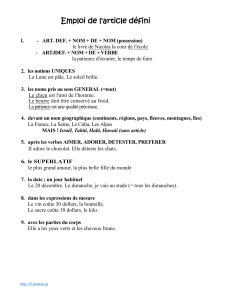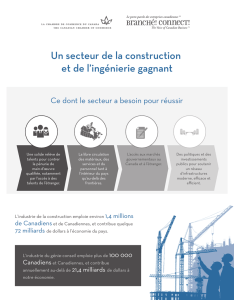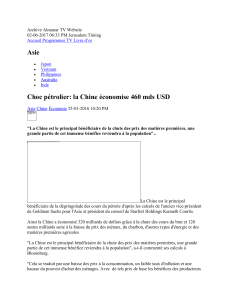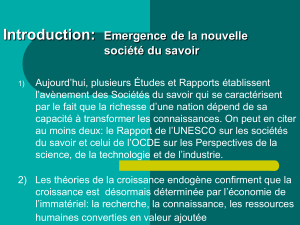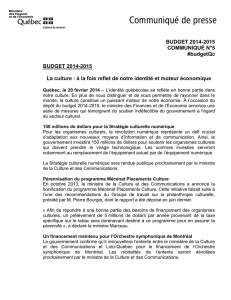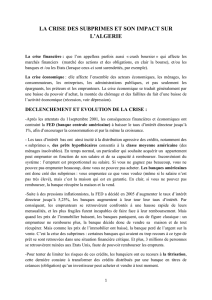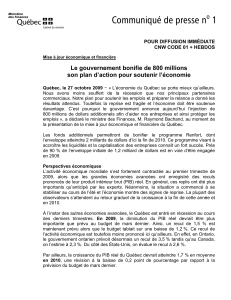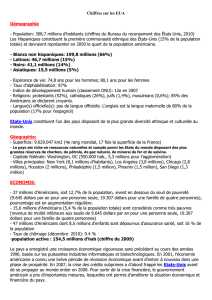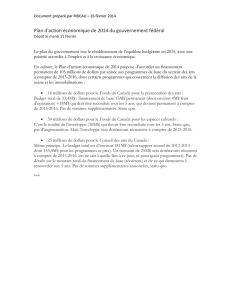jusen

LES PROSPERITES DU CRIME :
TRAFIC DE STUPEFIANTS,
BLANCHIMENT ET CRISES
FINANCIERES : LE CAS DU JAPON
Communication n° 98GT2121 à l'ANPOCS
Caxambu, MG.
Guilhem FABRE

JAPON : LA RECESSION YAKUZA
Le cas du Japon fournit une illustration tout à fait éclairante de la
criminalisation progressive de la finance et de ses conséquences, dans un pays qui est
à la fois la seconde puissance économique du monde, le premier créditeur de la
planète et le grand ordonnateur de la régionalisation de l'Asie orientale, par le biais de
ses investissements, de ses transferts de technologie et des flux commerciaux qu'ils
génèrent.
Seule grande réussite économique non occidentale, le Japon fait figure de
modèle de développement aux yeux de ses voisins, diffusant progressivement son
savoir-faire industriel vers les nouveaux pays industrialisés (Hongkong, Singapour,
Taïwan, Corée du Sud), puis vers les pays d'Asie du sud-est et la Chine, selon l'image
éculée du "vol des oies sauvages". L'internationalisation de l'économie japonaise, qui
représente à elle seule 70 % du produit intérieur brut de l'Asie orientale, semble
parvenue à son stade de maturité : en 1996, le montant des produits nippons
manufacturés à l'étranger (390 milliards de US dollars) dépassait celui des
exportations (380 milliards).
1
Cette puissance économique contraste avec la fragilité d'un système financier
déconsidéré par les dérives des années 80. La déréglementation financière ne s'est pas
accompagné de mécanismes de supervision et de règles prudentielles adaptées aux
prises de risques des banques et des établissements financiers. L'abondance de
liquidités issues des performances exportatrices, alliée à des anticipations excessives
ont favorisé un environnement spéculatif, avec une hausse vertigineuse des cours
boursiers, des prix fonciers, immobiliers, et du marché de l'art. Au sommet de
l'euphorie, le 31 décembre 1989, les marchés boursiers japonais représentent 42 % de
la capitalisation boursière mondiale, contre 15 % en 1980, et 151 % du PIB, contre 29
% à la même date.
2
Quant aux prix fonciers, ils dépassent parfois 160.000 US dollars
(1 million de francs) le mètre carré, rendant impossible toute rentabilité de
l'investissement, quel que soit l'usage du terrain
3
. Le Japon compte alors huit des dix
premières banques du monde, et contrôle le quart de l'industrie bancaire
californienne, 10 % des actifs bancaires aux Etats-Unis et peut-être 25 % en
1
Cf. Nahid Movahedi, "Les mutations du capitalisme japonais", in Rapport moral sur l'argent dans le monde,
1996, Association d'économie financière, Paris.
2
Cf. Christopher Wood, The bubble economy : Japan's extraordinnary speculation boom of the 80's and the
dramatic bust of the 90's, New York, The Atlantic Monthly Press, 1992.
3
Cf. Vincent Renard, "Lacorruption et l'immobilier au Japon", Rapport moral sur l'argent dans le monde, 1996,
p.61.

Grande-Bretagne.
4
Mais l'inflation des actifs s'est suivie d'une déflation non moins
spectaculaire, qui a causé la plus importante récession de l'économie nippone depuis
la dernière guerre, malgré six plans de relance successifs.
5
Il a fallu attendre le milieu
des années 1990, avec le tremblement de terre de Kobe, pour que le voile se lève
progressivement sur l'implication de la pègre dans l'économie de la bulle, sur les
noces étranges entre le crime et les affaires.
Dès la seconde moitié des années 1980, l'alliance entre les politiques, les
technocrates et les chefs d'entreprises, le fameux "triangle de fer" qui avait forgé les
bases de l'essor japonais, change de contours avec l'investissement des milieux
mafieux dans les secteurs spéculatifs de l'économie licite . Le crime organisé a un
statut social bien défini au Japon. Les autorités ont longtemps fait valoir que la
structuration de la déviance était à l'origine d'un taux de délinquance
exceptionnellement bas. De source policière, on dénombre 88.600 yakuzas
appartenant à 3.300 différents groupes, dont la plupart son affiliés à l'un des trois
principaux gangs : la Yamaguchi-Gumi, qui compte près de 30.000 membres basés
surtout dans la région du Kansaï (Osaka-Kobe-Kyoto), la Inagawa-kaï, avec ses 8.000
membres, et la Suniyoshi-kaï, rassemblant 6.000 adhérents.
Les yakuzas prennent pied dans des activités légales permettant de recycler les
profits de leurs opérations traditionnelles : en tout premier lieu le jeu, avec la vogue
des billards électriques, les pachinkos, qui génèrent 25 000 milliards de yens de
recettes en 1996, soit presque une fois et demie le chiffre d'affaires de l'industrie
automobile nippone et 6,7 % du PIB. Leurs activités illicites concernent la
prostitution, avec des réseaux couvrant l'ensemble de l'Asie orientale et certains pays
d'Amérique Latine comme la Colombie, l'extorsion de fonds, le trafic d'armes de
poings et le trafic de drogues. La consommation de métamphétamines fabriquées
clandestinement en Corée du Sud ou en Chine concernerait 500.000 personnes, et la
consommation de cocaïne, environ 150.000, pour une population de 125 millions
6
.
Des produits comme l'héroïne restent peu utilisés, en vertu d'un accord tacite entre la
yakuza et la police qui bannirait la distribution de ces substances sur le territoire
national, sous peine de graves condamnations. De source policière, les recettes
illicites de la yakuza s'élèveraient au moins à 10 milliards de US dollars par an,
peut-être même plusieurs fois ce montant, dont le quart ou le tiers proviendrait du
trafic de stupéfiants
7
. De telles sommes, importantes en termes absolus, restent
relativement négligeables au regard d'une économie licite qui dégage un produit
intérieur brut de l'ordre de 4.600 milliards de US dollars en 1997. Mais
l'investissement progressif de celle-ci par les capitaux mafieux va modifier les
données du problème.
4
Cf. Malcom Trevor, "The overseas strategies of Japanese corporations", The Annals of the American Academy
of Social Sciences, n°513, january 1991, p.97.
5
Cf. Evelyne Dourille, L'économie japonaise, Ed. La Découverte, collection Repères, Paris, 1998.
6
Cf. Thierry Ribault, "Au Japon, la folie des pachinkos", Le Monde diplomatique, aout 1998; Nahid Mohavedi,
"Drogue et blanchiment au Japon", Rapport moral sur l'argent dans le monde, 1995, p.51-52; Thierry Cretin,
Mafias du monde, PUF, 1997, p.73.
7
Cf. Maki Murakami, "Japan's grud war", Look Japan, février 1991; International Herald Tribune, 16/6/1992.

L'immobilier, et surtout le foncier, qui peut représenter 80, voire 90 % du prix
d'une opération
8
dans un pays montagneux et très dense, où seulement le quart de la
surface du territoire est habitable, constitue le ressort traditionnel de financement des
partis politiques. Les agences publiques régionales pratiquent pour toute opération un
système d'appel d'offres truqué, écartant les offres inférieures à leurs propres
estimations, et favorisant la répartition discrète des chantiers entre les opérateurs
"agréés". Les surfacturations sont reversées sous forme de commissions alimentant
les caisses noires des partis, ce qui représente un surcoût de 8 à 12 %, réglé par le
contribuable.
9
Certains politiciens peuvent être financés directement par des sociétés
immobilières, à travers la manipulation de titres boursiers, comme le montre le
scandale Recruit-Cosmos, qui fait tomber le gouvernement Takeshita en 1989.
10
En janvier 1995, le tremblement de terre de Kobe, qui fait 5.000 victimes et plus
de 100 milliards de US dollars de dégâts, agit dans l'opinion comme un révélateur de
l'irresponsabilité entraînée par ce système, avec la découverte du laxisme des
contrôles de construction et de non respects des normes antisismiques. Les Japonais
se sont habitués à cette corruption structurelle, favorisée par l'absence d'alternance
politique. "Pendant le long règne du parti libéral démocrate (1955-1993)", souligne
Jean-Marie Bouissou, "9 des 15 Premiers ministres ont été impliqués ou inculpés
dans des scandales à un moment ou à un autre de leur carrière".
11
Mais le grand
déballage postérieur au traumatisme de Kobe fait bientôt apparaître les dessous de
l'euphorie spéculative des années 80, avec l'implication de la pègre dans les activités
spéculatives de l'économie licite: l'immobilier, le marché boursier et celui des oeuvres
d'art.
L'exemple de Susumu Ishii, le patron de la Inagawa-kai, le second syndicat du
crime japonais, est assez éloquent. Celui-ci emprunte 2,5 milliards de US dollars au
groupe Sagawa Kyubin, qu'il place en partie dans les maisons de titre Nomura et
Nikko, et en partie dans des investissements à New York et au Texas, en se payant le
luxe d'embaucher le propre frère du Président Bush, Prescott Bush, comme consultant
de son groupe !
12
Le reste de ces fonds contribue à financer le Parti Libéral
Démocrate par l'intermédiaire de l'ex- parrain de la politique japonaise, le
vice-président du PLD Shin Kanemaru.
13
Mais c'est surtout dans le domaine immobilier que se produit la convergence
entre les banques et le crime organisé. Comme l'observe l'analyste Koyo Ozeki, "la
bulle spéculative a détruit les murs qui se dressaient entre les économies formelles et
informelles".
14
Attirées par les perspectives de profit d'un marché immobilier en
pleine hausse, les banques créent des filiales de crédit au logement, les jusen, qui
8
Cf. Vincent Renard, "La corruption et l'immobilier au Japon", Rapport moral sur l'argent dans le monde, Paris,
1996.
9
Cf. Nahid Mohavedi, "Crise et scandale dans l'immobilier japonais", Rapport moral sur l'argent dans le monde,
1995, Paris, Association d'économie financière, p.230.
10
Cf. Philippe Pons, Le Monde diplomatique, mai 1989.
11
Cf. Jean-Marie Bouissou, in Della Porta et Mény (Direction), Démocratie et corruption en Europe, Paris, La
Découverte, 1995.
12
Idem, note précédente.
13
Cf. The Economist, 26/9/1996.
14
Cf. Financial Times, 12/12/95.

prêtent à haut risque à des promoteurs mafieux, expulsant par l'intimidation ou la
violence les habitants gênant leurs opérations. Les cadres récalcitrants des jusen sont
convaincus au besoin par les filles de joie fournies par les maisons mères
15
. Les
affaires prospèrent jusqu'à ce que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt pour
calmer la fièvre spéculative, déclenchant alors l'effondrement du marché immobilier
qui précipite la récession économique en 1991. Les sociétés de crédit, qui ont acheté
au prix fort du marché dans les années 80 s'avèrent incapables de rembourser la
moitié de leurs emprunts, qui s'élèvent à 130 milliards de US dollars.
En 1995, les créances douteuses des jusen s'alourdissent avec la baisse continue
des prix immobiliers. Elles passent de 65 milliards à 97 milliards de US dollars
(9.700 milliards de yens), dont environ 70 % sont attribués à la yakuza.
16
Les choses
se compliquent du fait de l'implication des coopératives agricoles, membres du
puissant lobby animé par le Parti Libéral Démocrate, qui ont financé les opérations
foncières des jusen à hauteur de 52 milliards de US dollars
17
. Le Ministère des
Finances, l'un des piliers de la technocratie japonaise, est lui aussi mêlé au scandale
puisque ses hauts fonctionnaires ont fermé les yeux sur les activités douteuses des
jusen, et n'ont pas hésité, comme l'écrit Christian Sautter, "à y pantoufler à des postes
éminents", en soutenant même, de concert avec le Ministère de l'Agriculture, la
poursuite de leurs opérations après les strictes mesures d'encadrement du crédit de
1990-91.
18
L'éclatement de la bulle spéculative et la chute libre des prix immobiliers, qui
peuvent atteindre un tiers de leur valeur des années 80, précipitent des règlements de
compte révélateurs. Les banques japonaises affichent des créances douteuses estimées
fin 1995 à 500 milliards de US dollars (50 trilliards de yens), dont 60 % (300
milliards de US dollars) seraient irrécouvrables, soit l'équivalent d'une douzaine de
Crédit Lyonnais, si l'on s'en tient aux dernières estimations.
19
Mais ces évaluations
sont souvent contestées : selon l'Union des Banques Suisses, le total des créances
douteuses s'élèverait à 688 milliards de US dollars.
20
L'adoption des normes de
comptabilité américaines par la Fédération Japonaise des Banques a provisoirement
tranché le débat. Les créances douteuses sont estimées fin 1997 à 76.710 milliards de
yens, soit 753 milliards de US dollars, ce qui représente 16 % du PIB japonais et 12
% de l'encours des crédits bancaires. Sur l'ensemble de ces créances, 11.400 milliards
de yens (90 milliards de US dollars), soit 15 % du total, sont considérés comme
partiellement ou totalement irrécouvrables selon les données officielles.
21
15
Cf. International Herald Tribune, 16/2/96.
16
Cf. Evelyne Dourille-Feer, L'économie japonaise, Ed La Découverte, collection Repères; Paris, 1998, p.59.
Sur l'estimation des dettes attribuées à la yakuza, cf. International Herald Tribune, 16/02/1996.
17
Cf. Business week, 29/1/96, p.16.
18
Cf. Christian Sautter, "L'économie japonaise en mutation", Politique étrangère, été 1996, p.307.
19
Cf. Evelyne Dourille-Feer, op. cit. pour les estimations des dettes fin 1995. Le rapprochement avec le Crédit
Lyonnais est fait par Christian Sautter, cf. note précédente. Selon certaines estimations, l'assainissement des
dettes du Crédit Lyonnais représenterait une charge de 150 milliards de francs (25 milliards de US dollars) pour
les contribuables français (Cf. Financial Times, 2/3/1998).
20
Cf. Business week, 29/1/96, p.15 et Asia Week, 3/5/96, p.52.
21
Cf. Financial Times, 13 /1/1998;14/1/1998.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%