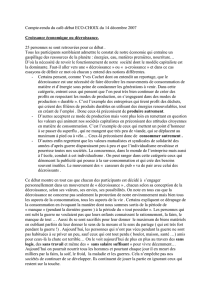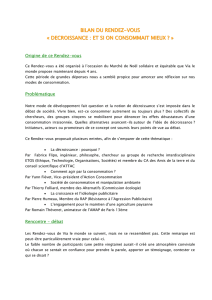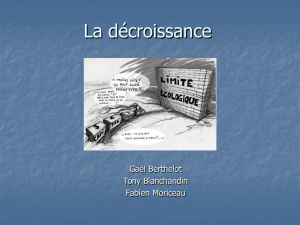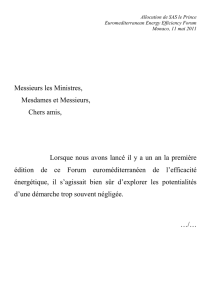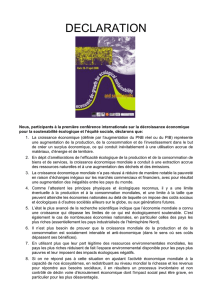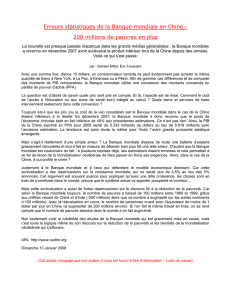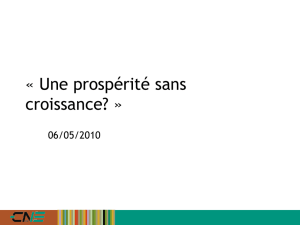I La croissance en question Croissance,croissance, croissance

I La croissance en question
Croissance,croissance, croissance ! Economistes, politiques, entrepreneurs, journalistes, tous
n'ont que ce mot à l'esprit quand il s'agit de parler des solutions à apporter aux maux de la
société. Souvent, ils oublient même que leur mot fétiche n'est qu'un moyen, et le posent en
objectif absolu, qui vaudrait par lui-même.
Cette obsession, qui rassemble la droite et la gauche, est aveugle à l'ampleur de la crise
écologique : changement climatique, mais aussi crise historique de la biodiversité et
contamination chimique de l'environnement et des êtres. C'est que l'instrument qui sert de
boussole aux responsables, le PIB (produit intérieur brut), est dangereusement défectueux : il
n'inclut pas la dégradation de la biosphère. Cela signifie que nous contractons à l'égard de
celle-ci une dette toujours croissante. La dérégulation émergente des grands écosystèmes
planétaires est le prix de cette dette. Si rien ne change, les annuités ne vont plus cesser de s'en
alourdir.
L'obsession de la croissance est aussi idéologique, car elle fait abstraction de tout contexte social.
En fait, la croissance ne fait pas en soi reculer le chômage : " Entre 1978 et 2005, le PIB en
France a connu une croissance de plus de 80 %, remarque Nicolas Ridoux dans le journal La
Décroissance d'avril. Dans le même temps, non seulement le chômage n'a pas diminué, mais il a
doublé, passant de 5 à 10 %. " Le Bureau international du travail et la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement confirment : malgré une hausse du PIB mondial de 5
% par an, le chômage ne diminue pas. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale
observent aussi que l'élévation du PIB ne fait pas reculer la pauvreté ni l'inégalité. En réalité,
l'invocation permanente de la croissance est un moyen de ne pas remettre en cause l'inégalité
extrême des revenus et des patrimoines, en faisant croire à chacun que son niveau de vie va
s'améliorer.
Il y a urgence à réinterroger le sens et le contenu de cette obsession moderne. Une piste nouvelle
est de viser la réduction des consommations matérielles, c'est-àdire des prélèvements que nous
faisons sur les ressources naturelles. Un rapport du Parlement européen, présenté en mars par la
députée Kartika Tamara Liotar, le propose : " Il convient de réduire par quatre, à l'horizon 2030,
la consommation de ressources primaires non renouvelables dans l'Union européenne. "
Rares sont les politiques qui prennent conscience de l'urgence. Le 16 janvier, dans une
conférence de presse à Paris, Alain Juppé déclarait : " C'est une autre croissance qu'il faut
inventer, qui s'accompagne d'une décroissance des gaspillages, et nous avons besoin, dans un
monde frappé par la pauvreté et les inégalités, d'une croissance moins consommatrice des
énergies et des ressources non renouvelables, une croissance respectueuse des équilibres
naturels, une croissance qui s'accompagne d'autres modalités de consommation et de
production. " Très beaux mots. Qu'il faut faire vivre, Monsieur le Ministre.
Hervé Kempf
II Institutions La Banque mondiale révise sa doctrine sur le développement
La hausse du PIB n'est pas synonyme de recul de la pauvreté

La communauté des économistes internationaux est en train de réviser sa doctrine sur le
développement, qui date de près de vingt-cinq ans. Dans les années 1980, l'équation était simple
: il fallait favoriser la croissance du produit intérieur brut des pays en développement pour que le
niveau de vie de leurs habitants s'élève. En effet, estimait-on, pourrait alors s'enclencher un
cercle vertueux de la consommation et de l'investissement capable d'assurer un enrichissement
collectif, régulier et autoentretenu.
En 1989, l'économiste américain John Williamson énonça les dix commandements faits aux
économies sous-développées ou émergentes pour amorcer et alimenter cette croissance. Connus
sous le nom de " consensus de Washington ", ces dix préceptes s'appellent : discipline
budgétaire, suppression des subventions, orthodoxie monétaire, dévaluation de la monnaie,
libéralisation des échanges commerciaux, libéralisation des mouvements de capitaux,
privatisation, déréglementation, réforme fiscale et renforcement du droit de propriété.
ORTHODOXIE ÉCONOMIQUE
Fondée sur une confiance absolue dans le marché, cette doctrine a apparemment réussi. En 2007
et pour la cinquième année d'affilée, la croissance mondiale approchera selon le FMI (Fonds
monétaire international) les 5 %, renouant avec les scores des années 1960. La Chine continuera
à caracoler en tête avec plus de 10 % de croissance ; l'Inde sera juste derrière avec 8,4 %. Les
continents et les régions qui ont tant besoin de ces progrès seront à la fête : on annonce +6,2 %
pour l'Afrique longtemps laissée pour compte et +5,5 % pour l'Amérique latine, l'Europe centrale
ou le Moyen-Orient.
Pourtant, les critiques n'ont pas manqué à l'égard du consensus de Washington. Mais elles
commencent seulement à persuader la communauté internationale que la situation est moins rose
qu'il ne semble. Le Prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz et de nombreux autres chercheurs ont
démontré que la croissance n'est pas corrélée avec le respect de l'orthodoxie économique. Certes,
les " dragons " Hongkong et Singapour sont exemplaires d'une libéralisation totale, mais la Corée
ou le Chili - cités eux aussi pour leur réussite - ont maintenu des politiques hétérodoxes, où
déficits budgétaires et protectionnisme conservaient leur place.
D'autre part, on découvre que la croissance ne signifie pas automatiquement le développement ou
même le reflux de la pauvreté. Le Bureau international du travail (BIT), par la voix de son
directeur général, Juan Somavia, ne cesse de dénoncer le maintien d'un taux de chômage mondial
à plus de 6 % malgré la croissance élevée. La Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced) souligne que le monde vit une croissance " sans emplois " en raison
de la concurrence à outrance.
La Banque mondiale elle-même est en passe de reconnaître qu'elle s'est illusionnée. Fin 2006, un
audit qu'elle avait commandé a vivement critiqué une de ses études claironnant que " la
croissance est bonne pour les pauvres ", relevant que les conclusions de cette étude " étaient
fragiles et incertaines ". Son économiste en chef, le français François Bourguignon, a déclaré à
plusieurs reprises que les inégalités entre pays se sont accrues et que la pauvreté fait de la
résistance. Son homologue du FMI, Simon Johnson, a reconnu, en avril, lors de l'assemblée
annuelle des deux institutions, que la répartition des bénéfices de la mondialisation était inégale.

Dans une économie en croissance, il est inévitable que les écarts entre les pays et entre les
individus s'aggravent, selon ces économistes : en situation d'accélération économique, les agents
les mieux informés et organisés sont les premiers à profiter des opportunités de la croissance.
Mais la suppression des filets sociaux et des interventions étatiques empêche la correction de ces
déséquilibres.
C'est pourquoi réapparaît depuis deux ou trois ans dans les textes de la Banque mondiale, du FMI
et même de l'Organisation mondiale du commerce la nécessité d'une présence publique dans le
domaine des infrastructures, mais aussi de l'agriculture et de la protection sociale. L'Etat, lui
aussi, est nécessaire pour que la croissance se mue en développement durable. Sinon, laissée à
elle seule, elle semble ne pas y parvenir.
Alain Faujas
III Affaires Les entreprises explorent les promesses d'une " autre croissance "
Réduire les émissions de gaz carbonique sans diminuer l'activité économique, est possible
C roissance verte " ou" autre croissance ", l'idée n'est apparue que récemment. Les économistes
patentés prenaient soin d'ignorer les débats sur le développement durable. Le réchauffement
climatique a bousculé les frontières. Et il n'est plus rare de voir l'un de ces experts prôner
sérieusement une révolution écologique. Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la Banque
mondiale et conseiller de Tony Blair, en est un peu devenu le symbole en publiant à l'automne
2006 son rapport sur " Les aspects économiques du réchauffement climatique " (Stern Review on
the Economics of Climate Change). Cette somme de 600 pages aura sans doute fait autant pour
secouer les consciences des milieux dirigeants que le spectacle de la fonte des glaciers ou les
dérèglements répétés du ciel. Son message est double : le premier affirme que l'inaction aurait un
coût infiniment plus lourd que l'action elle-même. Ne rien faire serait s'exposer à voir s'envoler
entre 5 % et 20 % du produit intérieur brut mondial à l'horizon 2050, alors qu'il " suffirait " de
dépenser chaque année 1 % de cette richesse pour limiter la hausse moyenne des températures à
2 degrés d'ici à la fin du siècle. Mais - c'est son second message -, " le monde n'a pas besoin de
choisir entre éviter le changement climatique et promouvoir la croissance ". Les deux objectifs
seraient compatibles, à condition d'inventer une nouvelle croissance économe en carbone pour
limiter les rejets de gaz à effet de serre. " C'est tout à fait possible, assure Philip Bagnoli,
économiste à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La
faisabilité technologique est moins un obstacle que l'absence de volonté politique. Or, pour
s'engager - que ce soit parce qu'émettre du carbone coûtera de plus en plus cher ou que ce soit
pour profiter d'incitations publiques à produire propre -, les entreprises ont besoin de visibilité.
" Celle-ci fait défaut. L'avenir du protocole de Kyoto demeure une inconnue après 2012. L'Union
européenne a lancé, seule, en 2005, ce qui est aujourd'hui le plus important marché de permis
d'émission de gaz à effet de serre, mais à l'avenir incertain.
Si seule une entreprise sur dix mesure totalement ses émissions de gaz carbonique, selon une
étude réalisée en mai par l'Economist Intelligence Unit auprès de 634 d'entre elles à travers le
monde, il semble cependant qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se préoccuper de leur
impact écologique. " Tous les industriels européens cherchent à trouver des solutions

alternatives aux énergies fossiles, car elles font l'hypothèse que la tonne de CO2 émise pourrait
leur être facturée aux environ de 30 dollars d'ici une quinzaine d'années ", explique Eric
Duvaud, responsable du développement durable, chez Ernst & Young. La fin annoncée du
pétrole est évidemment une autre motivation.
Les économistes convertis mettent aussi en avant les gisements d'activité et d'emplois que recèle
cette nouvelle façon de penser la croissance, notamment dans le secteur de l'habitat et de la
construction, responsable d'un quart environ des rejets de CO2. La Commission européenne, qui
s'est engagée à réduire de 20 % sa consommation d'énergie d'ici à 2020, prévoit ainsi la création
d'un million d'emplois.
Il serait même possible de faire davantage, selon un rapport intitulé Changement climatique et
emploi, et présenté en mai au Congrès des syndicats européens par le cabinet d'expertise Syndex.
Les analystes estiment que les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 40 % d'ici à 2030 pourraient générer un million de postes dans le bâtiment, du fait des
travaux correspondant à une haute qualité énergétique. Le transport recèle aussi un " énorme
potentiel " de création d'emplois dans les modes de transports alternatifs, selon l'étude, soit
environ 300 000 emplois en Europe. Et les pertes d'emplois liées à une baisse de l'ordre de 16 %
de la consommation d'électricité seraient largement compensées par l'augmentation des énergies
renouvelables.
Faire des affaires tout en prenant soin de la planète semble ainsi pouvoir être une opération "
gagnant-gagnant " dans les secteurs à l'abri de la concurrence internationale. En revanche, sur
une scène mondiale où les règles ne sont pas - et pour longtemps encore - identiques, le "
dumping climatique " pourrait bien devenir une nouvelle arme dans la compétition internationale.
Laurence Caramel
IV " Décroissants " Ils travaillent moins, ils gagnent moins, et ils sont heureux
" Moins de biens, plus de liens " est un de leurs slogansLes " objecteurs de croissance "
inventent un nouveau mode de vie
CARHAIX-POUGUER (FINISTÈRE) ENVOYÉE SPÉCIALE
Le petit logement d'Arzhel et Anna n'est pas très différent de la moyenne. Le téléphone y sonne
souvent. Une chaîne audio trône dans le salon. Mais il n'y a ni télévision, ni réfrigérateur. Le
jeune couple franco-brésilien ne consomme que des céréales et des légumes frais biologiques.
Emmailloté dans des couvertures colorées, un bébé d'un mois sommeille. Anna a donné
naissance à Nawe dans l'appartement, aidée d'une sage-femme.
Avec pour seul revenu le salaire de cuistot d'Arzhel, le couple vit très simplement à
Peumerit-Quintin (Côtes-d'Armor). Par choix. " Pour moi, c'est la seule solution pour la planète,
affirme Anna. Si nous continuons à abuser de ses ressources, les générations futures n'auront
plus rien. " " Nous réduisons certaines choses comme la consommation de biens et d'énergie,
mais nous y gagnons du temps pour nous, et la possibilité d'organiser notre vie comme nous le
voulons ", poursuit Arzhel. Il a participé à des marches pour la décroissance, et estime faire
partie de ce mouvement, sans pour autant revendiquer l'étiquette de " décroissant ", jugée
réductrice - ni aucune autre d'ailleurs.

Le terme consacré est celui d'" objecteur de croissance ". Certains parlent de " simplicité
volontaire ", ou de " sobriété ". Leur engagement mêle souvent choix de vie personnel,
convictions écologistes et militantisme politique. Quand le reste de la société ne songe qu'à
augmenter son pouvoir d'achat, ils préfèrent travailler moins, gagner moins, et dépenser moins.
La majorité des gens a un régime alimentaire moyen de plus en plus industriel et calorique, passe
des heures devant la télévision, " s'évade " quelques jours au Maroc ou aux Maldives, utilise des
objets toujours plus vite remplacés. Les objecteurs mangent bio, végétarien, et local, ignorent la
télévision et préfèrent lire, se déplacent à pied, à vélo, ou en train et ne prennent l'avion qu'en
dernier recours, réparent les objets, les réutilisent, les échangent, et partagent ce qui peut l'être :
machines à laver, ordinateurs, voire logements.
Cela ne signifie pas renoncer à tout. " Je ne suis pas un homme des cavernes, sourit Armand, 30
ans, installé dans une petite maison de pierre bretonne. J'ai l'électricité - tout en surveillant ma
consommation. J'adore le téléphone. Et la voiture, quand on vit dans le centre de la Bretagne, ce
n'est pas négociable. " " La simplicité volontaire, c'est un concept en chantier, on ne signe pas
de charte ", relève-t-il. En revanche, malgré un revenu de quelques centaines d'euros par mois,
Armand ne mange que bio. " La décroissance est un objectif vers lequel on tend, chacun a ses
limites ", affirme également Christophe, rédacteur sur infogm.org, un site internet consacré aux
OGM.
Si le mensuel La Décroissance est parcouru chaque mois avec reconnaissance par des lecteurs
très méfiants vis-à-vis des médias grand public, il n'est donc pas pris au pied de la lettre. " Si tu
les écoutes, de toute façon, tout le monde a tort ", dit Armand.
Pour certains, le changement se fait par petites touches. Cela commence par l'alimentation ou les
déplacements. " Quand on est cycliste, on prend conscience de ce qu'est l'énergie parce qu'on
doit la produire soi-même, dit Pierre, un Parisien membre de l'association Vélorution. On réalise
l'extraordinaire gâchis autour de nous. "
Béatrice, elle, a tout lâché d'un coup. " J'avais un commerce à Brest, ça marchait bien, il ne
restait qu'à le faire grossir, raconte la jeune femme, aujourd'hui installée à Carhaix. On veut
gagner plus, avoir plus, mais à un moment on n'est pas satisfait de la vie qu'on a. On risque de
tomber dans l'engrenage boulot, stress, médicaments, passivité. " Béatrice travaille aujourd'hui
au développement du commerce équitable local. Elle est hébergée chez un ami et ne possède
rien. " Je sais que ça paraît difficile de vivre cette vie, mais très vite on se rend compte que c'est
très facile, et même très agréable ", dit-elle.
" Pratiquer la décroissance apporte une richesse incroyable, car quand tu consommes moins, tu
travailles beaucoup plus ton imaginaire ", confirme Helena, une Suédoise de 37 ans qui a élevé
trois enfants en Bretagne, tout en vivant dans des conditions sommaires. La petite roulotte
familiale est aujourd'hui délaissée en faveur d'un gîte. Et Helena s'avoue un peu lasse de cuisiner
toute la journée pour sa famille. " La décroissance, ça prend du temps, il faut le savoir ",
sourit-elle. Elle aimerait " s'ouvrir davantage vers l'extérieur ". Si l'objectif ultime des objecteurs
de croissance est l'autonomie complète sur le plan matériel, la plupart n'apprécient pas la
solitude. " Moins de biens, plus de liens " est un de leurs slogans.
Ils constatent pourtant qu'une certaine agressivité les entoure. " 80 % des gens condamnent mon
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%