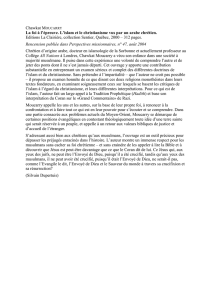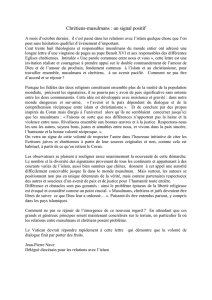J`ai lu attentivement le discours de Benoît XVI à Ratisbonne sur les

J’ai lu attentivement le discours de Benoît XVI à Ratisbonne sur les relations entre la raison et la
foi qui fait des vagues chez les Musulmans.
Il est évident que la Pape a pris plaisir à donner un cours magistral de théologie dans cette chaire
qu’il a occupé de 1969 à 1977. Il ne parle pas en Pape mais en professeur érudit lorsqu’il cite pour
commencer sa lecture récente d’un intéressant échange ayant eu lieu en 1391 entre un chrétien et un
musulman sur la vérité respective de leur religion. Son propos aurait fait l’unanimité s’il s’était borné à
souligner que la différence essentielle entre le Christianisme et l’Islam est dans le dogme de
l’Incarnation. Pour les Musulmans, Jésus-Christ n’est qu’un homme, un très grand prophète, alors qu’il
est pour les Chrétiens vrai Dieu et vrai Homme.
Ceci posé, il aurait pu s’en tenir à montrer en quoi l’Incarnation a servi l’activité rationnelle au
sein de la Chrétienté sans argumenter par rapport à l’Islam dont la rationalité, notamment en matière de
Djihad, est il est vrai desservie chez les Islamistes par l’absence de ce dogme. Mais tous les musulmans
ne sont pas islamistes et la citation rapportée est loin de traduire toute le richesse du débat sur la raison
et le foi très animé au Moyen Âge et de nouveau très vif aujourd’hui chez ceux qu’on appelle “les
nouveaux penseurs de l’Islam”. De plus, en soulignant comme il le fait ce que le christianisme doit à la
rationalité grecque, il oublie que ce sont les philosophes arabes qui ont fait connaître Aristote aux
théologiens chrétiens.
Au lieu d’introduire son discours par ce contrepoint simplificateur malencontreux, il aurait pu
s’interroger sur le fait patent que la science moderne est née dans le berceau de la Chrétienté.
Il aurait pu à cet égard faire appel à deux penseurs contemporains, agnostiques et d’origine juive,
dont je vais citer deux extraits qui me paraissent beaucoup plus stimulants que la citation qui sert
d’introduction au Pape.
Le premier est Alexandre Kojève dans "Origine chrétienne de la science moderne"-Revue
Sciences n°31 -Mai-Juin 1964 :"Si le christianisme est responsable de la science moderne, c'est le
dogme de l'incarnation qui en porte la responsabilité exclusive. (...) Qu'est-ce que l'incarnation, sinon
la possibilité pour le Dieu éternel d'être réellement présent dans le monde temporel où nous vivons
nous-mêmes sans déchoir pour autant de son absolue perfection ? (...) Si, comme les chrétiens croyants
l'affirment, un corps terrestre peut être «en même temps» le corps de Dieu et donc un corps divin, et si,
comme le pensaient les savants grecs, les corps divins reflètent correctement les relations éternelles
entre des entités mathématiques, rien n'empêche plus de rechercher ces relations dans l'ici-bas autant
que dans le ciel.”
Le second est George Steiner qui enracine la linguistique moderne dans la théologie judéo-
chrétienne ”Je ne puis parvenir à aucune détermination du sens ou de l’existence qui ne parie sur une
transcendance”(p67) “nos grammaires, nos explications, nos critiques de textes sont des héritières
directes des textualités de la théologie judéo-chrétienne..; (nous n’avons fait) qu’emprunter à la
banque ou au trésor de la théologie.... très peu d’entre nous ont remboursé” (p 64).“Le sens du sens”
(Vrin -1988)
À l’appui de la thèse de Kojève, je pose cette question : quelle est en effet la bonne nouvelle de
l’Incarnation si ce n’est que nous sommes fils de Dieu, du même sang que le Christ notre frère,
participants de la même chair et à la même raison, membres de son corps que nous faisons croître et qui
nous nourrit, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble, au terme de cette libre coopération entre
Dieu et l’Homme, à l’unité de la vérité révélée par la foi et de la vérité dévoilée par la raison.
À l’appui de la thèse de Steiner je préciserais seulement qu’il est spécifique de l’Islam de parier
tout particulièrement sur une transcendance et que le trésor auquel empruntent les sciences humaines
est judéo-islamo-chrétien.
Si n’est pas mieux comprise cette dynamique de l’histoire du salut, progressant à tâtons vers la
vérité tout entière sur le dessein de Dieu, dans la perspective de son intelligibilité finale, je ne vois pas

comment sera combattue la thèse de l’Intelligent design selon qui ce dessein éclaire déjà la raison de
l’homme comme un phare sur lequel il suffit à chacun de mettre le cap, tel un robot téléguidé. Il paraît
que le Vatican se penche sur la question ; je suis curieux d’apprendre ce qu’il va dire.
1
/
2
100%