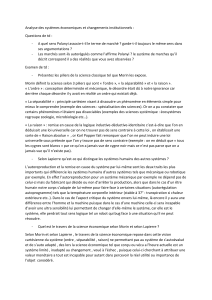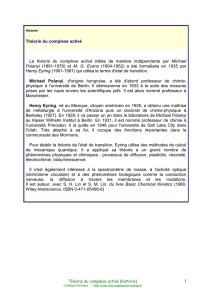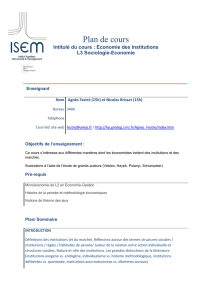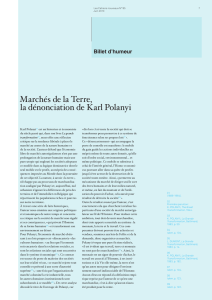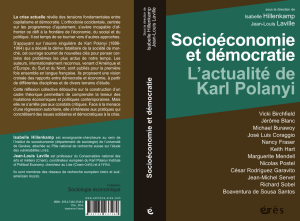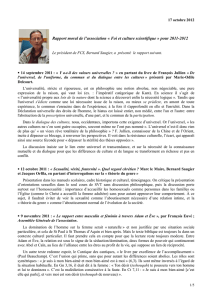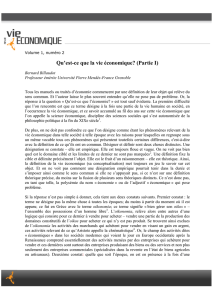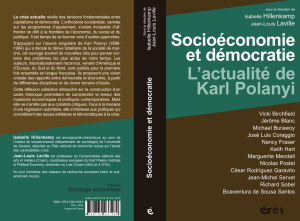Karl Polanyi et le socialisme du possible

Congrès Marx International V – Section Socialisme – Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre
2007
Jérôme Maucourant
Maître de conférences à Université Jean Monnet de Saint-Etienne
UMR 5206 Triangle (ENS-LSH, Lyon 2 et IEP de Lyon)
http://triangle.ens-lsh.fr/article.php3?id_article=232
Karl Polanyi et le socialisme du possible
1
Durant les 1920 s'est développée une controverse décisive pour la théorie économique.
Mises
i
, avec force, conteste la possibilité même du socialisme comme alternative concrète au
capitalisme. En effet, seul ce second système pourrait promouvoir un calcul économique rationnel
comme norme orientant les comportements. Mais, le débat sur le calcul économique socialiste
aboutit au résultat que la théorie de l'équilibre général ne semble décidément pas incompatible avec
un certain type de direction centrale de l'économie
2
. Ainsi peut s'expliquer la naissance de la
«nouvelle» école autrichienne qui revendique la théorie authentique du capitalisme
3
. Toutefois, ce
constat nous semble insuffisant.
Dans un article de 1922, "Comptabilité socialiste" ("Sozialistische Rechnungslegung"), Karl
Polanyi cherche, quant à lui, à montrer qu'il est possible de promouvoir une forme de calcul
économique rationnel à l'intérieur d'un modèle "fédéral" de socialisme
4
. Des protagonistes
contemporains de ce débat, tels Hayek et Mises, jugeaient important de combattre un point de vue
qui acceptait leurs objections sur la nocivité de la planification centralisée et impérative, tout en
voulant préserver l'exigence socialiste de justice.
En premier lieu, nous présenterons certains aspects du modèle fédéral pour mettre en évidence le
mécanisme de comptabilisation rationnelle des coûts. Nous montrerons alors que ce système
requiert une forme d'institution monétaire, parce que Polanyi ne semble pas concevoir de société
sans monnaie
5
, parce que l'indépassable existence d'une unité de compte et d'un moyen de paiement
est liée, chez cet auteur, à une vision non totalitaire de la société. Finalement, la possibilité de
discuter les prix renvoie à des évaluations contradictoires qui émane du jeu spontané des instances
élémentaires de la société. Rejetant toute forme centalisée fixant a priori les taux de substitution
entre biens, Polanyi cherche à établir un espace de discussion raisonnable permettant d'orienter le
développement économique, le marché étant une dimension de cet espace.
Ce modèle n'a pas suscité que des critiques libérales ou étatistes. Il convient également de
vérifier la solidité de celui-ci par rapport à certaines des objections plus modernes, après avoir
évoqué quelques prolongements du débat incluant, plus particulièrement les apports de Mises. Il
apparaîtra qu'on ne peut soutenir aisément, comme le pensait Mises, l'idée selon laquelle le
socialisme relève d'une discussion purement scientifique. Si ce système, comme Polanyi envisage
de le montrer, rend possible des formes de calcul économique aussi rationnelles que dans le
capitalisme libéral, alors le débat ne peut exclure certains jugements de valeur.
§1/ Le «socialisme confédéral» et la question de la comptabilité rationnelle
A. Du refus du capitalisme à la critique de l'économie planifiée
Si les marxistes ont souvent mis l'accent sur le gaspillage lié à la production capitaliste, Polanyi
souligne que le socialisme ne peut se définir seulement par la recherche d'une productivité
maximale. Cet idéal est aussi volonté d'établir de la "justice sociale". Doit-on, à cet égard, oublier
les nombeuses formes de monopoles, d'aléas conjoncturels qui rend possible les"unearned
incomes"
6
? L'extension de ces revenus de pure spéculation et de manipulation des marchés peut
aller jusqu'à réduire les revenus du travail au point que certains ne pouraient plus disposer du «droit
à la vie»
7
. L'originalité du socialisme polanyien est là : l'accent n'est pas mis sur l'aliénation du
travailleur mais sur les manquements à la morale que l'idéal de justice nous fait constater dans notre
i

Congrès Marx International V – Section Socialisme – Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre
2007
expérience quotidienne du capitalisme. Polanyi se refuse à penser que la décentralisation des
décisions soit la raison ultime des maux de ce système. Au contraire, le plan central et coercitif
causera une chute de la productivité des facteurs ; l'exigence de justice dans un tel système étant une
cause supplémentaire de difficultés. Ceci pour deux raisons :
1. Manifestement, il est impossible d'avoir accès aux informations nécessaires. Si certaines
statistiques peuvent permettre d'établir des renseignements utiles sur la gestion des processus de
production
8
, il est illusoire d'établir de façon centralisée et a priori, les coûts de l'«effort de travail»
(Arbeitsmühe), dont la théorie traditionnelle rend compte par le concept de "désutilité"
9
. Le
paradoxe réside dans le fait que les partisans du socialisme centralisé en viennent à nier l'homme et
la peine inhérente à son travail. Comme si le "procès de travail " n'était pas, avant tout, le résultat
d'une interaction entre un moyen de travail, objet de travail et sujet actif ; ce dernier ne devenant
force de travail, anonyme et à vil prix que dans le capitalisme.
2. N'ayant pas les moyens de connaître la pénibilité du travail, ce type de socialisme est donc
incapable d'évaluer le coût de la justice sociale parce qu'il n'y a pas de dispositif institutionnel qui le
permette. Sans doute, faut-il rechercher dans l'absence de distinctions effectuée par le «socialisme
scientifique», entre les institutions à vocations économiques particulières et les institutions à
finalités explicitement politiques, la raison d'être d'une telle difficulté. Or, seule une évaluation
décentralisée et contradictoire permettrait de donner une mesure raisonnable des surcoûts sociaux, à
cadre institutionnel donné. Il importe de remarquer enfin que l'idée d'un surcoût social n'a de sens
que si l'arbitraire est exclu du processus comptable.
B. Les principes d'un «socialisme fédéral»
Ces principes ne seront posés que pour autant qu'ils permettent la solution de notre problème :
quel type de socialisme, c'est-à-dire quel type d'organisation permettant de trouver une combinaison
harmonieuse entre l'impératif de productivité maximale et de justice sociale, pourra fournir les
bases d'une comptabilité rationnelle. Polanyi juge nécessaire la socialisation des moyens de
production mais cette appropriation ne dit rien a priori sur la nature de la gestion des unités
économiques, étatique ou démocratique et décentralisée?
En réalité, le type de cette gestion dépend des formes d'organisations politiques. Or celles-ci,
chez Polanyi, sont régies par le principe de "fonctionalité" découlant de l'observation suivante :
"L'homme comme producteur, ou consommateur, représente deux aspects des motivations
humaines qui sont déterminées par un processus vital unique - l'activité économique de
l'individu"
10
.
D'où la possiblité de représenter le citoyen par deux entités fonctionnellement séparées, sans
craindre pour autant qu'un conflit sans issue naisse de ces deux instances. Au fond, n'est ce pas cette
même personne humaine qui est doublement représentée
11
? Il paraît donc peu vraisemblable, qu'au
niveau le plus important de la la vie politique (les instances confédérales suprêmes), subsisteraient
des conflits permanents entre producteurs et consommateurs.
La transparence des processus économiques produite par le fonctionnement du modèle permette
aux citoyens de participer de façon responsable aux débats politiques et économiques :
"A travers leurs représentants, les individus sont confrontés à la tâche de se confronter eux-
mêmes"
12
.
En conséquence, Polanyi propose que les groupes élémentaires de production - fédérations
régionales par secteurs - s'associent au niveau national de façon à constituer un "congrès de
producteurs". Il est prévu que ces groupes autogérés doivent dégager un niveau de revenus tels que
les salaires, les surcoûts dus aux exigences de justice sociale et de l'investissement, puissent être
financés. Des mécanismes semblables à la faillite semblent inscrits par essence dans le modèle
proposé de façon à rendre possible la réallocation du capital selon la variation de la demande.
Polanyi attache un grand prix aux ajustements de marché, même s'il refusait l'idée qu'un système de
marché concurrentiel totalement interconnecté -le one big market- constituât l'idéal économique.
Enfin, l'équilibre financier des groupes n'est qu'une conséquence nécessaire de l'autonomie
revendiquée pour ces entités, étant entendu que cette exigence de l'équilibre microéconomique ne

Congrès Marx International V – Section Socialisme – Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre
2007
doit pas être jugée antinomique avec celle d'un revenu pour tous, c'est-à-dire du droit à la vie dans
une société moderne
13
.
Polanyi propose aussi que des fédérations de consommateurs soient organisées de la même façon
que les associations de producteurs. Les prix résultent alors d'une procédure de marchandage
décentralisée, ceux-ci n'étant pas des prix purement concurrentiels. Les fédérations de
consommateurs doivent par ailleurs s'associer pour s'intégrer dans l'instance politique centrale, la
Commune (Die Kommune). A propos de celle-ci, Polanyi précise toutefois:
"Le rayon d'actions de la Commune est plus étroit que celui de l'Etat moderne (nous
soulignons), bien qu'il puisse paraître plus varié en raison de sa différence"
14
.
Certes, la Commune intégre finalement, outre les consommateurs fédérés, les conseils des
délégués des citoyens de la nation. Elle pourrait donc comme instance politique détenir le "pouvoir
suprême" -selon le mot même de Polanyi. Cependant, les décisions ne peuvent être le fruit d'un
accord excluant le congrès des producteurs ; les inévitables litiges, nécessairement transitoires
comme le suppose l'approche fonctionnaliste, sont remis à une juridiction supérieure. Ainsi l'Etat,
s'il faut encore parler d'«Etat» dans le système polanyien, apparaît plutôt être une confédération à
même de recréer l'unité de l'homme, qui est toute à la fois producteur, consommateurs et citoyens
15
.
Maintenant que les formes politiques et économiques du modèle ont été esquissées, il importe de
comprendre comment concrètement peut se former un système de comptabilisation des coûts qui est
condition d'efficacité et de transparence. Toutefois, un tel exposé présuppose la connaissance de
l'articulation entre la question des prix, celle de la monnaie et du socialisme.
C. L'impératif du socialisme devant la nécessité de la monnaie et des prix
Sans évaluation conflictuelle, il ne peut exister de connaissances permettant aux unités
élémentaires et décentralisées d'agir par l'intermédiaire du système des prix. Toutefois, en dépit de
l'impression que peut donner le texte de 1922, Polanyi accordait une grande attention à la monnaie
comme moyen de paiement
16
. Plus explicitement, Polanyi affirme que refus de l'économie naturelle
n'équivaut pas à un plaidoyer en faveur de la pure économie d'échange" (ou de troc,
Tauschwirtschaft) ; une "économie à pouvoir d'achat" étant possible (Kaufkraftwirtschaft)
17
.
Autrement dit, le choix des consommateurs peut être sauvegardé, même si la fonction monétaire de
"réserve de valeur", si essentielle à la vision classique de la monnaie, n'est que peu assurée.
D'ailleurs, Keynes lui-même, bien que partisan de l'économie de marché n'a-t-il pas voulu
réactualiser la monnaie fondante ?
Plus tard, Polanyi sera très explicite. Il affirmera que si l'institution de la monnaie est
consubstantielle à la société, il ne s'ensuit pas que les pratiques monétaires, dans leurs formes et
leurs significations sociales, soient immuables. Par exemple, dans les sociétés primitives, les
fonctions monétaires sont réparties strictement selon des objets monétaires précis et, de plus, les
dettes peuvent ne pas être payées uniformément avec un type de monnaie, appelée pour cette
raison"monnaie monofonctionnelle"
18
. Au contraire, bien différente est la nature de la monnaie
moderne qui peut assurer, simultanément les fonction de compte, paiement et réserve de pouvoir
d'achat. De plus, cette monnaie moderne remplissant des obligation sociales extrèmement variées :
on peut alors parler de"monnaie plurifonctionnelle"
19
.
L'institution de la monnaie plurifonctionnelle, si moderne soit-elle, est en fait contingente car
elle est liée à cette autre réalité contingente, réversible et dépassable de l'économie de marché. Le
projet d'une monnaie pratiquement dénuée de capacité de réserve, même s'il est éloigné de l'idéal de
la monnaie-marchandise, ne constitue donc pas un projet d'altération de l'ordre monétaire. Tout au
contaire, il peut contribuer à lui donner un autre sens.
Si la continuité de la pensée de Polanyi sur cette question de la monnaie nous semble assurée,
pareille interprétation nous semble possible quant au marché. Plus tard, Polanyi remarquera que la
Grande Dépression des années 1930 a impliqué une «resocialisation» de l'économie, dans des
formes aussi variées que la social-démocratie ou le New Deal
20
. En particulier, les abandons

Congrès Marx International V – Section Socialisme – Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre
2007
successifs de la discipline de la monnaie-marchandise traduisirent ce mouvement de resocialisation
qui est aussi le mouvement important de réimbrication de la monnaie dans les liens sociaux tel que
le souligne le propos récurrent de la Grande Transformation selon lequel : "Laissez-faire was
planned, planning was not". Plus généralement, l'aboutissement des ces transformations signifient
"the end of market society".. La réalité nouvelle consiste"in no way absence of markets", ceux-ci
assurant :
"freedom of consumers, to indicate shifting of demand, to influence producers' income, and to
serve as an instrument of accountancy, while ceasing altogether to be an anorgan of self
regulation"
21
..
Polanyi ne cesse donc d'affirmer que l'institution de la monnaie et du marché ont une place
importante dans la société. Le seul danger réside, toutefois, dans la volonté d'instituer la monnaie
comme pure émanation de la marchandise et le marché comme entité auto-régulatrice.
En développant le point de vue de Polanyi sur le caractère à la fois transhistorique et évolutif de
l'institution de la monnaie, on est en droit de souligner que la reconnaissance du "droit à la vie" rend
moins nécessaire l'exercice de cette «liberté» qu'est l'épargne de précaution. Bien plus,
l'accumulation de monnaie "tous usages", par le biais de l'héritage est peut être un frein à la mobilité
sociale. Enfin, la détermination de l'épargne sociale en régime capitaliste de monnaie de crédit n'est
sans doute pas le fruit des décisions individuelles d'épargne, mais sans doute bien la conséquence
d'une multitude de paris de producteurs indépendants
22
. Il apparaît alors que les discussions entre
fédérations de producteurs et de consommateurs sur le niveau optimal d'investissement rendent
moins probable le phénomène de l'«épargne forcée» dont le capitalisme, en période de plein emploi
des facteurs au moins, est assez familier.
Ainsi la liberté n'est elle pas négation des coûts de l'idéal mais d'abord conscience de ceux-ci ;
l'échange monétaire n'est pas nécessairement aliénation, mais moyen possible de l'évaluation
décentralisée des besoins et de la peine de l'homme. On mesure mieux, dès lors, toute la distance
qui sépare un système des prix socialistes du système des prix capitalistes. F. Von Wieser
remarquait déjà
23
:
"On ne peut, sans considération particulière, prendre les prix pour l'expression sociale de la
valeur des marchandises: ceux-là résultent d'un conflit mené au-dessus de ces marchandises,
(conflit) dans lequel le pouvoir, à côté des besoins, et plus que le besoin, a été à même d'emporter
la décision... tout ceci déforme les prix... qui résultent de l'inégalité des moyens des acheteurs et
sont, je le soutiens, inextricablement liés à notre régime économique".
La monnaie de compte et de paiement est donc condition de possibilité du socialisme de Polanyi.
La démonstration de la nécessité de l'institution monétaire, quel que soit le type de société envisagé,
permet dès lors de développer les principes d'une véritable comptabilité socialiste.
D. Comptabilité et fédéralisme économique
Il est curieux que, très explicitement, Polanyi refuse l'idée selon laquelle la présentation des
principes comptables présupposerait une théorie véritable de l'économie socialiste. Il affirme même
que les faits économiques, les concepts comptables et la théorie seraient autant d'ordres distincts
dans la formation de la connaissance
24
. En réalité, cet effort de démarcation vis-à-vis de la théorie
est discutable. D'abord parce que le degré de transition vers le socialisme est largement "idéel"
comme Polanyi le reconnaiî lui-même
25
. Ainsi donc, comment les concepts comptables pourraient-
ils refléter une réalité pour le moins non effective? Plus profondément, le fait même de concevoir
l'hypothèse d'une économie décentralisée, principalement fondée sur le principe d'échange et ne
menant pas nécessairement au chaos, est un acte théorique par nature. L'idée d'une comptabilisation
rationnelle des coûts doit être alors vu comme un pilier de cet édifice théorique. C'est sans doute
pourquoi Hayek et Mises virent en Polanyi un adversaire qu'il fallait considérer.
La position est délicate : les libéraux pourront soutenir que la fixité de certains prix, dont
Polanyi estime que la détermination doit être politique, peut être un obstacle à tout le processus

Congrès Marx International V – Section Socialisme – Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre
2007
économique efficient. Ce type d'objection suscite une double réponse. La première a trait à
l'équilibre que ne pourrait connaître une telle économie
26
. La seconde concerne l'imputation
rationnelle des coûts, véritable condition de possibilité du modèle. Seul ce second point nous
occupe pour l'instant.
Polanyi estime qu'une comptabilité rationnelle n'est possible que si l'on peut établir une
distinction, quantitativement évaluable, entre coûts "naturels" et coûts "sociaux" de la production.
Or, l'autonomie comptable des unités élémentaires de production est le moyen de distinguer les
coûts, qui résulte directement de processus de production et les autre coûts, exprimant les impératifs
de la justice sociale tels qu'ils sont esquissés par la Commune. Ainsi chaque bilan élémentaire
comporte-t-il deux relevés distincts. La classification des coûts apparaît ici comme un premier
élément de résolution du problème. Les distributions en nature ou à prix coûtant peuvent être
clairement imputées au compte "coûts sociaux" de même que les surcoûts dus à des localisations
non optimales d'un point de vue techno-économique des unités de production
27
. Les "coûts naturels"
intégrent, quant à eux, l'usure du capital, les salaires et prix des matières premières. Polanyi
précisera que ces différences dans la nature des coûts sont conceptuelles, précisément lié à un
traitement statique de la question
28
. Bien sûr, le changement technique peut entraîner des
modifications considérables dans l'évaluation des coûts exigés par la production. Toutefois,
souligne Polanyi, qu'est-ce qui empêche que les négociations périodiques entre groupes de
producteurs et de consommateurs n'incluent pas cet élément dans la négociation
29
?
Plus profondément, il apparaît que les différences conceptuelles de coûts renvoient à une
définition singulière du "naturel". Les processus "naturels" ne sont jamais rien d'autre que les
processus émergeant spontanément d'un cadre institutionnel défini. Ce qui distingue Polanyi des
néoautrichiens, c'est que le premier estime possible l'invention en matière institutionnelle, pourvu
que la conscience des hommes laisse suffisamment de place à certains automatismes, alors que les
seconds excluent cette possibilité
30
.
Néanmoins, si la distinction entre coûts sociaux et coûts naturels est possible, le problème
fondamental de la comptabilité socialiste n'est pas pour autant vraiment résolu. En effet, le modèle
fonctionnel de Polanyi entraîne la coexistence de deux types de prix : à côté des "prix fixes"
exprimant les finalités collectives existent nécessairement des "prix négociés"
31
, que ce soit sur les
marchés des biens de consommation ou de production
32
. La discussion de la possibilité de
coexistence de ces deux régimes de prix est cruciale pour la réalisation d'un socialisme fonctionnel.
Observons le cas de la fixation artificielle du prix des inputs primaires, tels les matières
premières. Dans ce cas, il n'y pas d'influence sur la logique du système des prix négociés. Il en va
différemment des biens intérmédiaires
33
. Si, en aval du processus, ces biens peuvent être
considérés comme desn input primaires, il n'en va pas de même en amont : la fixation artificielle
des prix ne permet plus de comptabilisation rationnelle. Pour que l'unité autonome ne subisse pas
des déficits dont on ne peut pas comprendre l'origine véritable, il est nécessaire que l'unité de
production ne supporte pas le coût social qui, par construction, lui est étranger.
Bien que Polanyi ne soit pas ici explicite, il est clair que la monnaie comme moyen de paiement
doit subsister de façon à équilibrer ce coût social visible dans les comptes de l'unité de production
34
.
L'essentiel de la solution de Polanyi repose donc crucialement sur la possibilité de distinction des
coûts selon leur nature et sur le fait que, globalement, la somme des surplus dégagés au-delà des
salaires doit couvrir les coûts sociaux et l'accumulation en biens de production
35
. Certes, des
discussions entre fédérations constituant l'«Etat» peuvent fixer les orientations de l'accumulation
selon la finalité propre à la "justice sociale", mais
36
"le côté techno-économique lui-même de l'investissement, relève uniquement de groupe du
production".
Ainsi Polanyi est-il proche ici du concept keynésien ultérieur de "socialisation de
l'investissement" qui se distingue fortement des tentatives d'étatisation du capital. Enfin, le rôle du
système des prix n'est plus de récompenser des raretés transitoires, voire produites à dessein, mais
consiste simplement à révéler la demande sociale. D'ailleurs, dans la mesure ou l'évaluation du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%