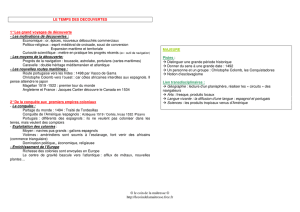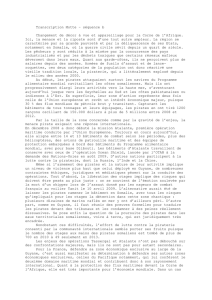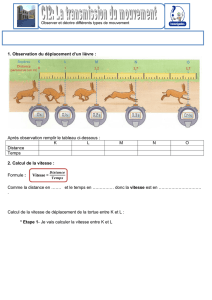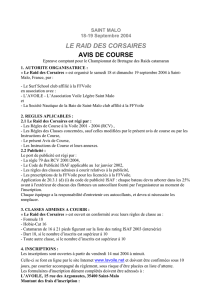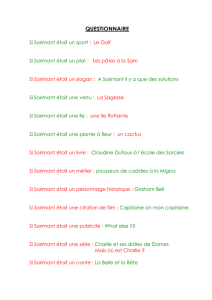Corsaires, pirates et flibustier

Corsaires, pirates et flibustier
Ce texte a été composé à partir d'extraits de l'introduction du Professeur Patrick Villiers au journal
de bord de Raveneau de Lussan, flibustier, publié sous le titre "Les flibustiers de la mer du Sud" aux
éditions France-Empire (ISBN 2-7048-0696-9). Paris 1992
Patrick Villiers est Directeur du Centre de Recherche en Histoire Atlantique et Littorale de
l'Université du Littoral Côte d'Opale.
Les aventures des pirates, corsaires, flibustiers, boucaniers et autres forbans ont entraîné tout au long
de l'histoire une littérature florissante, à l'égal de la part de rêve et d'évasion qu'ils surent susciter dans
l'inconscient collectif.
Faits réels et véritables légendes devaient dès lors s'y entremêler.
Les hommes à la marge de la légalité ne léguant que très rarement leurs archives à la postérité, les
documents de première main sont de fait exceptionnels.
De sorte que l'historien, aux prises avec des sources contradictoires, parvient difficilement à
reconstituer une réalité aux multiples facettes.
La première piraterie
Tout et souvent n'importe quoi a été dit sur la piraterie, la course et la flibuste, parfois, de bonne foi.
Comment, en effet, distinguer la guerre de course, cette activité financée au grand jour par les armateurs d'un
État contre le commerce naval d'un pavillon ennemi, de la piraterie pure et simple, autrement dit du
brigandage maritime ? Il n'y a pas de « bons corsaires » et de « méchants pirates ». La signification de ces
deux termes, très relative, a souvent évolué dans le temps et dans l'espace. Et la césure fut souvent très
mince.
« Ô mes hôtes qui êtes-vous ? D'où venez-vous en sillonnant les humides chemins ?
« Naviguez-vous pour quelque négoce ou à l'aventure tels les pirates qui errent en exposant leur vie et
portent le malheur chez les étrangers ?…»
Extraite de l'œuvre d'Homère, cette interpellation aux navigateurs inconnus abordant dans une île ou
un port souligne l'aspect immémorial de la piraterie.
Nulle réprobation chez Homère alors que Ménélas, époux malheureux de la belle Hélène, mais aussi
Achille, vivent de la piraterie.
Cette période, qui fut baptisée de « piraterie naturelle » par certains historiens, ne semble pas avoir
usurpé cette qualification.
La distinction entre le marchand, le guerrier sur mer et le pirate était alors très ambiguë et très
mouvante. Sachant qu'il serait attaqué au cours de son périple, tout marchand s'armait pour se défendre. Dès
lors, la tentation d'attaquer devenait presque naturelle. A l'inverse, le navire spécifiquement construit pour la
guerre, le plus souvent la galère, était rarement confiné dans ce rôle. Il transportait à l'occasion des trésors ou
de riches marchandises pour le compte d'un État ou d'un prince. Même sous les régimes les plus organisés, le
navire de guerre resta mixte et l'équipage eut toujours le droit de pacotille, c'est-à-dire d'emporter quelques
marchandises qu'il négociera pour son propre compte. Le pirate était guerrier pour s'emparer du navire et de
sa cargaison, mais, et on l'oublie trop souvent, tout pirate avait besoin d'une base pour réparer son navire, se
réapprovisionner, vendre sa cargaison illicite et éventuellement acquérir des informations pour une

prochaine attaque. Il se faisait donc marchand et l'acheteur devenait ipso facto son complice, qu'il fût lui-
même prince ou marchand. Souvent appelé à la rescousse par un prince ou un État, le pirate devenait alors
un guerrier régulier et son action recouvrait temporairement une légalité. L'interpénétration était donc
souvent presque complète. Comment définir alors la piraterie au regard du droit international ?
Après le choc des invasions vikings, le commerce maritime de l'arc atlantique connut une
spectaculaire récession. Cependant, l'assimilation progressive des Vikings aux Normands et la poussée du
christianisme dans l'Europe du nord-ouest relancèrent la pêche et le petit cabotage. Au XIIIe siècle, un «
boom » économique stimula l'activité maritime autour de deux grands axes, l'un vers Novgorod par Bruges
et Lübeck, l'autre des Pays-Bas et de la Hanse vers l'Angleterre et le golfe de Gascogne. Le sel, le vin, la
laine, les poissons salés et le bois constituaient le fondement de ce trafic qui se faisait sur des bâtiments
minuscules.
Habitants des petits ports ou des îles pauvres, de nombreux marins pratiquèrent indifféremment la
piraterie et le brigandage quand ils ne se transformaient en naufrageurs les jours de mauvais temps, attirant
sur les récifs les capitaines naïfs ou incompétents. La violence constituait alors le quotidien des gens de mer.
La solidarité nationale n'existait pas. Marins et pêcheurs tiraient prétexte d'injures ou de provocations
échangées sur les quais ou dans les tavernes pour s'affronter et se dépouiller les uns les autres. La Manche et
l'Atlantique fourmillaient de baleiniers prêts à abandonner la chasse aux cétacés pour celle d'un caboteur en
ignorant délibérément les trêves, les traités et autres sauf-conduits, sachant qu'il se trouverait toujours un
petit seigneur pillard qui, moyennant une part des prises, leur accorderait légitimité et protection. Rappelons-
le, il n’y a pas de voleur sans un receleur, pas de pirate sans un port où ravitailler et vendre les prises.
Cependant, tout brigandage, dès lors qu'il tend à se systématiser devient insupportable à la
collectivité qui se doit de réagir. La violence maritime n'échappa pas à cette règle. La Hanse, association
regroupant les marchands de certaines villes d'Europe septentrionale, s'efforça de réprimer les pirates les plus
entreprenants. Elle lutta avec un réel succès contre les Vitalienbrüder, organisation pirate née au XIIIe siècle
dans le Mecklembourg, passée ensuite dans l'île de Gotland, avant de se réfugier au XIVe siècle dans les îles
de la Frise. Il fallut dans cette perspective définir juridiquement le corsaire.
Les premiers corsaires
Une vieille chanson populaire française dit à tort :
« - Qu'est-ce qu'un corsaire ?
- Un corsaire est toujours un pendu ! »
Un corsaire était en effet, du point de vue même de ses ennemis, un marin auxiliaire d'une marine
légale. Il ne pouvait donc être pendu, les coutumes de la guerre, puis les lois internationales interdisant
progressivement de condamner à mort un soldat ennemi vaincu. Il en découla des conditions « objectives »
pour bénéficier des prérogatives corsaires :
- que les princes, villes-États ou les nations respectifs fussent en état de guerre ouverte. Si le corsaire
continuait son activité après la cessation des hostilités, il devenait pirate. S'il attaquait un navire neutre, le
problème devenait rapidement très complexe et se réglait par voie diplomatique, et/ou judiciaire.
- que le corsaire fût reconnu par son prince ou son État comme tel. Il devait avoir alors une lettre de
marque ou une commission en guerre.
La guerre de course naquit, au début du Moyen Âge, de la pratique féodale des représailles : un
armateur dont le bâtiment était saisi se retournait contre un armateur ou un marchand de la même famille ou
du même port que celui qui avait capturé son navire. Dans le contexte de guerre permanente de l'Europe du
XVe siècle, cette vendetta maritime se codifia et se légalisa peu à peu. Les différents États (royautés,

principautés et villes) créèrent des cours de justice qui accordaient aux capitaines lésés (dont le bon droit
était reconnu) une lettre de marque les autorisant à exercer des représailles. Par extension, les lettres de
marque couvraient en temps de guerre les prises effectuées par les ressortissants d'un État contre la flotte
marchande d'une ou de plusieurs nations adverses.
Le corsaire était donc un marchand conduisant une guerre sur mer que son suzerain était le plus
souvent incapable d'entreprendre. Le navire corsaire était construit, équipé et approvisionné par des
marchands qui créèrent parfois des sociétés par actions pour réunir le capital nécessaire. Les hommes
d'équipage étaient pour la plupart des civils, souvent des terriens, de même que les officiers. On comptait
également de nombreux déserteurs et invalides de la marine. L'armateur corsaire vendait les prises une fois
en possession d'un titre judiciaire l'y autorisant, émanant du tribunal d'une juridiction équivalente. Le produit
de la vente, déduction faite des frais de l'armement et des taxes seigneuriales ou nationales, était partagé
entre les actionnaires, les officiers et l'équipage selon un barème fixé avant le départ de la campagne.
A petite échelle, on utilisait des bâtiments de six à cinquante tonneaux. Il s'agissait de barques ou de
chaloupes non pontées, dérivées de navires de pêche ou de cabotage. L'armement était dérisoire, quelques
pierriers, pistolets, mousquets ou tromblons et surtout des armes blanches. Ces petits corsaires comptaient
essentiellement sur l'effet de surprise - attaque de nuit ou par temps de brume - de navires aux cargaisons
souvent modestes. Quelquefois, la chance : un grand caboteur ou un navire colonial isolé, plus ou moins
désemparé par la tempête. Sa capture fera rêver dans les tavernes pendant des générations, mais le combat
demeurait le plus souvent exceptionnel. Le financement était peu élevé, armateur, capitaine et équipage se
connaissaient bien. Une course presque familiale en quelque sorte...
A plus grande échelle, l'économie corsaire nécessitait un bâtiment plus puissant, au minimum une
centaine de tonneaux, baptisé frégate au XVIIe siècle, brigantin, goélette ou corvette au XVIIIe siècle. Ce
navire, souvent neuf, était construit spécialement pour la course, ou même était utilisé un bâtiment marchand
pour ses qualités de vitesse. L'investissement important nécessitait des capitaux souvent étrangers à la région
auxquels s'ajoutaient les avances de parts de prises à un équipage de cent à deux cents hommes. Il fallait
chercher des prises rentables, donc attaquer les convois, aller loin dans l'Atlantique, la mer du Nord ou près
des grands ports ennemis. Un tel navire restait éloigné de sa base un mois, quelquefois plus. L'équipage,
souvent international, entassé dans un espace exigu, était indiscipliné. Les mutineries étaient fréquentes,
comme paradoxalement les refus de se battre. Le capitaine accordait souvent, au mépris des ordonnances, le
pillage pendant une ou deux heures suivant une victoire, pour calmer l'équipage. Les campagnes n'étaient
néanmoins pas toujours fructueuses. Contrairement à une idée reçue, les corsaires revenaient souvent
bredouilles.
Quelle que fût sa taille, le principe corsaire était cependant que le navire soit armé par des civils. Là
réside la raison d'être de la course et en grande partie de la flibuste. Elle permit à des princes, des villes-
États, voire des nations pauvres ou sans tradition maritime, de se constituer une flotte menant une action de
guerre contre l'ennemi sans avoir à en apporter le capital. Se doter d'une marine de guerre coûte et coûtait
déjà fort cher, plus encore à partir des XVIe et XVIIe siècles. Encore fallait-il trouver équipages et armateurs
prêts à risquer une telle aventure. Il était donc logique de trouver les corsaires là où le trafic maritime se
révélait le plus intense et où les guerres éclataient le plus fréquemment. La guerre de Cent Ans érigea la
course en un véritable système, les finances publiques des belligérants étant réduites à néant. Localement au
contraire, en Méditerranée, en Flandres, en Bretagne comme sur les côtes anglaises, l'armement privé restait
puissant. Les marines royales incarnaient la faiblesse, les corsaires la puissance.
Du traité de Tordesillas à la conquête de l'île de la Tortue
La lettre de marque ne suffisait pas à confirmer la personnalité du corsaire, des États, notamment
l'Espagne et le Portugal se refusant même, aux XVIe et XVIIe siècles, à leur reconnaître une existence légale,
les considérant comme des pirates, c'est-à-dire des criminels et gibiers de potence. A l'origine de cette
attitude intransigeante, il y avait le fameux traité de Tordesillas. Le 4 mai 1493, quelques semaines après le
retour de Christophe Colomb, le pape Alexandre VI partagea le monde en deux par le méridien situé à cent

lieues à l'ouest de l'île Flores des Açores (Il s'agit de la lieue marine de 5 556 mètres). Toutes les terres à
l'ouest seraient à l'Espagne et celles à l'est (Afrique et Asie) au Portugal. Par un accord mutuel du 7 mai
1494, Espagnols et Portugais reportèrent le méridien à trois cent soixante-dix lieues vers l'ouest, ce qui
donna six ans plus tard le Brésil aux Portugais.
Pour faire respecter ce traité, les nations ibériques se dotèrent d'une puissante marine. Elles en
avaient les moyens : les épices, des îles Moluques, l'or africain et américain et surtout l'argent du Mexique et
du Pérou dotèrent ces deux États d'un budget incomparablement supérieur à celui dont pouvaient disposer
les autres États européens.
Même jalousement protégés, les immenses trésors des « Indes » suscitèrent en Europe maintes
convoitises. Et les corsaires du XVIe siècle furent irrésistiblement attirés par le fabuleux pactole américain.
La France de François Ier fut la première à battre en brèche le monopole ibérique.
François Ier ne disposait pas des moyens financiers de créer une marine de guerre. Il confia donc
l'Atlantique aux corsaires basques et normands. L'enjeu était double : d'une part forcer les Espagnols à
reconnaître la présence française en Atlantique, des Antilles aux Terres Neuves ; d'autre part, capturer les
riches galions espagnols afin d'enrichir les armateurs et un roi de France toujours à court d'argent.
Les guerres de Religion suscitèrent l'émergence d'un autre clivage. Les protestants français s'unirent à
ceux de Hollande et d'Angleterre, leur apprenant le secret de la navigation hauturière en Atlantique. En 1566,
lors de la guerre qui devait conduire à l'indépendance des Provinces Unies contre l'Espagne, les Anglais, par
haine des papistes, encouragèrent les corsaires hollandais à traquer les navires espagnols qui ravitaillaient en
argent les troupes du duc d'Albe. A partir de 1568, le trafic des métaux précieux entre l'Espagne et les Pays-
Bas espagnols fut interrompu. Seules les flottes imposantes purent passer jusqu'à Dunkerque. La piraterie
anglaise et hollandaise fut délibérément encouragée par Elisabeth 1re qui, à son tour, alimenta la contestation
du monopole dans l'Atlantique ibérique.
Contrairement à la France, les côtes anglaises connaissaient une piraterie endémique, menée par les
seigneurs côtiers et les villages pêcheurs qui poursuivaient sur mer leur tradition terrestre de naufrageurs.
Les dirigeants anglais profitèrent d'ailleurs de leurs conflits politiques et religieux avec l'Espagne et la France
Pour transformer cette piraterie en une course organisée, puis en une arme capable d'ébranler la puissance
maritime espagnole.
Il s'agissait à l'origine d'une piraterie de misère. Les bâtiments étaient minuscules, quelques tonneaux
; les équipages ne dépassaient pas vingt à trente hommes ; les proies étaient les petits navires étrangers de
pêche et de cabotage. Leurs bases : les côtes sud et ouest de l'Angleterre, le pays de Galles, les côtes sud et
est de l'Irlande. Au cours des guerres avec l'Espagne, les équipages allaient se transformer, les marins
occasionnels devenant, avec l'aide des protestants français, des professionnels de la mer, naviguant de plus
en plus loin sur des navires de plus en plus gros.
A long terme, la course anglaise devait se révéler rentable : les pirates se convertirent en corsaires ou
furent chassés vers les Antilles par Jacques Ier en 1604. Elle permit de former un corps de navigateurs et de
marins expérimentés qui servirent de base à la Royal Navy et à la marine marchande. Cependant, la
rentabilité n'a pas toujours été au rendez-vous. Malgré le désastre de l'Invincible Armada (1588), l'Espagne
restait la première puissance maritime et ses propres corsaires causaient de lourdes pertes au cabotage
anglais.
On ne saurait cependant limiter le seul rôle des pirates et des corsaires français ou anglais à celui du
brigandage maritime. Dans l'Atlantique, ces pirates, au sens ibérique du terme, jouèrent un rôle incontestable
d'explorateurs, qu'il s'agisse des routes maritimes de la découverte ou de la vulgarisation de nouvelles
denrées. Ils ne recherchaient pas seulement l'or et l'argent mais aussi de nouvelles plantes tinctoriales telles
que le bois de rocou ou de Campêche, le cacao et le sucre ou des cauris, ce coquillage qui servait de monnaie
d'échange sur la côte africaine.
A la fin du XVIe siècle, le monopole des Ibériques était de plus en plus battu en brèche en dépit de
l'arrivée en Amérique de l'Inquisition à partir de 1550.

Le relatif apaisement des guerres de Religion et des conflits européens dans la première décade du
XVIIe siècle amena un renforcement des États centraux et la volonté de développer le commerce maritime
sur les côtes européennes. Il en résulta une chasse aux anciens corsaires qui refusaient de se reconvertir en de
paisibles pêcheurs ou caboteurs.
Les Antilles et le commerce colonial apparurent à ces dissidents français, anglais ou hollandais
comme un espace de liberté.
Cette piraterie européenne, en descendant vers les côtes africaines et l'océan Atlantique, prit dès lors
une dimension nouvelle car elle s'installa de manière permanente dans les petites îles des Antilles. Cette
course en voie de marginalisation, en devenant antillaise, donna naissance aux boucaniers, flibustiers et
autres Frères de la Côte.
Engagés et flibustiers : la naissance de la grande flibuste à l'île de la Tortue et à la Jamaïque (1620-1660)
La colonisation par les Espagnols des îles des Antilles avait été partielle. Après avoir éliminé la
plupart des Indiens caraïbes, soit en les massacrant soit en les usant au travail forcé dans les mines de Cuba
ou d'Hispaniola, les Espagnols concentrèrent leurs efforts sur la terre ferme, laissant à l'abandon les petites
îles antillaises, la Jamaïque et une grande partie de Saint-Domingue. A partir des années 1550, esclaves
marrons, déserteurs espagnols, pirates, corsaires ou contrebandiers français, espagnols ou anglais prirent pied
dans ces lieux abandonnés. Ils apprirent des indiens survivants l'art du « boucan », c'est-à-dire de faire sécher
la viande afin de la conserver et formèrent de petites communautés qui se donnèrent quelquefois le nom de
Frères de la Côte.
Les Espagnols n'étaient donc plus les seuls occupants des Antilles. Cette situation ne pouvait laisser
indifférents les gouvernements rivaux de l'Espagne. Vers 1625-1626, Richelieu rédigea plusieurs mémoires
préconisant le développement maritime de la France et la création de compagnies de commerce. En 1627,
trois navires avec à leur bord Rosset, un autre chef corsaire nommé Pierre Belain d'Esnambuc et cinq cents
Normands débarquaient à Saint-Christophe. Ils y trouvèrent un groupe d'Anglais commandé par un capitaine
nommé Warner. Les deux groupes s'allièrent pour se défendre contre les Espagnols. Au même moment,
mille sept cents Anglais occupaient la Barbade tandis que les Hollandais s'emparaient de Tobago, de
Curaçao, de Saba et de Saint-Martin et que le Français Cahuzac s'installait à Saint-Eustache.
Les Espagnols comprirent le danger et envoyèrent une « flota » de seize navires. Après avoir repris
l'île de Nevis, ils s'emparèrent de Saint-Christophe. Appliquant scrupuleusement les lois de la guerre, ils
offrirent aux Français et aux Anglais d'être rapatriés en Europe. Beaucoup acceptèrent mais quatre-vingts
Français, sous le commandement de Belain d'Esnambuc et de Pierre Vadrosque, s'échappèrent et firent voile
vers Saint-Domingue. Ils réussirent à s'emparer d'une île nommée Tortuga, défendue par vingt cinq
Espagnols seulement. Cette île allait acquérir la célébrité sous le nom de l'île de la Tortue, capitale des
flibustiers.
L'intervention des États aux Antilles resta néanmoins marginale. En France comme en Angleterre, la
colonisation fut laissée à l'initiative privée par le biais du système des engagés avec pour corollaire le
développement de la flibuste. De nombreux engagés devinrent en effet des flibustiers, notamment
Exquemelin
1
, Morgan ou Raveneau de Lussan. Dès les années 1630 se posait le problème du financement du
prix élevé du transport du colon aux Antilles et de son établissement les premières années.
En autorisant les colons établis les premiers à payer le voyage des nouveaux arrivants moyennant
l'engagement de ces derniers à travailler sans salaire pendant trente-six mois, le pouvoir créa un système
original de peuplement et de mise en valeur. A l'origine, il ne s'agissait pas d'un esclavage blanc mais d'un
moyen de compenser l'absence de capital dans ces colonies et dans les ports métropolitains. Par ses cours
élevés, le tabac cultivé permit de financer le premier défrichement.
1
Patrick Villiers prépare avec le professeur Real Ouellet de l’université Laval à Quèbec une édition critique, d’Exquemeilin,
chirurgien de la flibuste, à paraître Presses de l’université Laval, 2003.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%