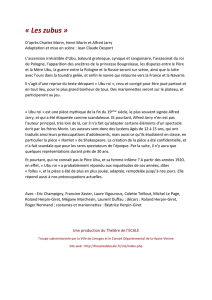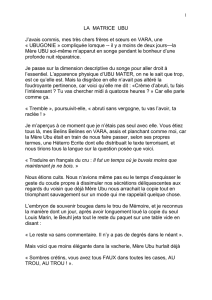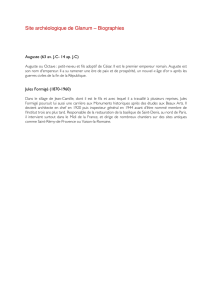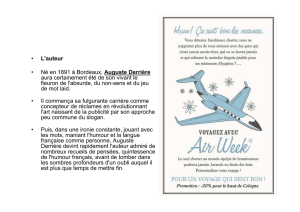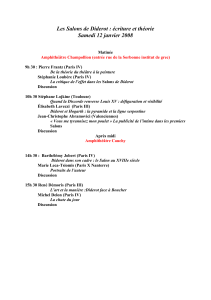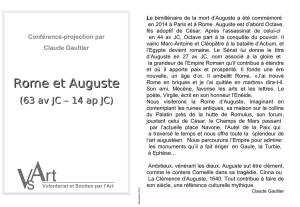Question_de_corpus_bac_blanc_le_pouvoir

Question de corpus : Bac blanc 21 mai 2016 le pouvoir
Copie d’Alexandre 1ère S
Le pouvoir est un thème récurrent en argumentation : les écrivains ont en effet souhaité intervenir et agir
par la plume en tant que citoyen. Le corpus propose donc quatre textes traitant de ce sujet, deux pièces
de théâtre : la tragédie du dramaturge classique Corneille Cinna, publiée en 1641 où l’empereur Auguste
fait part de ses interrogations concernant son pouvoir, la pièce comique d’Alfred Jarry précurseur de
l’absurde Ubu Roi écrite à la fin du XIX ème siècle. L’extrait évoque la décision du père Ubu totalement
inhumaine de supprimer tous les opposants. Les deux autres écrits se distinguent en une fable du
moraliste classique La Fontaine « La Génisse, la Chèvre, la Brebis, en société avec le Lion » où le Lion
décide de façon arbitraire de garder pour lui tout seul la proie capturée par un autre et un article de
l’Encyclopédie, une argumentation directe donc- écrit par Diderot, l’écrivain des Lumières « Autorité
politique » où le philosophe s’interroge sur le pouvoir. Quelles réflexions ce thème nous suggère-t-il ?
Tout d’abord, le pouvoir suscite le désir des hommes comme l’exprime Auguste : « J’ai souhaité
l’Empire » avec l’emploi d’un verbe de volonté. Pour Diderot, le pouvoir ne peut être totalement assouvi,
il doit être « restreint ». Dans la pièce Ubu Roi, le personnage éponyme désire comme Auguste, le
pouvoir et y parvient : il est Roi dans notre scène comme le prouve l’autorité dont il use avec l’usage de
l’impératif « Ne crains rien ». Cependant, si le désir de pouvoir d’Auguste s’est tari comme le montre
le chiasme « d’une contraire ardeur son ardeur est suivie », chez Ubu, ce désir s’accompagne d’une
volonté d’enrichissement égoïste « j’aurai tous les biens vacants ». Les avantages du pouvoir sont aussi
exprimés dans la fable puisque toutes les parts du cerf reviennent au Lion avec l’énumération
« deuxième » « troisième » « quatrième ». Pour Auguste, le pouvoir est le désir suprême car il peut
intégrer ses autres désirs « l’Empire », il est donc un moyen et un but, ce qui explique le désir qu’il
suscite.
En outre, le pouvoir comporte la violence, liée au désir évoqué ci-dessus. Diderot la condamne avec
l’usage de termes péjoratifs tels que « usurpation » « tyran » et « joug ». Le père Ubu, quant à lui, est
l’exemple caricatural du tyran avec le champ lexical de la violence « exécuter » « A la trappe » « Dans
la trappe », ainsi qu’avec les phrases exclamatives qu’il utilise. C’est ici une satire du tyran qui impose
son pouvoir par la peur et par la violence comme le montre l’expression globalisante « tu massacres
tout le monde ». De même, le lion menace par la violence pour faire respecter ses décisions comme en
témoigne ce verbe au futur « je l’étranglerai ». Ces deux personnages sont donc des tyrans, selon la
définition de Diderot. Cependant si l’un accède au pouvoir par le meurtre, l’autre s’associe avec les
autres comme on le voit par l’expression « firent société ». Le troisième personnage dominant de notre
corpus, Auguste, s’est lui aussi arrogé le pouvoir par la violence comme nous l’indique le paratexte et
ces mots « tant de peine et de sang ».
Néanmoins, le pouvoir obtenu par la force a des limites : ainsi Auguste compare-t-il les destins de ses
deux prédécesseurs illustres. Dans une antithèse est rappelée la mort de César
« débonnaire » s’opposant à « assassinat », causée par un complot alors que Sylla dictateur est mort en
paix. De même, les conseillers du père Ubu tentent de lui faire entendre raison, comme en témoigne
cette énumération de termes péjoratifs tels que « infamie » « scandale » « indignité ». Diderot explicite
alors les limites du pouvoir du tyran car il peut être emporté par une violence encore plus grande qui se
retournera contre lui. Les méthodes du père Ubu le prémunissent contre ce renversement car il conserve
l’initiative violente, c’est ce que Diderot appelle « la loi du plus fort ». Et c’est alors un cercle vicieux
qui se met en place.
Ces quatre textes évoquent donc différents aspects du pouvoir : que ce soit le désir qu’il provoque, la
violence qu’il suppose ou les limites qui le restreignent.
1
/
1
100%