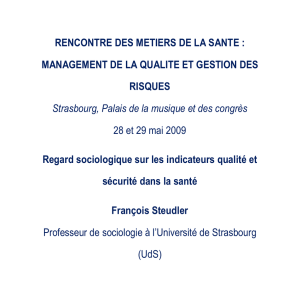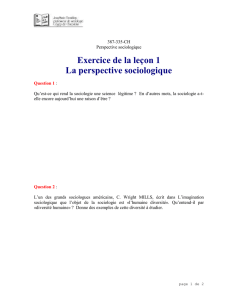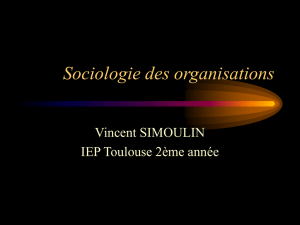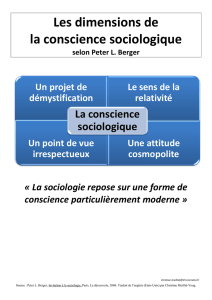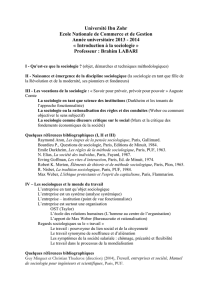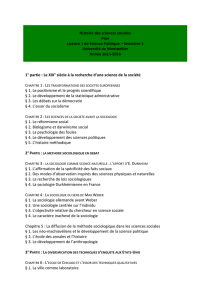analyse de textes socio 06-07

SOCIOLOGIE VISUELLE
Année académique 2012-2013
Daniel Vander Gucht (danielv[email protected] - www.vdg.lettrevolee.com)
Toute société comme tout individu a besoin de représentations du monde, de représentation des
autres et de représentations de soi-même pour tenter de donner un sens compréhensible à son
existence, pour se rattacher à une histoire et pour pouvoir s’imaginer un futur, un devenir.
Ces représentations du monde sont de différents ordres que les sémiologues distinguent et classent
en trois catégories de signes :
– les indices (comme une trace matérielle de pas dans le sable qui entretient une relation de
proximité physique avec le pied qui a laissé son empreinte) ;
– les icônes (qui sont des images qui entretiennent une relation de ressemblance avec ce qu’elles
représentent, soit leur référent) et enfin
– les symboles (le langage verbal ou mathématique dont les éléments – mots et chiffres –
entretiennent une relation conventionnelle et abstraite avec leurs référents (zéro n’a pas de référent
dans le monde réel et une chose se dira avec des mots différents selon la langue du locuteur) mais
dont l’articulation permet l’énoncé de propositions théoriques et de discours argumentés qui sont
susceptibles de penser le monde selon les lois de la logique).
On peut de la même façon identifier trois niveaux de relation au monde, aux autres et à soi-même :
– l’affect (les sentiments qui nous touchent, nous émeuvent, nous affectent et nous font ressentir
le monde, les autres et nous-même) ;
– le percept (les images visuelles, olfactives, sonores, gustatives et tactiles à travers lesquelles
nous percevons les choses et les êtres) ;
– le concept (les idées que nous nous faisons sur le monde, les autres et nous-même, qui confèrent
du sens au monde et ancrent des convictions dans notre esprit éclairé (ou obscurci) par notre raison
et par notre expérience).
La sociologie, en tant qu’entreprise de connaissance et de maîtrise scientifique du monde social, est
l’héritière de la démographie (soit le nombre – dès lors que les premières grandes études
sociographiques à l’ère industrielle étaient démographiques et qu’elles ont été progressivement
remplacées par des enquêtes statistiques et des sondages d’opinion) et de la philosophie (soit le logos
– Auguste Comte, inventeur du mot « sociologie » auquel il préférait celui de « physique sociale »,
était lui-même un mathématicien nourri de la philosophie morale des Lumières et de la doctrine
socialiste de Saint-Simon dont il fut le secrétaire).
La science sociologique s’est donc bâtie en n’accordant crédit qu’au nombre et au logos, considérant
que la passion et l’image étaient pour le moins trompeuses et anecdotiques, peu propices en tout cas
à fonder des lois scientifiques, des vérités absolues et universelles, suivant en cela une longue
tradition de rejet de l’image qui remonte au moins à Platon. Pourtant l’icône n’est pas que
représentation plus ou moins fidèle d’une réalité qui nous serait donnée d’emblée, pour autant qu’on
sache regarder « objectivement », c’est-à-dire avec ses yeux et non avec son cœur, comme pouvaient
le penser quelques esprits positivistes des siècles derniers, elle est ancrée avec nous dans le monde
1

et propose déjà une pensée du monde. C’est que le percept est indissociable de l’affect (qui nous fait
porter de l’intérêt à tel objet de recherche) comme du concept (qui va déterminer le cadre et l’optique
choisie pour « regarder » le monde, les autres et soi-même).
La remise en cause de toute une série de prémisses du positivisme permet aujourd’hui de commencer
à se rendre compte que la science elle-même, du moins dans le domaine des sciences humaines – ce
que les Allemands appellent les sciences de l’esprit par opposition aux sciences de la nature –, peut
elle-même être vue comme un grand récit, que l’objectivité et la neutralité scientifiques sont des
leurres (depuis la constatation désabusée de Lévi-Strauss dans Tristes tropiques que toute découverte
d’une culture conduit à sa destruction jusqu’au principe d’incertitude d’Heisenberg qui constate que
l’observateur exerce toujours une influence sur ce qu’il observe), etc., et l’on recommence à
s’interroger plus modestement et prudemment sur ce qui fait science, sur ce que signifient et
impliquent les opérations de regarder et de décrire, et notamment sur le statut de l’image, jusqu’ici
discréditée ou du moins marginalisée, en sociologie.
La création d’une chaire de sociologie visuelle à l’université demeure pourtant une rareté, sinon une
curiosité, dans le monde académique francophone qui a longtemps été indifférent, voire réfractaire
à l’usage des images dans le travail sociologique. Quelques initiatives isolées et sporadiques ont vu
le jour en France, entre 1987 et 1989, au sein d’un laboratoire du CNRS avant de sombrer corps et
biens mais la tenue du colloque international du comité de recherche en sociologie de l’art de
l’AISLF que j’ai organisé avec le réseau français Opus sur le thème du « sociologue et ses images »
à l’Institut de sociologie de l’ULB en octobre 2010 corrobore le regain d’intérêt pour la sociologie
visuelle dont témoigne la multitude de groupes de travail et de colloques consacrés à la sociologie
visuelle et filmique dans le monde francophone. La sociologie visuelle est en plein essor depuis une
vingtaine d’années et tend à rattraper le retard pris par rapport à l’anthropologie visuelle dont elle
est proche parente avec l’apparition, certes timide et clairsemée, de trop rares départements, de
laboratoires et de masters en sociologie visuelle – comme le masterpro « Image et société » orchestré
par le Centre Pierre Naville de l’Université d’Évry ou l’unité de sociologie visuelle du département
de sociologie à l’Université de Genève pour le monde francophone.
En Belgique, l’UCL propose un séminaire de socio-anthropologie audio-visuelle qui initie les
étudiants aux techniques audio-visuelles tandis que l’ULB propose depuis quelques années ce cours
de sociologie visuelle, que devrait venir compléter bientôt un cours d’anthropologie visuelle, mais
nous disposons pas pour l’heure des moyens techniques et financiers permettant de mettre à la
disposition des étudiants des enseignants et du matériel de prise de vue et de montage vidéo pour les
initier au documentaire et au film. À Bruxelles, seuls l’association SoundImageCulture (financée par
la Communauté flamande) ou le Centre vidéo bruxellois disposent d’équipes et de matériel
susceptibles d’assurer une telle formation. L’Université d’Anvers propose, pour sa part, une filière et
un groupe de recherche en « Visual Studies et Media Culture » et un séminaire payant de 10 jours
en été (les frais d’inscription s’élèvent quand même à 800 euros). Et certains sociologues n’hésitent
plus à franchir le pas en devenant eux-mêmes les producteurs de films sociologiques (comme
Monique Haicault du LEST/CNRS, pionnière dès les années 1980, ou Joyce Sebag et Jean-Pierre
Durand au Centre Pierre Naville), voire à passer avec armes et bagages du côté du cinéma (faute de
possibilité de pratiquer la sociologie visuelle à l’université peut-être), comme ces deux anciennes
étudiantes de l’ULB que sont Sophie Bruneau (dont nous verrons un film remarquable au cours) et
2

Charlotte Grégoire (dont le film Commun Ground/Charges communes, tourné dans un immeuble de
Bucarest et réalisé avec Anne Schiltz, sera montré au Pianofabriek, 35 rue du Fort, 1060 Bruxelles
le 6 mars à 19h30 dans le cadre de leur programme Cinedomo). Cette double pratique n’est du reste
pas neuve puisque Luc de Heusch, éminent professeur d’anthropologie de notre université, était sans
doute au moins aussi connu pour ses formidables films sociologiques et les films sur l’art de cet ami
d’Aleschinsky qui fut très proche du groupe Cobra. Avec Les Gestes du repas, « il réalise un essai
d’ethno-fiction cinématographique en captant les gestes quotidiens et répétitifs de ses compatriotes
en rapport avec les repas, toutes classes sociales confondues. À travers diverses situations (le marché,
le repas rapide, le diner, le repas de fête…), il tente de définir les Belges par leur façon de manger
et réalise, sous l'apparence sérieuse d'un documentaire, une fantaisie parfois virulente sur la
Belgique. » (Source Wikipedia) Il est regrettable Luc de Heusch n’ait pas songé à créer dès les
années 1970 un département d’anthropologie visuelle mais a plutôt fait fuir ceux qui auraient pu
consolider cette filière comme Jean-Paul Colleyn.
Dans le monde anglo-saxon, la sociologie visuelle est mieux implantée dans les départements de
sociologie et de communication et l’on y compte un bon nombre de départements de Visual Studies.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, comme le font remarquer les spécialistes anglo-saxons eux-mêmes,
la sociologie visuelle y reste malgré tout « marginalisée », écrit John Grady (« Becoming a Visual
Sociologist », Sociological Imagination, n° 38, 2001/ 1-2, p. 83), voire « complètement rejetée » par
la sociologie normale (ou paradigmatique, au sens de Kuhn), déclare Douglas Harper (« Visual
Sociology : Expanding Sociological Vision », loc. cit., p. 58), et le fait que la revue de l’Association
internationale de sociologie visuelle / International Visual Sociology Association (IVSA) ait été
débaptisée Visual Sociology pour s’appeler désormais Visual Studies est un signe clair du risque que
court la sociologie visuelle d’être happée puis digérée par les sciences de la communication au sens
large du terme.
Cette différence entre la reconnaissance anglo-saxonne et la marginalisation qui touche au discrédit
de l’image dans la sociologie française est manifeste si l’on compare les attitudes respectives face à
l’image de Howard Becker, formé dans la tradition sociologique de l’école de Chicago et qui milite
depuis les années 1970 pour l’usage de la photographie dans les sciences sociales (même si lui-
même n’a guère mis usé de la photographie dans ses propres travaux) et a activement contribué à la
création de l’International Visual Sociology Association (sans doute le fait qu’il soit lui-même
musicien et que sa compagne soit photographe n’y est pas pour rien), et celle de Pierre Bourdieu dont
il aura quasiment fallu attendre sa disparition pour que soient exhumées les photos qu’il avait prises
en Algérie à l’occasion de ses premiers travaux de jeune sociologue, par ailleurs conscrit de l’armée
française durant cette période trouble et douloureuse de la guerre d’Indépendance. Or on constate
bien vite que Bourdieu redoute par-dessus tout d’être pris pour un photographe et prend bien soin de
préciser que, pour lui, ces photos demeurent marginales et anecdotiques et n’ont eu en tout état de
cause aucune incidence sur ses recherches savantes. Cette défiance vis-à-vis de l’image (et de
l’image qu’il se fait de ceux qui font des images – les photographes et les cinéastes en l’occurrence)
resurgit dans le film de Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat, lorsque Jean-Luc Godard
l’invite à collaborer sur un projet que Bourdieu remballe comme une simple facétie d’artiste à
laquelle il fait mine de ne rien comprendre. Et l’on ne peut s’empêcher de penser que celui qui fut
le pourfendeur de la télévision, accusée de brider la force de la pensée discursive à la suite de ses
propres prestations télévisées qui n’ont manifestement pas comblé ses attentes, redoutait peut-être
3

cette fois la concurrence de la caméra d’un cinéaste qui avait à plusieurs reprises manifesté des
velléités sociologiques (dans la plupart de ses films et très explicitement dans Masculin-féminin et
dans 2 ou 3 choses que je sais d’elle). Le sentiment que Bourdieu concevait le rapport de la
sociologie à l’image sur le mode de la rivalité est encore conforté par le fait que, curieusement, ses
préventions à l’égard du cinéma ne l’empêchèrent pas de se livrer à la caméra docile de Pierre Carles
qui lui confectionna une parfaite hagiographie.
Sans doute faut-il aussi y voir un effet de ce que Bourdieu lui-même appelait un « habitus
académique » très français engoncé dans une tradition philosophique qui a toujours privilégié le
document écrit, qui célèbre le logos, la parole, et continue à juger les images trompeuses et
superficielles, depuis Platon en passant par Pascal et Rousseau et jusqu’aux critiques de tout poil de
la « société du spectacle » qui assimilent toute production d’images à une forme de manipulation
médiatique (de Guy Debord à Jean Baudrillard, Paul Virilio et autres prophètes apocalyptiques).
Rappelons au passage que Bourdieu était philosophe de formation.
L’anthropologue entretient, pour sa part, un rapport plus naturel à l’endroit des documents
audiovisuels et plus décrispé à l’égard du narratif, comme l’atteste la pratique généralisée des
journaux tenus par les ethnologues voyageurs. Ainsi, dès 1925, Marcel Mauss introduisait dans ses
leçons d’ethnologie l’idée que le procédé photographique permet de collecter des données visuelles
et de mémoriser de multiples détails relatifs aux faits observés. Gregory Bateson manifestera pour
sa part, dans les dernières pages de La Cérémonie du Naven, paru en 1936, son souhait d’élaborer
des techniques adéquates de description et d’analyse de postures humaines, de gestes, de
l’intonation, du rire, etc. Il entreprendra ce programme dès l’année suivante, en partant à Bali avec
son épouse, l’anthropologue Margaret Mead, en 1937. C’est au cours de ces deux années de terrain
dans un petit village des montagnes de Bali que Bateson va mettre au point ces « techniques
adéquates de description et d’analyse » du comportement non verbal. Tandis que Margaret Mead
interroge, bavarde, prend note, Bateson filme et photographie. Il va ainsi prendre environ 25 000
photos au Leica et 7 000 m de pellicules à la caméra 16 mm ! La date et l’heure de chaque prise de
vue sont soigneusement notées afin de correspondre aux notes écrites de Mead. Bateson et Mead
retournent à New York en 1939. Ils choisissent et commentent 759 photographies qui constituent le
corps de Balinese Character : A Photographic Analysis, qui paraît en 1942. Il faudra attendre 1960
pour que le sociologue Edgar Morin propose à Jean Rouch de collaborer sur un film qui porterait cette
fois sur le société française de l’époque à partir d’un semblant de sondage d’opinion sur le thème du
bonheur, ce qui donnera naissance à Chronique d’un été qui marque en quelque sorte la naissance du
film sociologique. Mais lorsqu’en 1976, un sociologue, et non des moindres, Erving Goffman, publie
une étude intitulée « Gender Advertisements » qui traite des représentations sexuées dans la publicité
en s’appuyant sur l’analyse de 500 images, c’est encore dans une revue d’anthropologie qu’elle
paraîtra (Studies in the Anthropology of Visual Communication).
Ceci explique du reste l’avance considérable prise par l’anthropologie visuelle (qui a ses lettres de
noblesse au sein même de la discipline avec des ethnologues-photographes tels que Margaret Mead
et Gregory Bateson, ou cinéastes tels que Jean Rouch ou Luc de Heusch – même si Jean Rouch, tout
comme Robert Flaherty (1884-1951), le père du film documentaire, auteur du fameux Nanook
l’Esquimau (1922) et adepte du cinéma direct que pratiquera aussi Rouch qui en fera la méthode de
l’anthropologie visuelle, n’étaient à la base ni ethnologues ni cinéastes mais des ingénieurs en
4

mission d’exploration) sur la sociologie visuelle dont l’inspiration semble plus exogène à la
discipline, à savoir la pratique du journalisme d’investigation et du documentaire social qui servit de
modèle à la sociologie empirique, à l’instigation de Robert E. Park (1864-1944), le fondateur de la
première école de Chicago. Park exerça la profession de journaliste avant d’entreprendre des études
de psychologie et de philosophie qui le mènera en Europe, notamment à Berlin où il fut l’élève de
Georg Simmel qui lui transmettra sa fascination pour le développement urbain et la figure de
l’étranger. Il a donc derrière lui une longue carrière de journaliste reporter lorsqu’en 1913, à 49 ans,
il est engagé à l’Université de Chicago par William Isaac Thomas (co-auteur avec Florian Znaniecki
du Paysan polonais en Europe et en Amérique, étude sociographique sur l’immigration polonaise).
Une véritable école se constitue autour de Park avec l’écologie humaine pour problématique
commune et le tissu urbain pour champ de recherches ou laboratoire commun, sans rupture avec le
passé journalistique de Park. Pour lui, en effet, le sociologue est « une espèce de super-reporter »
dont le travail doit « nous permettre de comprendre ce que nous lisons dans le journal ». À l’instar
de son ancien professeur berlinois, Georg Simmel, Park est fasciné par la vie urbaine, dont Chicago
offrait un exemple particulièrement saisissant à l’époque, par son rythme de croissance rapide, ses
immigrants de toutes nationalités et ses truands – dont le fameux Al Capone. Il lance ses étudiants
« sur le terrain », afin qu’ils récoltent par entretiens, observations, relevés cartographiques, des
matériaux de première main. Cette méthode de collecte d’informations, le fieldwork, est sans doute
une des caractéristiques principales de l’école de Chicago. L’université de Chicago possède ainsi,
depuis les années 1920, le département le plus dynamique et innovateur en sociologie : on y étudie,
sur le terrain, la sociologie urbaine et, de manière générale, on y attache une importance toute
particulière aux manières de dire et de faire. Park demeure par ailleurs fidèle à son passé militant (il
fut le secrétaire de Booker Washington et de son association de défense et de promotion des Noirs
du Sud des États-Unis) et conjugue, tout comme William Isaac Thomas, sa conception d’une
sociologie de terrain avec un souci de témoigner et de comprendre en regardant et en donnant à voir.
Rappelons que, dès la fin du 19esiècle avec Jacob Riis (1849-1914), réformateur social qui choisit
d’illustrer ses conférences par des photographies pour leur impact sur le public (How the other half
lives, 1890) puis Lewis Hine (1874-1940), sociologue de formation devenu photographe, ou encore
Dorothea Lange (1895-1965), Margaret Bourke-White (1904-1971) et Walker Evans (1903-1975)
qui documentèrent tous trois la Grande dépression (crise de 1929) pour le compte de la Farm
Security Administration (programme du New Deal de Roosevelt, 1937-1943) la photographie sociale
joua un rôle déterminant dans les réformes sociales aux États-Unis en témoignant des terribles
conditions de vie et de travail des pauvres et des immigrants ou de l’exploitation du travail des
enfants. Et, en Europe, dans un tout autre contexte, le photographe allemand August Sander (1876-
1964) inaugure la photographie documentaire en proposant des portraits de types sociaux dès les
années 1920.
Il en est résulté une certaine familiarité, voire une confusion entre la sociologie visuelle, le reportage
photographique et le cinéma documentaire, comme le souligne le site universitaire français Melissa,
de l’École normale supérieure de Cachan, qui a organisé un concours de sociologie visuelle parrainé
par Bruno Latour : « L’image photographique est aujourd’hui encore peu utilisée comme matériau
de la recherche en sociologie. Certes, il est devenu très facile de prendre des photographies sur un
terrain de recherche et même de les publier. Mais rares sont encore les travaux qui donnent à l’image
un rôle argumentatif aussi important que celui conféré par exemple à un tableau de données ou à une
analyse d’entretien. La photographie est souvent cantonnée dans le rôle de simple illustration d’un
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%