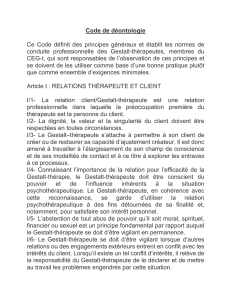ethique et deontologie en osp

1
ÉTHIQUE ET DEONTOLOGIE EN OSP
6eme PC / Intervenant : M. Ahmed Sakhir NDIAYE / PC Maître d’application
Année scolaire : 2008 / 2009
1. CLARIFICATION CONCEPTUELLE
L’éthique :
C’est une branche de la philosophie qui traite des problèmes fondamentaux de la
morale. Elle est avant tout un questionnement, une remise en cause critique des
normes et un ré interrogation des valeurs dictée, entres autres, par l’évolution de la
société.
La morale :
Elle désigne, quant à elle, l’application des principes de l’éthique dans les actes
particuliers de la vie. C’est la science du bien et des règles de l’action humaine.
La déontologie :
Elle se définit comme la " théorie des devoirs ". C’est l’ensemble des règles qui
régissent les rapports de certains professionnels entre eux et/ou avec leurs " clients ".
La déontologie se définit comme l’ensemble des devoirs qui s’imposent à des
professionnels dans l’exercice de leur métier. Il existe un code de déontologie lié à
l’activité de l’OSP adopté en 1995 par l’Association Internationale de l’Orientation
Scolaire et Professionnelle (AIOSP).
Il n’en n’existe pas présentement au Sénégal mais ce code pourrait faire référence dans
notre pays.
La déontologie et l'éthique visent le même objectif : réguler les comportements afin
d'assurer des rapports harmonieux entre les personnes.
La déontologie fait appel aux devoirs. C'est l'ensemble des règles qu'une
organisation se donne, imposant des consignes et des obligations quant à la conduite
de ses dirigeants et de ses employés. La déontologie fixe la limite entre ce qui est
tolérable et ce qui est intolérable. Une dérogation à la déontologie est susceptible
d'entraîner des sanctions.
L'éthique fait appel à l'adhésion des personnes aux valeurs plutôt qu'à l'observance
des devoirs. Face à une situation donnée, la décision part d'une réflexion sur les
conséquences positives et négatives de l'action envisagée sur soi, sur autrui et sur
l'environnement, et ce, par rapport aux valeurs que l'organisation préconise.
Le secret professionnel :
Le praticien de l’orientation est tenu au respect du secret professionnel. Ce respect
doit être compris comme étant une obligation, " contractée " à l’égard du client,
garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès de lui.

2
Le praticien de l’orientation est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les
informations portées à sa connaissance, les initiatives qu’il est amené à prendre dans
le cadre des demandes de conseil qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers.
Il garantit notamment ce secret à propos de l’organisation des entretiens, de leur
teneur et de ce qui en résulte.
2. ETHIQUE ET DEONTOLOGIE EN ORIENTATION
Les professionnels de l’OSP sont au service des personnes ou de leurs consultants. Il
s’agit d’une relation d’aide fondée sur une philosophie humaniste qui doit néanmoins
reposer sur un cadre éthique mais aussi législatif. Il faut également souligner que le
cadre législatif n’est pas une panacée dans la mesure où il ne permet pas toujours de
répondre à toutes les questions que posent les pratiques d’orientation. Il est donc
important d’entretenir une réflexion permanente sur les intentions et les valeurs en
rapport avec les pratiques effectives des conseillers.
2.1 Le Code et déontologie
Le Sénégal ne dispose pas pour le moment d’un code de déontologie en orientation.
Cependant les fondements des principes qui régissent les pratiques du conseiller
d’orientation sénégalais et qu’il partage avec d’autres professionnels de la
Psychologie se retrouvent dans le Code de la Société Française de Psychologie
adopté en 1996 et dans le Code de déontologie de l’Association Internationale de
l’Orientation Scolaire et Professionnelle (AIOSP) adopté en 1995.
Dans son préambule le code de la SFP affirme que « le respect de la personne
dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » et que « sa
reconnaissance fonde toute l’action des psychologues ».
Sept principes sur lesquels doit reposer l’action des psychologues ont été abordés :
- Respect des droits des personnes : respect des droits fondamentaux des
personnes, de leur dignité, consentement libre des personnes avant toute
intervention, préserver la vie des personnes et respect absolu du secret
professionnel, etc.
- Compétences : mise à jour des connaissances théoriques, formation continue,
etc.
- Responsabilité : le conseiller répond personnellement des choix et des
conséquences de ses actions et des avis qu’il donne.
- Probité : le conseiller se doit de préciser ses méthodes et préciser ses buts.
- Qualité scientifique : les interventions du conseiller doivent pouvoir faire
l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur
construction.

3
- Respect du but assigné : les méthodes utilisées par le conseiller doivent être
en adéquation avec les objectifs visés dans ses interventions.
- Indépendance professionnelle : le conseiller ne peut en aucun cas aliéner
son indépendance sous quelque forme que ce soit.
2.2 Quelques considérations éthiques en OSP
Dans leur ouvrage intitulé Psychologie de l’orientation Guichard et Huteau
engagent une réflexion éthique sur l’Orientation à partir de trois axes : l’évaluation,
l’information et l’aide à l’orientation.
2.2.1 L’évaluation
Elle doit respecter l’intimité de la personne et lui donner des informations
objectives et pertinentes qu’elle peut utiliser ultérieurement. Pour ce faire les
épreuves doivent être fiables et équitables et répondre à des normes strictes dans leur
construction et leur application. Une attention particulière est apportée aux biais
culturels.
On insiste également sur la fidélité des épreuves et sur leur validité (qualité des
pronostics qu’elles formulent). Dans cette logique, il est absolument nécessaire de
disposer d’étalonnages actualisés.
Les informations qui sont données au sujet doivent lui être utiles et lui permettre
d’évaluer ses chances de réussite dans tel ou tel domaine. Elles doivent également
lui permettre de construire un projet de formation, d’insertion ou de reconversion.
Le sujet doit bien connaître le contenu de l’évaluation qui doit donc lui être
accessible pour la maîtrise de sa signification. La restitution joue ici un rôle
important.
2.2.2 L’information
Tout le monde doit bénéficier d’une information sur les études et les professions.
Cela fait partie de la culture économique et sociale du citoyen. Les média et les
disciplines scolaires permettent d’accéder à cette culture.
Cependant, l’information à elle seule ne suffit pas pour fonder un conseil en
orientation. L’information est en réalité un élément de la pratique d’aide à
l’orientation.
La question qui se pose, au-delà de la description des formations et des métiers, est
le problème de l’objectivité de ces descriptions. Le conseiller ne pouvant se
permettre d’entrer dans les détails de chaque formation et métier est obligé de trier

4
et donner les informations qu’il juge pertinentes. La question des choix et des traits
saillants qu’il met en évidence est ici posée.
Le problème de la régulation des flux est aussi posé à travers l’information. Il est
souhaitable dans un souci d’équilibre social, dans un souci d’adéquation entre offre
et demande d’emploi d’ajuster l’information à la réalité socio-économique.
Cependant un souci d’objectivité peut manifestement conduire à aller à l’encontre
des données de la réalité. Il se pose ainsi la question de la diffusion orientée de
l’information.
Le fait essentiel qui est posé est celui de l’engagement du conseiller du point de vue
du sens qu’il donne aux finalités de sa pratique d’orientation. Dans un article intitulé
Changements sociaux et pratiques d’orientation, Guichard aborde la question des
finalités des pratiques d’orientation à partir des différentes postures que peut adopter
le conseiller (expert, conseiller éducateur, sophiste, psychologue). Selon Guichard,
la question idéologique est ici soulevée selon qu’on s’inscrive dans une perspective
libérale ou social-démocrate.
2.2.3 L’Aide à l’information
La question que posent les auteurs est la suivante : est-ce que la fonction réelle
d’une pratique est bien celle qu’on lui attribue ?
Il est vrai que l’élaboration d’un projet d’orientation passe par une réflexion sur soi.
Cette clarification débouche sur des questions qui entraînent le sujet dans un
processus dynamique. Cet exercice qui doit favoriser un développement personnel
peut entraîner l’effet contraire. Il n’est pas forcement établi que toutes les pratiques
d’orientation conduisent effectivement au développement de l’image de soi. A
travers les outils qui sont utilisés aujourd’hui (questionnaire de personnalité ou
d’intérêt) et au regard des traits généraux qu’ils mettent en exergue, le risque de
confiner le sujet à des dimensions qui lui sont imposées est bien présent. Les auteurs
soulignent avec ironie qu’il n’y a pas d’intérêt religieux dans la typologie de
Holland.
Les auteurs soulignent également la relation dialectique qui existe entre le
développement de l’image de soi, nécessaire à l’enrichissement, et sa stabilisation
aussi nécessaire à la prise de décision.
Sur le plan scolaire, il est constaté par exemple que l’orientation en seconde et dans
les universités repose essentiellement sur des critères faisant appel aux notes
obtenues. D’ailleurs les enseignants et même les conseillers insistent beaucoup sur
ces aspects. N’y a-t-il pas ici une volonté latente de diriger les aspirations
individuelles voire de les réviser souvent à la baisse à l’aune d’un système qui a
ses propres préoccupations ?

5
Des travaux sur l’évaluation de pratiques d’éducation à l’orientation ont pu montrer
aussi que bien souvent les projets professionnels des jeunes sont ramenés dans leur
dimension purement rationnelle au détriment des aspirations souhaitées.
Pourtant, les conseillers déclarent souvent ne pas vouloir influencer leurs clients au
nom de l’autonomie et de la liberté de la personne.
Cependant, il est aussi nécessaire d’influencer le client pour l’amener à être libre. Il
y a là un paradoxe qui pose également une question éthique.
3. LECTURE ET COMMENTAIRE DU CODE DE DEONTOLOGIE DE
L’AIOSP DU 08 AOUT 1995
1
/
5
100%
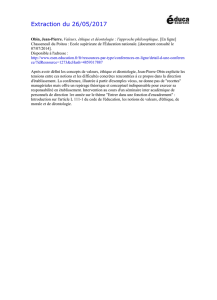

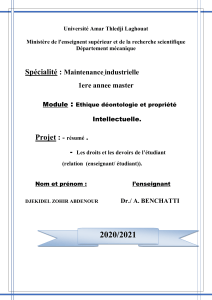
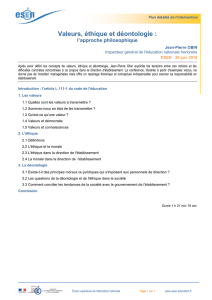

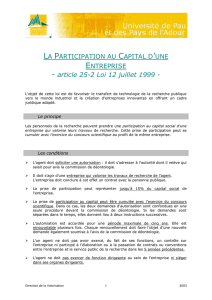
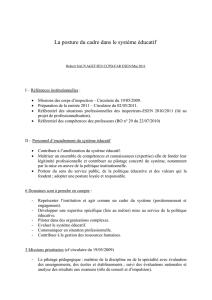
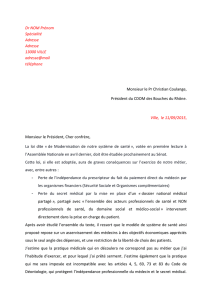
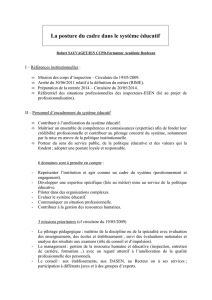
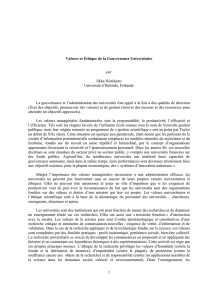
![Définitions Déontologie et éthique[1], définitions[2] Déontologie](http://s1.studylibfr.com/store/data/001335044_1-0083abd339e5282bb622b85ac470652f-300x300.png)