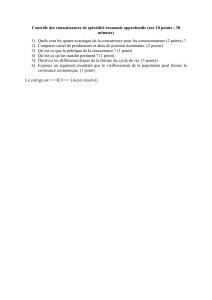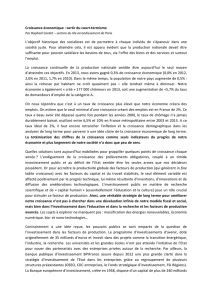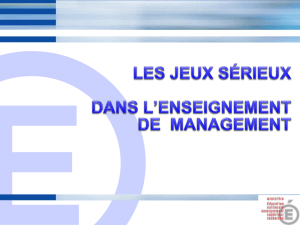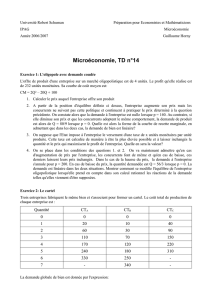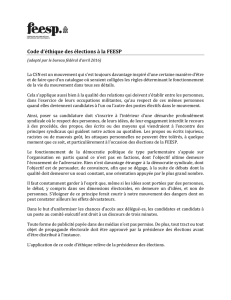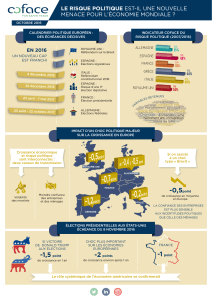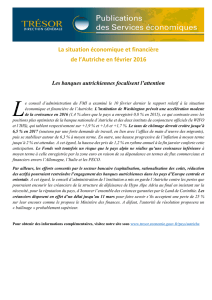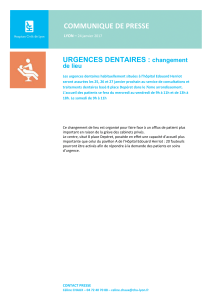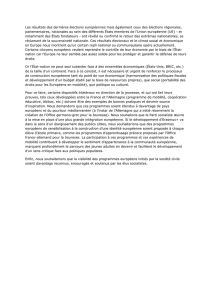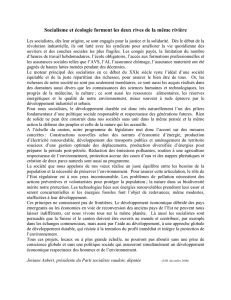Le 11 mai 1924 : Victoire du Cartel des gauches

POLE RADICAL ET ECOLOGISTE 85
René Dubois
Le Traversier
85430 La Boissière des Landes
06.04.47.59.95
duboisrene4050@neuf.fr
Aujourd’hui 11 mai 2017, une nouvelle page de notre Histoire s’ouvre. A la demande de mes amis
radicaux de Vendée, depuis quelques jours j’ai repris ma plume pour écrire le combat de nos idées, le
combat de nos valeurs : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité…
Si vous le souhaitez, je vous rendrai destinataire du billet d’humeur quotidien des 8, 9 et 10 mai que
je vous invite à partager et à faire partager…
Le 11 mai : une date symbole pour nos valeurs…
Le 11 mai 330 : Naissance de la future Constantinople
Ce jour-là Byzance devenait officiellement la capitale de l'empire romain, en remplacement de Rome,
sous le nom officiel de «Nouvelle Rome». En référence à son fondateur, l'empereur Constantin le
Grand, elle sera plus tard appelée Constantinoplis puis Constantinople…
Le 11 mai 1258 : Traité de Corbeil
Louis IX (Saint Louis) conclut le 11 mai 1258 à Corbeil, avec le roi Jacques 1er d'Aragon, un traité par
lequel il abandonne toute forme de suzeraineté sur la Catalogne, la Cerdagne et le Roussillon
cependant que le roi d'Aragon renonce à ses prétentions sur la Provence et le Languedoc.
Le 11 mai 1745 : Bataille de Fontenoy
À Fontenoy, dans le Hainaut belge, près de Tournai, le maréchal Maurice de Saxe bat l'armée anglo-
hollandaise commandée par le duc de Cumberland.
Le 11 mai 1798 : Coup d'État du 22 floréal
Le 11 mai 1798 a lieu le coup d'État dit du 22 floréal An VI. Les Directeurs ((les dirigeants du
Directoire), qui possèdent le pouvoir exécutif, cassent les élections aux deux assemblées, élections
trop favorables à leurs yeux aux Jacobins. Pour mettre un terme à ce type de conflit, certains
Directeurs en viennent à souhaiter une dictature militaire. Napoléon Bonaparte sera leur homme.
C’est le deuxième coup d'État du Directoire. Celui du 22 floréal an VI n'est plus, comme celui du coup
d'État du 18 fructidor an V (4 sept. 1797), dirigé contre les royalistes, mais contre les jacobins qui
viennent de gagner les élections d'avril. Ce succès inquiète fortement le Directoire dominé par les
modérés (Barras, Reubell, La Révellière-Lépeaux). On trouve un prétexte juridique : les assemblées
électorales s'étaient souvent scindées et des candidats minoritaires avaient été également déclarés
élus. Les directeurs demandent aux Conseils, avant l'arrivée des nouveaux venus, de décider quels
seraient les députés validés. Par la loi du 11 mai sont ainsi éliminés cent quatre jacobins et deux
royalistes. Ce coup de force illustre la difficulté du fonctionnement de la Constitution de 1795 et le
désir du Directoire de ne pas se laisser déborder par les Conseils. Comme quoi l’Histoire se
renouvelle parfois… Les Girondins n’aiment pas laisser leurs places aux Jacobins !
Le 11 mai 1867 : Le traité de Londres consolide l'indépendance du Luxembourg
Par ce traité signé le 11 mai 1867, la France renonce à l'annexion du Luxembourg, en échange de
quoi la Prusse retire ses garnisons du grand-duché de Luxembourg, lequel est déclaré neutre et peut
dès lors savourer une pleine indépendance.
Le 11 mai 1924 : Victoire du Cartel des gauches

Aux élections législatives du 11 mai 1924, la victoire du Cartel des gauches consacre l'échec de la
politique du président du Conseil Raymond Poincaré, notamment à l'égard de l'Allemagne et de
l’occupation de la Ruhr. Réunis au sein du Cartel, radicaux et socialistes s'entendent pour obliger à la
démission le président de la République Alexandre Millerand.
Le Président du Conseil Édouard Herriot adopte une diplomatie d'ouverture : acceptation du plan
Dawes sur les réparations, évacuation de la Ruhr, acceptation de l'Allemagne au sein de la Société
des Nations (SDN), reconnaissance de l'URSS. Les décisions du Cartel mobilisent contre lui la
Fédération nationale catholique, conduite par le prestigieux général de Castelnau. Socialistes et
radicaux se divisent d'autre part sur la politique économique. Les déficits budgétaires entraînent un
début de panique financière. D'aucuns croient y voir les manigances du «Mur d'argent». De fait, le
conseil des gouverneurs de la Banque de France, les «200 familles», refuse de relever le plafond des
avances à l’État, à cause de sa défiance en la capacité de remboursement du gouvernement.
La majorité de gauche se résigne à appeler Raymond Poincaré, un homme de droite, à la présidence
du Conseil. Celui-ci forme le 23 juillet 1926 un gouvernement d'Union nationale qui rétablit
l'équilibre des finances... Comme quoi l’Histoire se renouvelle parfois… Les Girondins n’aiment pas
laisser leur place aux Jacobins !
11 mai 1931 : Faillite de la Kreditanstalt Bank
Le 11 mai 1931, la Kreditanstalt Bank (ou Kredit anstalt) se déclare en faillite du fait que ses pertes
dépassent la moitié de son capital. Cette banque est la principale d'Autriche et détient la moitié de
l'industrie nationale. Sa faillite est due à la crise endémique qui sévit en Autriche depuis la fin de la
Grande Guerre, en raison de l'éclatement de l'Autriche-Hongrie en petits États rivaux. Elle est
accélérée par les difficultés de mise en place d'un projet d'union douanière entre l'Autriche et
l'Allemagne. Le gouvernement autrichien tente de sauver la banque et réclame l'aide des autres
pays. Mais la France, seul grand pays à disposer d'un excédent financier, tergiverse : elle réclame du
gouvernement autrichien qu'il renonce d'abord à son projet d'union douanière. La panique s'installe
et les capitaux s'enfuient d'Autriche et d'Allemagne. La banque est sauvée mais, entretemps, la crise
économique issue du krach de Wall Street, qui semblait en voie de résorption, fait son irruption en
Europe et frappe de plein fouet l'Autriche mais aussi l'Allemagne, très fortement liée à sa petite
voisine... Déjà la crise née d’une guerre économique prémices de la deuxième guerre mondiale…
Le Cartel des gauches de 1924 : L’apogée du parti radical-socialiste ?
En 1919, les Français, traumatisés par quatre années de guerre totale, élisent une Chambre dite
« bleu horizon » car nombre d’anciens combattants y siègent. Cette « Chambre introuvable »
consacre la victoire du Bloc national, une coalition de partis de droite et du centre qui souhaitent
prolonger l’« Union sacrée » du temps de guerre. La période qui s’ouvre est marquée, à droite, par la
volonté de reconstruction d’un pays dévasté et par l’acharnement sur l’adversaire allemand ; à
gauche, par le désir du maintien de la paix et du règlement de la question sociale.
En 1919, l’article 231 du traité de Versailles rend l’Allemagne responsable de la guerre et autorise la
France à lui réclamer des réparations. Exaspéré par la lenteur du processus, Poincaré fait envahir la
Ruhr par l’armée française, en janvier 1923. S’ajoutant à la non-satisfaction des revendications
sociales, cette décision provoque la rupture tonitruante des radicaux-socialistes de Herriot avec la
majorité du Bloc national.
La campagne pour les élections de mai 1924 est aussi violente que celle de 1919, mais elle oppose
cette fois-ci gauche et droite. La scission de la S.F.I.O. entre socialistes et communistes, lors du
congrès de Tours de décembre 1920, permet d’envisager l’alliance entre socialistes républicains et un
parti radical-socialiste reconstitué autour des valeurs clefs de laïcité et de justice sociale. La victoire
de la gauche est aussi nette que l’avait été celle du Bloc national ; mais la majorité composite est bien
fragile.

Edouard Herriot, un radical au pouvoir après la Première Guerre Mondiale
Après la guerre, le Parti Radical-socialiste tient efficacement sa place dans « l’union sacrée ». Le vent
qui souffle vers la droite et le nationalisme ne le favorise pas. Mais, relevé très vite de son échec
provisoire aux élections de 1919, il occupera entre les deux guerres le devant de la scène politique de
manière presque ininterrompue. Dès 1923, Edouard Herriot sera l’artisan de ce réveil et demeurera
la figure dominante du parti jusqu’en 1940 et même bien au-delà. Edouard Daladier jouera à ses
côtés et parfois contre lui un rôle non moins prestigieux, mais souvent décisif. Durant cette période,
le parti radical-socialiste a été presque toujours associé au pouvoir. S’alliant tantôt à droite, tantôt à
gauche, il a pu donner l’impression qu’il pratiquait volontairement, pour s’y maintenir, une politique
de bascule. C’est que situé à la charnière de toutes les majorités possibles, campant plus du quart
des députés, dominant beaucoup de grandes villes et de nombreux conseils généraux, son concours
était nécessaire pour préserver toutes les vicissitudes de la politique, une certaine stabilité politique
et pour éviter les affrontements brutaux. » C’est peut-être un Parti Radical qui a manqué à l’Espagne
en 1936″. C’est la revue « Esprit » pourtant bien éloignée du radicalisme, qui a écrit ces lignes.
D’ailleurs, malgré l’étendue des responsabilités qu’il a alors assumées, malgré l’inévitable
« pourrissement » du pouvoir, le personnel radical fut -tous les historiens le reconnaissent-
consciencieux et honnête, soucieux des affaires de l’état et fidèle à sa philosophie politique.
Le bilan de l’action des radicaux est largement positif. Herriot a été un ministre des Affaires
étrangères lucide et passionné de justice internationale. La reconnaissance de l’URSS, la liquidation
du contentieux avec l’Allemagne, le renouveau de l’Alliance avec l’Angleterre et les Etats-Unis, les
efforts poursuivis tenacement pour donner à la Société des Nations une efficacité réelle, la résistance
à l’impérialisme de l’Italie fasciste et aux entreprises guerrières de l’Allemagne hitlérienne
témoignent de sa volonté de paix, de son patriotisme et de sa clairvoyance.
Herriot a été un excellent ministre de « l’Instruction Publique ». Il a, un des premiers, compris
l’importance capitale de l’enseignement technique et son projet de l’école unique constitue l’amorce
d’un système cohérent englobant tous les niveaux de l’Education Nationale sans barrière, ni cloisons
: idée féconde dont on n’a pas fini de tirer toutes les conséquences. Quant à Jean Zay, les initiatives
qu’il a prises quand il était ministre du Front populaire permettent de voir en lui le précurseur d’une
organisation moderne et démocratique de l’enseignement.
Aujourd’hui, il nous faut poursuivre l’œuvre engagée …
Comme Edouard Hérriot “La Culture, c'est ce qui demeure dans l'homme
lorsqu'il a tout oublié.” “Une utopie est une réalité en puissance.” “La
tradition, c'est le progrès dans le passé ; le progrès, dans l'avenir, ce sera la
tradition.”
Comme Jean Zay " Les écoles doivent rester l’asile inviolable où les querelles
des hommes ne pénètrent pas.”
Dan la vie de tous les jours, à l’école comme en politique la pédagogie de
médiation n’est-elle pas la meilleure des pédagogies ?
1
/
3
100%