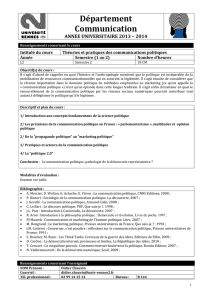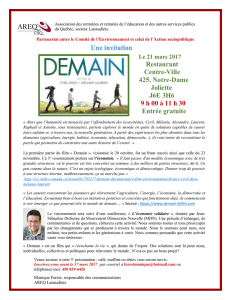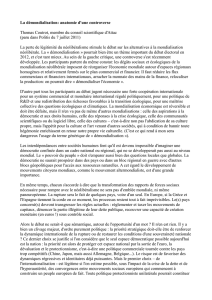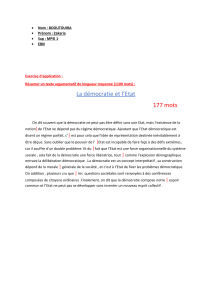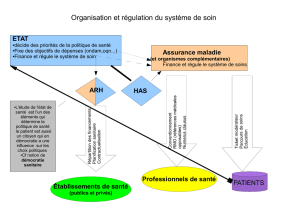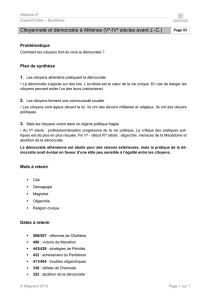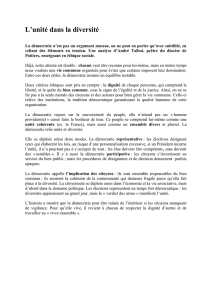Télécharger la suite de l`article

1
Politique & Société 1/2015
il Mulino
L’Europe « hors démocratie »
Introduction
Longtemps la construction européenne est apparue comme le fruit d’un compromis entre une
droite libérale surtout soucieuse de bâtir une économie capitaliste régionale plus intégrée et
une gauche social-démocrate attachée à faire valoir les droits des citoyens et des salariés en
étendant à tous les pays membres les avancées démocratiques et sociales réalisées par les
pays dans lesquelles les organisations du mouvement ouvrier avaient réussi à peser sur la
législation nationale. La consolidation de la démocratie en Espagne, au Portugal et en Grèce,
d’ abord, puis dans les anciens pays du « glacis soviétique » ont donné un certain crédit à la
thèse selon laquelle l’Europe, si elle contribuait à élargir un espace économique
d’accumulation au profit des entreprises capitalistes du « centre », avait aussi pour effet
d’étendre à sa « périphérie » l’espace de la démocratie libérale, avec ses attributs classiques
de libertés civiles, de droits politiques et même, dans une certaine mesure, de droits sociaux
dits de « troisième génération ». En somme, l’Europe unie reconduisait à son échelle le
compromis historique entre le capitalisme, avec son besoin de grand marché et sa recherche
de gains de productivité, et le pouvoir salarié organisé, avec sa protection sociale et son
attachement aux politiques redistributives. Cette apparence de compromis a tenu jusqu’au
début des années 1990. La chute du mur de Berlin, le changement du rapport de forces entre
les classes sociales, l’imposition universelle du « consensus de Washington » et surtout les
effets de la « nouvelle mondialisation » financière ont profondément infléchi la construction
européenne dans un sens néolibéral. Certes on aurait pu croire, au moment du Conseil
européen de Lisbonne (2000) qui a ouvert la voie à ce qu’on a appelé dans le jargon officiel
“la stratégie de Lisbonne”, que l’Union européenne entendait gagner la bataile de la
compétitivité “par le haut” , en construisant une “économie de la connaissance” sur des bases
coopératives. En réalité, très rapidement, c’est une autre voie beaucoup plus régressive qui

2
allait être prise, faite de disciplines budgétaires renforcées, de reculs sociaux, de baisse du
pouvoir d’achat. La crise financière de 2007-2008 et ses conséquences sur l’activité
économique ont laissé un très court moment entrevoir la possibilité d’une réorientation de
l’Europe dans un sens moins favorable à la déréglementation des marchés et à la spéculation
financière, mais la parenthèse s’est vite refermée. Le secteur financier, avec l’aide de
gouvernements complaisants, a réussi à transférer le coût de ses propres excès aux États et
aux ménages. La crise dite des “dettes souveraines” qui s’en est suivi a conduit très
rapidement à mettre en cause l’État social et à abaisser le coût du travail. Ce n’est pas le lieu
d’analyser en détail ce tour de prestidigitation qui a fait passer d’une crise du capitalisme
spéculatif à une crise de la dette publique, en parvenant à innocenter la finance de toutes ses
responsabilités dans le déclenchement de la crise et à faire porter tout le poids de la charge
sur les “archaïsmes” et les “corporatismes” d’un salariat “trop protégé”.
Ce qui seul nous importe ici est le diagnostic que l’on est en mesure de porter aujourd’hui sur
l’état de la démocratie en Europe. Si la crise financière américaine et la crise de la zone euro
n’ont pas provoqué la dé-démocratisation européenne, elles l’ont accélérée, accentuée et
révélée au grand jour. Nous ne vivons pas seulement les conséquences désastreuses d’une
politique déflationniste, nous subissons une crise politique larvée qui a pour caractéristiques
une désaffection croissante des électorats vis-à-vis de l’Union européenne et un discrédit de
plus en plus prononcé des responsables politiques qui, ne se sentant plus aucune obligation de
respecter leurs engagements à l’égard de leurs électeurs, se vantent de n’avoir à obéir qu’aux
“contraintes” des marchés financiers et aux règles impératives dont les institutions
européennes se font les vestales sourcilleuses. En un mot, la citoyenneté nationale autant
qu’européenne apparaît désormais privée de toute valeur symbolique et de tout pouvoir
effectif. Il en résulte dans de nombreux pays une poussée souverainiste, une montée de la
xénophobie anti-immigrés et, plus récemment l’apparition d’une germanophobie rampante.
En d’autres termes, c’est l’autolégitimation même de l’Europe, tant intellectuelle que
politique,qui est radicalement minée par les politiques néolibérales.
Cette situation singulière, que nous proposons d’appeler le «hors-démocratie » de l’Europe,
s’inscrit dans un contexte mondial de nécrose prononcée de la démocratie dite
« représentative ». Elle a cependant des traits singuliers qu’il convient de saisir. L’un de ces
derniers est à nos yeux particulièrement important : la voie de sortie de la démocratie en
Europe est directement liée à la médiation d’instances juridico-politiques qui, chargées de
faire respecter les normes économiques et les impératifs financiers, viennent se substituer

3
aux pouvoirs nationaux, lesquels étaient censés, selon la doctrine classique de la démocratie,
émaner de la communauté politique des citoyens. Des gouvernements européens mis en place
à la suite d’élections sont ainsi passés sous la tutelle d’organismes techniques chargés de
prescrire directement les coupes à opérer dans les budgets et les dépenses sociales et les
réformes à mettre en œuvre. L’exemple grec, qui a pris figure de laboratoire pour le continent,
est évidemment dans toutes les mémoires. Mais il faut aussi se rappeler que tous les pays
européens sont désormais sous la surveillance des instances européennes et contraints de
mener partout des « réformes structurelles » stéréotypées. Le modèle néolibéral européen qui
se met en place n’est pas sans rencontrer une profonde hostilité de la part de fractions très
importantes de la population et engendre des tensions croissantes entre les pays du Nord et les
pays du Sud de l’Europe.
La nécrose universelle de la démocratie libérale classique
Il revient à Wendy Brown d’avoir souligné que le néolibéralisme nous faisait entrer dans un
processus continu de « dé-démocratisation »
1
. Sa thèse, essentiellement centrée sur la
situation américaine, appartient à un ensemble plus large d’analyses qui ont pour point
commun un tableau très sombre de l’état actuel de la démocratie. Colin Crouch a avancé dès
les années 90 que nous étions entrés dans un régime qu’il qualifiait de « post-démocratique »
et qui se caractérisait, entre autres, par le poids croissant et l’intervention directe des intérêts
des grandes entreprises capitalistes dans la conduite politique des pays
2
. De son côté, Sheldon
S.Wolin préfère parler de « démocratie managée » et de « totalitarisme inversé » pour
désigner l’émergence d’un « superpouvoir » mi-public mi-privé exerçant un contrôle sans
limites sur la population
3
. On peut retenir de ces analyses un certain nombre de caractères
significatifs de l’époque qui est la nôtre. C’est d’abord le constat d’une désactivation de la
démocratie libérale, dont la légitimité qui reposait sur l’expression de la volonté du peuple
au travers d’une représentation électorale semble désormais irrémédiablement minée.
Tournant le dos à la défense et à l’extension des droits des citoyens, la rationalité politique du
1
Cf. Wendy Brown, “Le néolibéralime et la fin de la démocratie”, in Les habits neufs de la politique mondiale,
Les Prairies ordinaires, 2007.
2
Colin Crouch, Post-democracy, Polity Press, 2004.
3
Sheldon S. Wolin, Democracy incorporated, Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarism,
2008.

4
néolibéralisme s’aligne sur la norme du marché, sur le modèle de l’entreprise, et sur les
privilèges de la richesse. La rentabilité, la performance, la concurrence composent les
nouvelles tables de la loi. La séparation entre l’univers des intérêts privés et le domaine public
tend à disparaître au fur et à mesure que les valeurs du marché se disséminent dans toutes les
institutions publiques, et jusqu’au cœur de l’État social
4
. La figure du citoyen s’efface, tandis
que « l’homme économique » en quête de maximisation de son intérêt personnel et l’individu
« entrepreneur de lui-même » deviennent les seul répondants de l’action gouvernementale.
Les auteurs cités plus haut s’accordent sur le fait que la démocratie libérale, aussi imparfaite
qu’elle ait été, appelait, ou du moins tolérait que soient posées des limites à la puissance
publique, laquelle devait rester bon gré mal gré sous le contrôle du corps électoral. Avec
l’avènement du néolibéralisme, nous assistons à une hybridation de la puissance de l’État et
des puissances économiques privées qui conduit à un affranchissement progressif de ce
contrôle démocratique et même, comme le montre Sheldon S.Wolin, à une inversion du
contrôle : un pouvoir principiellement illimité se donne le droit de diriger la population
comme si elle était constituée d’employés d’une grande entreprise. L’étatisme autoritaire, la
fusion des oligarchies publiques et capitalistes, l’illimitation du pouvoir au nom de la
« performance » menacent non seulement les droits sociaux mais aussi les libertés civiles et
politiques d’une population qui fait de plus en plus l’objet d’une surveillance permanente. Ces
constats se ramènent au fond à l’idée selon laquelle avec le néolibéralisme nous assistons à
un virage radical dans la manière de gouverner les sociétés. La politique est non seulement
submergée par la « généralisation de l’esprit d’entreprise » (W.Brown)
5
, elle est surtout
réduite à une « gouvernance entrepreneuriale » qui n’a pour principe et pour objectif que
l’accroissement indéfini du pouvoir comme le souligne Sheldon S.Wolin. Tout se passe au
fond comme si la fusion de la puissance publique et des puissances capitalistes permettait
progressivement à ces dernières d’infuser directement dans les rouages de l’Etat leur logique
d’illimitation tout en leur permettant d’exercer une domination de plus en plus directe sur la
société.
Ces traits généraux de la rationalité néolibérale, aussi pertinents soient-ils, doivent être
complétés par des analyses plus fines susceptibles de montrer qu’elle prend selon les
contextes des aspects distincts et emploie pour s’imposer des leviers différents. Si, comme
l’ont montré Colin Crouch, Wendy Brown ou Sheldon S.Wolin, le néolibéralisme est une
4
Cf. ibid., p. 50.
5
Wendy Brown, ibid., p. 68.

5
forme politique qui dévitalise la « démocratie libérale » classique, il ne le fait pas partout de la
même manière. Michael Mann a suggéré que le néolibéralisme obéissait à des modèles
différents que l’on pourrait faire apparaître en comparant le degré d’inégalités sociales, les
réformes de la protection sociale, le rôle du FMI, les effets du libre échange, la dérégulation
financière
6
. Il nous semble que l’Europe présente un profil singulier, qui ne tient pas à la
résilience de son « modèle social » comme on le dit souvent pour mieux prôner son
affaiblissement, mais plutôt à la manière spécifique que les instances politiques européennes
emploient pour mener à bien la normalisation néolibérale. Sans doute les principaux pays
membres de l’Union européenne ont-ils chacun leurs classes dominantes, leurs grandes
banques, leurs multinationales, au même titre que les Etats-Unis, le Japon ou la Chine ont les
leurs. Mais ces pouvoirs sociaux et économiques nationaux sont jusqu’à un certain point
divisés et rivaux, et ne constituent donc pas à eux seuls une force suffisamment unifiée pour
imposer partout en même temps les transformations structurelles conformes à la logique
néolibérale. C’est précisément ce que la crise ouverte en 2008 va leur permettre de réaliser en
s’appuyant sur des mécanismes renforcés de surveillance et d’assistance conditionnelle.
L’enchaînement des événements consécutifs à la crise financière et l’action des
gouvernements européens depuis lors sont à cet égard riches d’enseignement. On sait que la
crise de l’euro entre 2010 et 2012 a été déclenchée par la double décision de renflouer les
banques privées et de refuser la même garantie aux dettes publiques. Mais ce défaut de
solidarité, inscrit d’ailleurs dans les textes européens, comme le retard pris pour assister les
pays les plus menacés par la spéculation sur les obligations d’État (Irlande, Grèce, Portugal,
puis Italie et Espagne) n’étaient pas une suite d’« erreurs techniques » inspirées par Angela
Merkel comme on a pu le dire, mais une manière de faire pression sur les gouvernements des
pays les plus exposés à la spéculation pour faire payer à leurs populations le coût principal de
la crise financière. Ces événements montrent une particularité du système néolibéral
européen. Les oligarchies économiques et politiques ont mis en place des systèmes collectifs
de règles et de contraintes qui sont supposés fonctionner « objectivement » et s’imposer
mécaniquement à tous, sans qu’aucun responsable d’une décision ne puisse être identifié,
sans qu’aucun représentant d’un pays ou d’une force économique ne puisse être désigné
comme l’auteur d’un choix politique. Ce pouvoir disciplinaire de la règle collective présente
évidemment un avantage considérable puisqu’il fait passer pour une simple application des
6
Michael Mann, “The Variable Impact of Neo-Liberalism Across the Globe”, in Sokratis Koniordos and Nicos
Fotopoulos (eds.), Poverty, Education, and Social Inequalities in the Age of Globalization, Athens, GSEE, 2010
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%