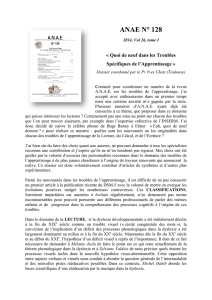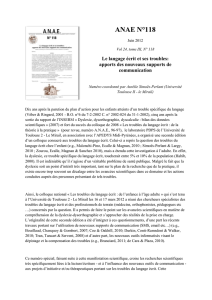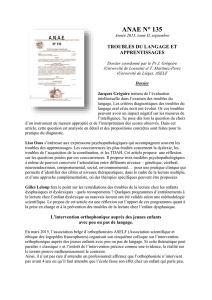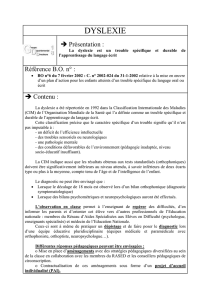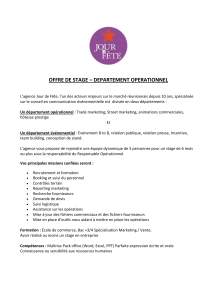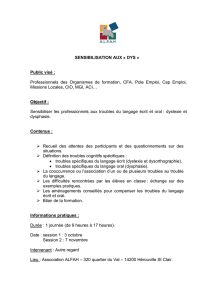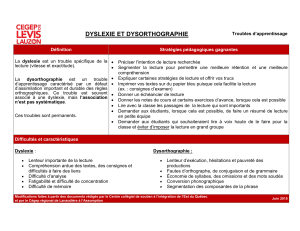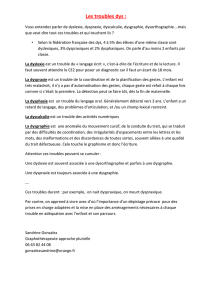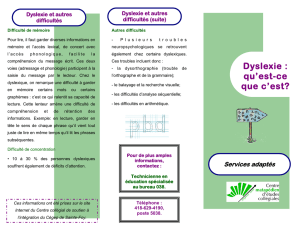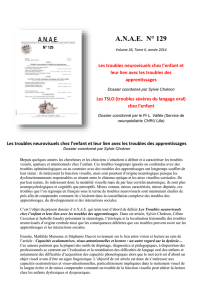ANAE N° 128

ANAE N° 128
2014, Vol 26, tome I
« Quoi de neuf dans les Troubles
Spécifiques de l’Apprentissage »
Dossier coordonné par le Pr Yves Chaix (Toulouse)
Contacté pour coordonner un numéro de la revue
A.N.A.E. sur les troubles de l’apprentissage, j’ai
accepté avec enthousiasme dans un premier temps
mais une certaine anxiété m’a gagnée par la suite.
Plusieurs numéros d’A.N.A.E. ayant déjà été
consacrés à ce thème, que proposer dans ce domaine
qui puisse intéresser les lecteurs ? Certainement pas une mise au point sur chacun des troubles
que l’on peut trouver aisément, par exemple dans l’expertise collective de l’INSERM. J’ai
donc décidé de suivre la célèbre phrase de Bugs Bunny à Elmer « Euh, quoi de neuf
docteur ? » pour réaliser ce numéro : quelles sont les nouveautés ou les originalités dans
chacun des troubles de l’apprentissage de la Lecture, du Calcul, et de l’Ecriture ?
J’ai bien sûr du faire des choix quant aux auteurs, ne pouvant demander à tous les spécialistes
reconnus une contribution et j’espère qu’ils ne m’en tiendront pas rigueur. Mes choix ont été
guidés par la volonté d’associer des personnalités reconnues dans le domaine des troubles de
l’apprentissage à de plus jeunes chercheurs à l’origine de travaux innovants qui annoncent la
relève. Ce dossier est donc volontairement constitué d’articles de synthèses et d’autres plus
expérimentaux.
Parmi les nouveautés dans les troubles de l’apprentissage, il est difficile de ne pas consacrer
un premier article à la publication récente du DSM-5 avec la volonté de mettre en exergue les
évolutions positives malgré les nombreuses controverses. Ces CLASSIFICATIONS,
forcément imparfaites car amenées à évoluer régulièrement, n’en demeurent pas moins
incontournables pour pouvoir permettre aux différents professionnels de parler des mêmes
enfants et de progresser dans la compréhension des processus cognitifs à l’origine de ces
troubles.
Dans le domaine de la LECTURE, si la dyslexie développementale a été initialement décrite
à la fin du XIXe siècle comme un trouble visuel (« cécité congénitale des mots »), la
conviction de l’implication d’un déficit des processus phonologiques dans la dyslexie a été
largement dominante au milieu et à la fin du XXe siècle. Néanmoins dès la fin du XXe siècle
et au début du XXIe, l’hypothèse d’un déficit visuel a repris de l’importance. Il était de ce fait
nécessaire de demander à Mélanie Jucla de faire le point sur ce qui reste actuellement de la
théorie phonologique dans la dyslexie et à Sylviane Valdois de nous préciser quels étaient les
processus visuels inclus dans la nouvelle hypothèse visuo-attentionnelle. Cette opposition
entre aspects verbaux et visuels nous conduit à aborder la question générale de l’intermodalité
et des nouvelles pistes rééducatives possibles. Dans ce contexte, Michel Habib aborde les
bases scientifiques d’une rééducation par la musique dans la dyslexie.

Dans le domaine du CALCUL, nous connaissons les liens existant entre doigts et nombres
notamment depuis les travaux de Michel Fayol. Mais le caractère indispensable des gnosies
digitales dans le développement des aptitudes numériques reste discuté. Les travaux de
Catherine Thevenot sur ces questions à partir d’un modèle pathologique original, celui de
l’enfant hémiplégique, apportent ainsi des éclairages nouveaux.
Pour l’ECRITURE, deux aspects sont à l’œuvre un aspect moteur et un aspect linguistique.
Régis Soppelsa et Jean Michel Albaret présentent, dans leur article, un nouvel outil
d’évaluation de l’écriture (BHK-Ado) chez les collégiens qui faisait défaut jusqu’à présent. Ils
reprécisent dans leur article le rôle clé de l’écriture manuscrite au collège et les conséquences
en cascade de la dysgraphie sur les fonctions cognitives. L’équipe de Denis Alamargot étudie
justement ces relations entre performances graphomotrices et orthographiques chez des
enfants normolecteurs et chez des enfants dyslexiques.
Dyslexie, Dysorthographie, Dyscalculie, Dysgraphie: autant de troubles pour lesquels, les
équipes francophones restent mobilisées et à la pointe pour décortiquer les mécanismes
cognitifs sous jacents, pour produire des outils d’évaluation, pour proposer de nouvelles pistes
rééducatives. J’espère que ce numéro spécial d'A.N.A.E vous aura convaincu.
Yves Chaix
Varia
Les spécificités sensorielles des personnes avec autisme de l’enfance à l’âge adulte
C. DEGENNE-RICHARD, M. WOLFF ET J.-L. ADRIEN
Épreuve de dénomination d’images chez l’enfant d’âge scolaire : DEN48 –
Révisée et version abrégée (DEN30)
L. AUCLAIR & I. JAMBAQUE
Acheter le N°128
Abonnez-vous et recevez tous les numéros de l’année 2014, Vol 26, N° 128 à 133
Vous bénéficierez également, si vous relevez du tarif « PROEFESSIONEL »
ou « ETUDIANT» d’un tarif très préférentiel sur les
N° des années précédentes. Et
10% sur les formations ANAE

Ce numéro fait partie du Vol 26, année 2014 de l’ANAE
N° 128 – Quoi de neuf dans les Troubles Spécifiques de l’Apprentissage
Dossier coordonné par le Pr Yves Chaix (Toulouse)
N° 129 – Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien avec les troubles des
apprentissages
Dossier coordonné par Sylvie Chokron
N° 130 - les Troubles du Spectre de l’Autisme (Volume 1)
Le diagnostic et l’évaluation
Dossier coordonné par Christine Bonnier et Philippe Evrard
N° 131 - Le Bégaiement
Dossier coordonné par Françoise Estienne
N° 132/133 - Les Troubles du Spectre de l’Autisme (Volume 2/3)
Prise en charge et résultats
Dossier coordonné par Christine Bonnier et Philippe Evrard
Neuropsychologie - Psychologie - Orthophonie – Education – ASH -
Enseignement spécialisé - Intégration - Psychomotricité -
Ergothérapie - Psychiatrie -
MPR - Médecine Générale - Pédiatrie - Handicap – Remédiation
Catherine de Gavre
Directeur de la Publication ANAE
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant
www.anae-revue.com
www.anae-revue.over-blog.com
ANAE formations
Les Editions du Petit ANAE
1
/
3
100%